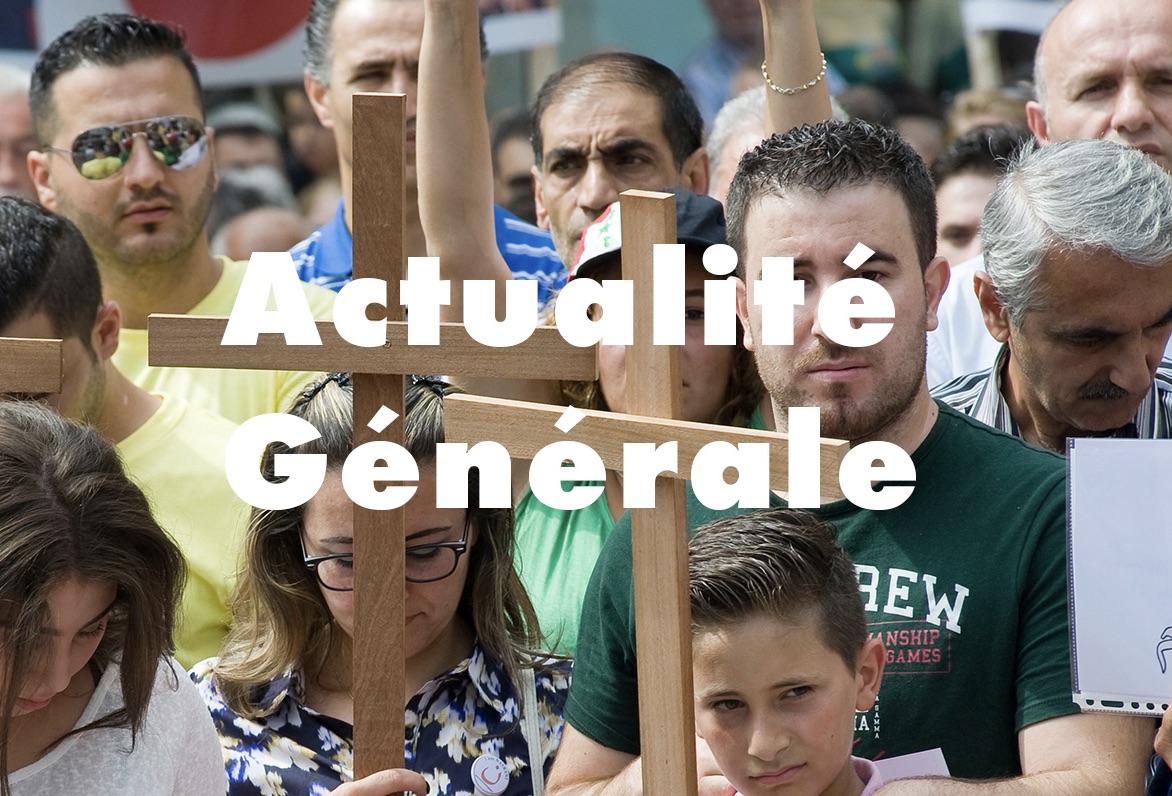Exercices militaires en mer Noire malgré l’opposition de Moscou
KIEV (Reuters) – L’Ukraine et les États-Unis lancent lundi des manoeuvres militaires dans le cadre de « Sea Breeze 2021 », un exercice annuel impliquant plus de 30 pays en mer Noire et dans le sud de l’Ukraine, malgré les appels de la Russie à leur annulation.
Le Sea Breeze 2021 intervient en pleine montée des tensions avec Moscou, qui a déclaré la semaine dernière avoir tiré des coups de semonce et largué des bombes sur la trajectoire d’un navire de guerre britannique pour le chasser des eaux de la mer Noire au large de la Crimée. La Grande-Bretagne a rejeté la version russe de l’incident.
La Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014 et considère les zones proches du littoral comme des eaux russes, ce que les pays occidentaux contestent.
L’ambassade de Russie à Washington a demandé la semaine dernière l’annulation des exercices, et le ministère russe de la Défense a déclaré qu’il réagirait si nécessaire pour protéger sa propre sécurité nationale.
Le Sea Breeze 2021 doit durer deux semaines et impliquer environ 5.000 militaires de l’Otan et d’autres alliés, ainsi qu’une trentaine de navires et une quarantaine d’avions. Le destroyer lance-missiles américain USS Ross et le corps des Marines des États-Unis y participeront.
Selon l’Ukraine, l’objectif principal de cet exercice annuel lancé en 1997 est d’acquérir de l’expérience en matière d’actions conjointes lors d’opérations multilatérales de maintien de la paix et de sécurité.
Les tensions entre Moscou et Kiev ont grimpé d’un cran cette années, après que la Russie a envoyé des troupes aux frontières de l’Ukraine, accusant Kiev de chercher à déstabiliser la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, où l’armée ukrainienne combat des séparatistes prorusses depuis 2014, un conflit qui a fait 14.000 morts selon Kiev.
(Pavel Polityuk, version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)
Vous aimez nos publications ? Engagez-vous !
Les systèmes politiques et médiatiques ont besoin que s'exercent des contre-pouvoirs. Une majorité de journaux, télévisions et radios appartiennent à quelques milliardaires ou à des multinationales très puissantes souhaitant faire du profit, privant les citoyens d’un droit fondamental : avoir accès à une information libre de tout conflit d’intérêt.Le Journal Chrétien, service de presse en ligne bénéficiant d’un agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse du Ministère de la Culture, assure un contre-pouvoir à l’ensemble des acteurs sociaux, en vérifiant les discours officiels, en décryptant l'actualité, en révélant des informations de première importance ou en portant le témoignage des dominés.
La qualité de notre travail est reconnu par les médias séculiers. Dernièrement, le président du Journal Chrétien a accordé une longue interview à Sud Ouest, le deuxième quotidien régional français avec une diffusion totale de 219 000 exemplaires.
ENGAGEZ VOUS !
Quand les évangéliques sont attaqués, calomniés ou traités avec mépris par les médias traditionnels, un silence de notre part ne serait pas chrétien. Une telle attitude montrerait un renoncement suspect à se faire respecter et à exiger des médias mondains un tel respect.Lorsque les pasteurs et les églises évangéliques sont attaqués, le critère de la solidarité chrétienne doit jouer. Comment nous dire membres du Corps du Christ si nous restons indifférents à la persécution de certains d’entre nous, souvent réduits au silence et incapables de faire valoir leurs droits ou, tout simplement, de se faire respecter comme chrétiens ou communautés évangéliques ?
En s'appuyant sur notre plateforme de médias, l’action sur l’opinion publique est évidemment essentielle. Faire savoir est la condition de toute action, car rien n’est pire que le silence. D’où l’importance de l’action en direction des médias, des institutions et des populations.
Evidemment, ici comme ailleurs, la réticence de la part des chrétiens à agir comme des groupes de pression constitue une difficulté majeure. Mais, là encore, ne faudrait-il pas s’interroger sur notre dispersion et nos réticences à agir comme lobby, quand il s’agit de défenses des libertés et droits humains fondamentaux ?
Vous pouvez soutenir notre action :
- en faisant un don ponctuel ou régulier.
- en rejoignant notre équipe comme analyste, expert, professionnel de l'audiovisuel, défenseur des droits de l'homme, journaliste, théologien, etc.
- en priant pour nous.
- en nous contactant par email à l'adresse [email protected] ou par téléphone au par téléphone au +33 769138397
 JE FAIS UN DON
JE FAIS UN DON