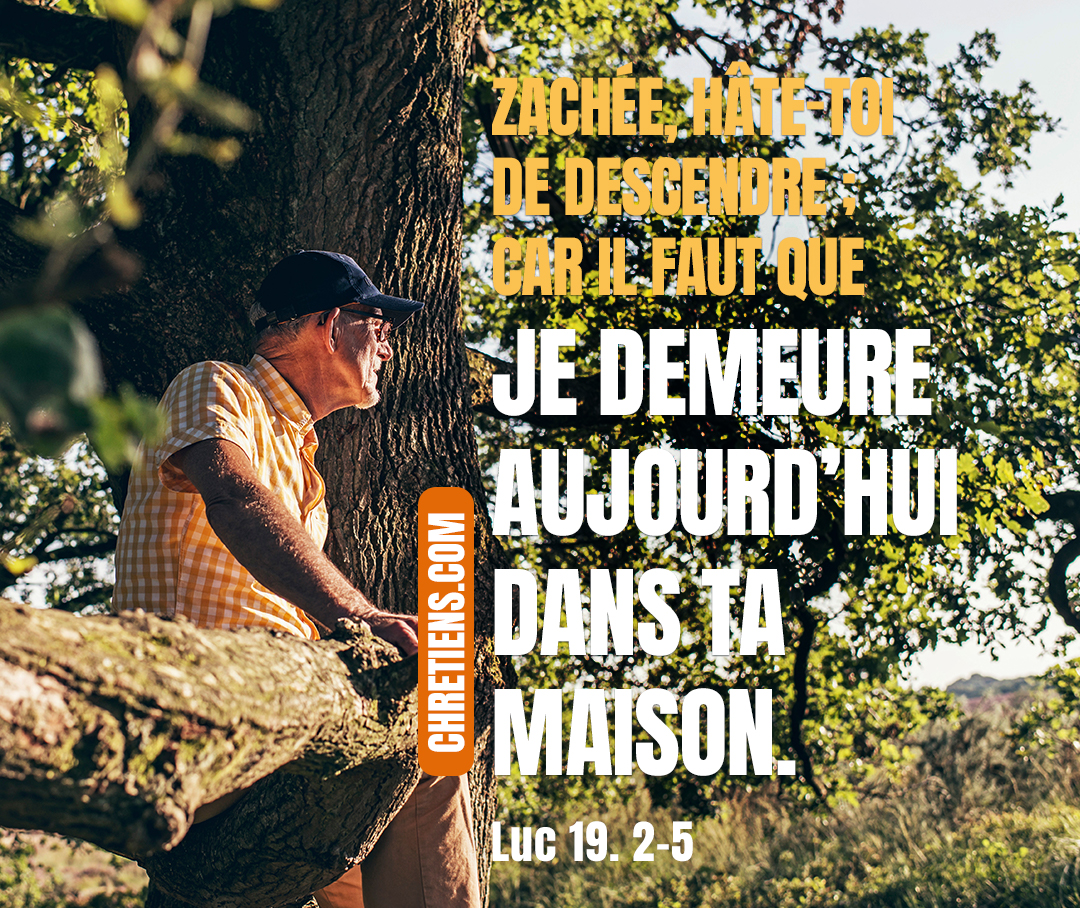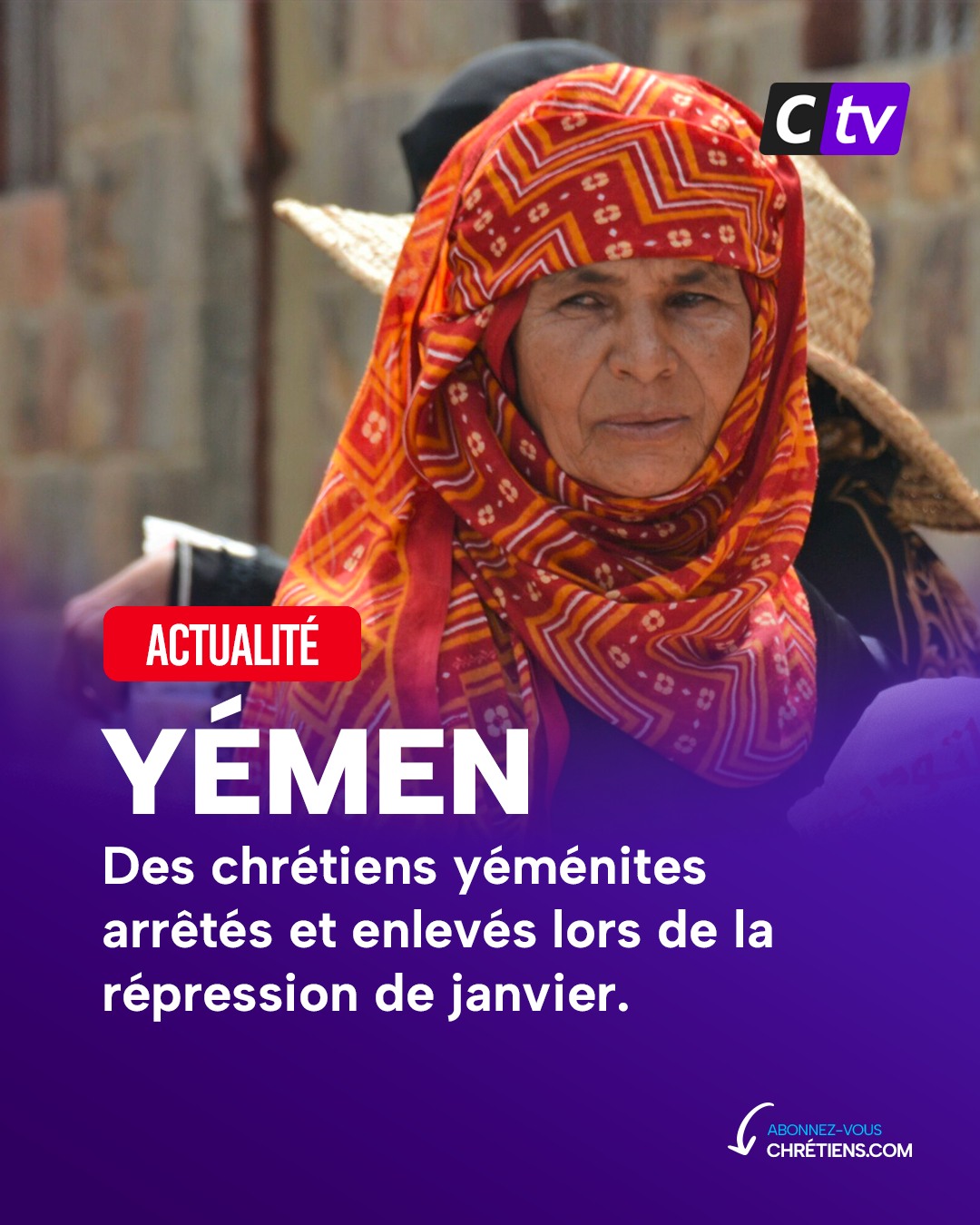Ouverture des débats au procès des attentats de Bruxelles

par Philip Blenkinsop et Marine Strauss
BRUXELLES (Reuters) – La cour d’assises de Bruxelles a ouvert lundi les débats dans le procès de dix hommes accusés d’avoir participé aux attentats terroristes dans le métro et l’aéroport de Bruxelles le 22 mars 2016, qui ont fait 32 morts et plus de 300 blessés.
Le procès, qui doit s’étaler sur sept mois compte environ 1.000 personnes parmi les parties civiles. Elles espèrent pouvoir comprendre le motif des attaques qu’elles ou leurs proches ont subies.
Les dix individus sont accusés de participation aux activités d’un groupe terroriste, et neuf sont inculpés d’assassinats et de tentatives d’assassinats dans un contexte terroriste et risquent la prison à vie.
Le dixième, Oussama Atar, commanditaire présumé des attentats, est présumé mort en Syrie et sera jugé par contumace.
Six accusés ont déjà été condamnés en juin pour leur rôle dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et au Stade de France, qui ont fait 130 morts.
Contrairement au procès de Paris, les accusés seront jugés par un jury populaire constitué vendredi dernier.
La présidente de la cour d’assises Laurence Massart a confirmé l’identité des accusés, dont Mohamed Abrini, qui, selon les procureurs, s’est rendu à l’aéroport mais a fui sans faire détoner sa valise d’explosifs, et Salah Abdeslam, le principal suspect dans le procès de Paris.
Tous, à l’exception d’Osama Krayem, un ressortissant suédois accusé d’avoir planifié un second attentat dans le métro, ont répondu à ses questions.
Les procureurs devraient commencer à lire l’acte d’accusation de 486 pages mardi, avant que ne commencent les auditions de quelque 370 experts et témoins.
Les attentats de Bruxelles ont été revendiqués par l’État islamique et ont tué 15 hommes et 17 femmes originaires d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. Trois des terroristes se sont fait explosé lors des attentat.
(Avec la contribution de Clement Rossignol, rédigé par Philip Blenkinsop, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)

NE MANQUONS PAS NOTRE RENDEZ-VOUS AVEC l'HISTOIRE - TOUS MOBILISÉS POUR LA TÉLÉVISION CHRÉTIENNE !
Les chrétiens protestants et évangéliques ont à leur disposition de puissants médias pour faire entendre leur voix dans le paysage audiovisuel français.
Un service de presse reconnu par l'Etat
Le Journal Chrétien est un service de presse en ligne bénéficiant d’un agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse du Ministère de la Culture. Il est membre du Syndicat de la Presse Indépendante d’Information en Ligne (SPIIL), un syndicat professionnel français créé en afin de défendre les intérêts professionnels des éditeurs de presse en ligne indépendants. Il fait partie des sources d'information officielles de Google actualités dans tous les pays francophones.Dans un paysage médiatique marqué par le mensonge et les fake news et les calomnies, le Journal Chrétien se positionne comme le média de la vérité qui passe l'information au tamis de l'Évangile. Nos journalistes et correspondants essaient de s'approcher de la vérité des faits avec beaucoup d'humilité. Le professionnalisme des experts impliqués dans le Journal Chrétien garantit une procédure de sélection de grande qualité et un suivi des projets très rigoureux. Quand les pasteurs et leurs églises sont victimes de dénonciations calomnieuses, le Journal Chrétien mène des investigations pour rétablir la vérité.
Une chaîne de télévision chrétienne incluse dans la Freebox
Votre soutien financier nous aidera à :
👍 produire des émissions de qualité pour sensibiliser et encourager ;
👍 accompagner les églises et communautés chrétiennes en difficulté ;
👍 transmettre l’héritage spirituel aux générations futures ;
👍 faire rayonner la foi chrétienne dans un esprit d’unité et d’amour.

Aidez-nous à porter la lumière de l'Evangile à la télévision !
Chrétiens TV, la chaîne de télévision chrétienne développée par le Journal Chrétien est diffusée sur le canal 246 de la Freebox en France. Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent nourrir leur réflexion, leur foi ou simplement découvrir des programmes porteurs de sens et de bienveillance. En faisant un don, petit ou grand, vous permettez à cette chaîne d’innover au quotidien pour une information toujours plus qualitative, plus d’émissions et de reportages édifiants, de décryptage de l’actualité et d’événements à la lumière de la Bible.
Ensemble, construisons un espace où la foi est honorée, respectée et protégée !

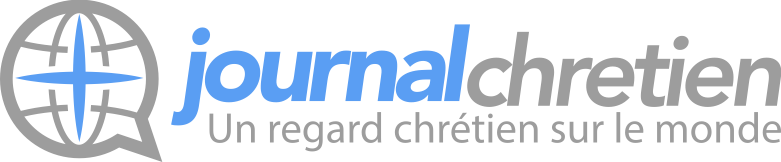






 JE FAIS UN DON MAINTENANT
JE FAIS UN DON MAINTENANT