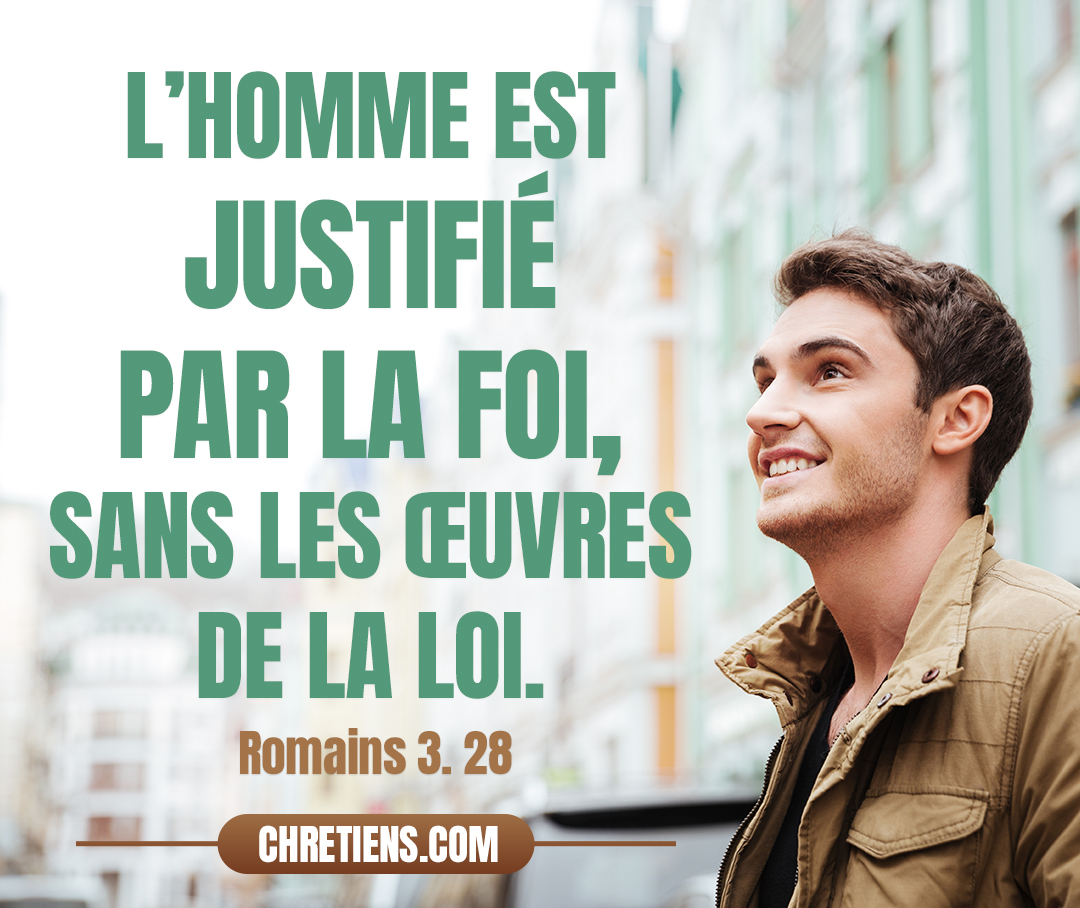Turquie: Erdogan veut expulser 10 ambassadeurs, dont celui de la France

par Daren Butler
ISTANBUL (Reuters) – Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé samedi avoir ordonné à son ministère des Affaires étrangères de déclarer « personae non gratae » dix ambassadeurs, dont le représentant de la France, qui ont appelé cette semaine à la libération immédiate de l’homme d’affaires Osman Kavala.
L’expulsion de ces 10 ambassadeurs, dont sept représentent des pays alliés de la Turquie au sein de l’Otan, constituerait la plus grave crise diplomatique avec l’Occident depuis l’accession au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan il y a 19 ans.
Osman Kavala est détenu sans condamnation depuis la fin 2017. Il est accusé de financement du mouvement de contestation de 2013 et d’implication dans la tentative de coup d’Etat de 2016. Il rejette ces accusations.
Dans une déclaration commune publiée lundi, les ambassadeurs de France, des Etats-Unis, d’Allemagne, du Canada, du Danemark, des Pays-Bas, de Norvège, de Suède, de Finlande et de Nouvelle-Zélande ont réclamé un règlement équitable et rapide de « l’affaire Kavala » qui « jette une ombre sur le respect de la démocratie » en Turquie et demandé la « libération urgente » de l’homme d’affaires.
Ils ont été convoqués le lendemain par le ministère turc des Affaires étrangères, qui a qualifié leur initiative d’irresponsable.
« J’ai donné l’ordre nécessaire à notre ministre des Affaires étrangères et dit ce qui devait être fait: ces 10 ambassadeurs doivent être déclarés personae non gratae sur le champ. Vous allez régler ça immédiatement », a dit Recep Tayyip Erdogan dans un discours à Eskisehir, dans le nord-ouest de la Turquie.
« Ils vont apprendre à connaître la Turquie », a-t-il ajouté sous les acclamations de la foule.
Les ambassades de France, d’Allemagne et des Etats-Unis n’ont pas répondu dans l’immédiat aux demandes de réaction.
« GRAVE DÉRIVE AUTORITAIRE », DIT SASSOLI
Le ministère norvégien des Affaires étrangères a déclaré que son ambassade en Turquie n’avait reçu aucune notification sur le sujet de la part des autorités turques.
« Notre ambassadeur n’a rien fait qui justifie une expulsion », a écrit la responsable de la communication du ministère, Trude Maaseide, dans un courriel adressé à Reuters, ajoutant qu’Ankara connaissait parfaitement la position de la Norvège sur le sujet.
Osman Kavala a été blanchi l’an dernier des accusations relatives aux manifestations de 2013 mais ce jugement a été annulé cette année et ce dossier a été joint à un autre relatif à la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 contre Recep Tayyip Erdogan.
Pour les organisations de défense des droits humains, le cas d’Osman Kavala est un symbole de la répression de toute opposition par le pouvoir turc.
En 2019, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a estimé que la détention de l’homme d’affaires ne reposait sur aucune preuve et avait un caractère politique. Elle a réclamé sa libération immédiate, une décision ignorée par la Turquie.
Six des pays concernés par cette querelle diplomatique sont membres de l’Union européenne. Sur Twitter, le président du Parlement européen, David Sassoli, a écrit un message accompagné du mot-clé « Liberté pour Osman Kavala »: « La décision du gouvernement turc d’expulser 10 ambassadeurs est le signe d’une grave dérive autoritaire. Nous ne nous laisserons pas intimider. »
Dans une déclaration écrite, Osman Kavala a jugé vendredi que cela n’aurait « aucun sens » pour lui d’assister à son futur procès en raison de l’impossibilité d’obtenir une procédure équitable à la suite de déclarations de Recep Tayyip Erdogan.
Le président turc a déclaré jeudi que les ambassadeurs réclamant la libération de l’homme d’affaires ne demanderaient pas celle de « bandits, d’assassins et de terroristes » dans leur propre pays.
La prochaine audience judiciaire concernant Osman Kavala est prévue le 26 novembre.
(Avec Nora Buli à Oslo et Foo Yun Chee à Bruxelles, version française Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)

SOUTENEZ LE JOURNAL CHRÉTIEN ET RÉDUISEZ VOS IMPÔTS !
Le Journal Chrétien est 100% gratuit. Faites un don régulier et aidez-nous à poursuivre notre mission.
Vous êtes nombreux à nous demander comment le Journal Chrétien est financé. Notre mission, vous le savez, est de diffuser gratuitement les valeurs de l’Evangile. Nos ressources proviennent exclusivement des dons de nos lecteurs.
Certains lecteurs ont pris l’habitude de nous adresser un don ponctuel. D’autres privilégient un versement mensuel. Beaucoup me disent prier pour nous. En réalité, le Journal Chrétien a besoin que tous ses lecteurs se mobilisent à la mesure de leurs moyens. Songez que pour un don mensuel de 15€, vous ne dépensez réellement que 5€ ! Et votre don est défiscalisé !
Alors si vous estimez comme que la mission du Journal Chrétien est indispensable, veuillez nous soutenir. Votre générosité par le passé a permis au Journal Chrétien d’accomplir de grandes choses.
En 2025, la chaîne de télévision Chrétiens TV développée par le Journal Chrétien a débarqué sur le Canal 246 de Free, deuxième opérateur en France. Des négociations sont en cours pour étendre la diffusion de la chaîne à l'ensemble des opérateurs français.
Votre soutien financier nous aidera à :
👍 couvrir les frais de fonctionnement du Journal Chrétien ;
👍 produire des émissions de qualité pour sensibiliser et encourager ;
👍 accompagner les églises et communautés chrétiennes en difficulté ;
👍 transmettre l’héritage spirituel aux générations futures ;
👍 faire rayonner la foi chrétienne dans un esprit d’unité et d’amour.

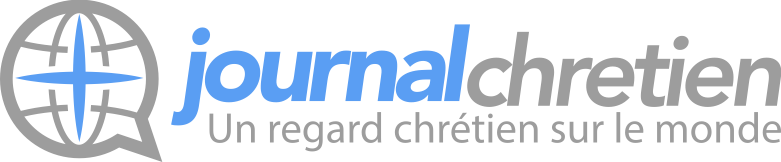





 JE FAIS UN DON MAINTENANT
JE FAIS UN DON MAINTENANT