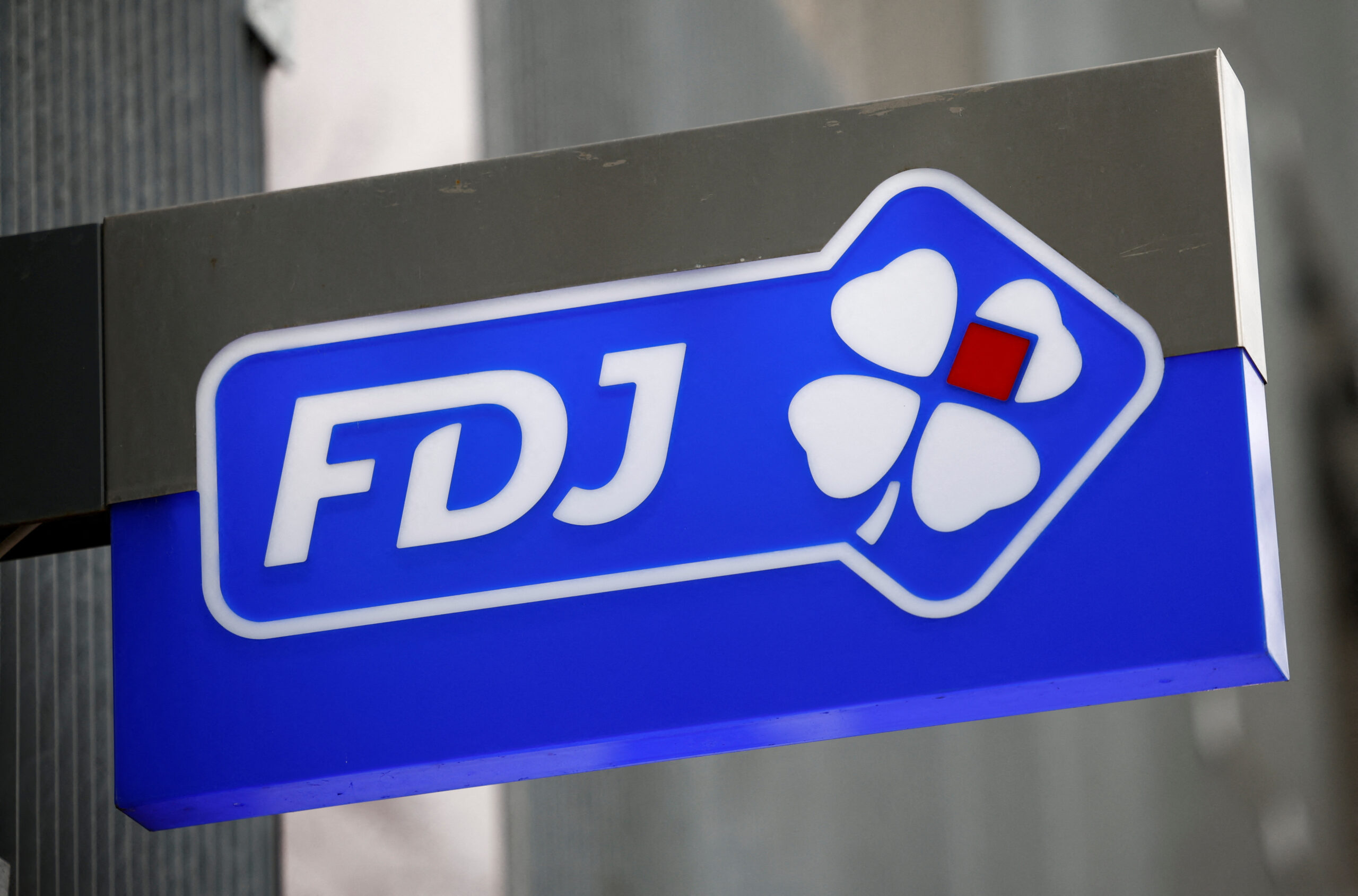L’art d’aller à l’essentiel
Ecrit par Léo Babauta avec comme titre original en anglais « The Power of Less », le choix de ce livre part d’un constat : « dans les différentes interactions sociales, les choses s’enlisent très souvent parce que beaucoup de personnes divaguent, s’attardent sur ce qui est accessoire ».
Ce livre, publié en 2010 aux éditions LEDUC, séduit par sa concision, sa simplicité et son pragmatisme.
Dans la table des matières, un mot revient plusieurs fois, c’est le verbe « simplifier ». Peut-être que l’auteur voudrait encourager les lecteurs à se simplifier la vie en se débarrassant du superflu, de ce qui encombre pour être enfin … productif.
Ce livre, plein de trucs pratiques, voudrait simplifier la vie de tout un chacun le rendant plus efficace et de moins en moins stressé.
Vous y trouverez les 6 principes de base de la simplification et des astuces pour faire des gains de temps énormes.
Dans la première partie, l’auteur parle des 6 principes théoriques de sa méthode : en faire moins pour accomplir plus (1), se fixer des limites (2), s’occuper seulement de l’essentiel (3), faire une seule chose à la fois (4), changer ses habitudes (5), commencer petit (6).
Dans la seconde partie, Babauta passe à la pratique en suggérant des actions à mener pour simplifier sa vie. Elles consistent à :
– Se concentrer sur un objectif à la fois
– Définir chaque jour les 3 tâches les plus importantes, celles que l’on doit faire quitte à ne pas aller dormir avant d’y être arrivé
– Simplifier la gestion de son temps
– Simplifier la gestion des emails et conservez sa boîte de réception vide
– Simplifier Internet pour apprendre à en faire un outil efficace
– Simplifier son archivage.
– Simplifier ses engagements et ses obligations.
– Mettre en place des routines
– Simplifier son espace de travail.
L’art d’aller à l’essentiel, c’est savoir consacrer du temps à ce qui est primordial, aux choses les plus importantes de la vie pour vraiment les apprécier.
Vous aimez nos publications ? Engagez-vous !
Les systèmes politiques et médiatiques ont besoin que s'exercent des contre-pouvoirs. Une majorité de journaux, télévisions et radios appartiennent à quelques milliardaires ou à des multinationales très puissantes souhaitant faire du profit, privant les citoyens d’un droit fondamental : avoir accès à une information libre de tout conflit d’intérêt.Le Journal Chrétien, service de presse en ligne bénéficiant d’un agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse du Ministère de la Culture, assure un contre-pouvoir à l’ensemble des acteurs sociaux, en vérifiant les discours officiels, en décryptant l'actualité, en révélant des informations de première importance ou en portant le témoignage des dominés.
La qualité de notre travail est reconnu par les médias séculiers. Dernièrement, le président du Journal Chrétien a accordé une longue interview à Sud Ouest, le deuxième quotidien régional français avec une diffusion totale de 219 000 exemplaires.
ENGAGEZ VOUS !
Quand les évangéliques sont attaqués, calomniés ou traités avec mépris par les médias traditionnels, un silence de notre part ne serait pas chrétien. Une telle attitude montrerait un renoncement suspect à se faire respecter et à exiger des médias mondains un tel respect.Lorsque les pasteurs et les églises évangéliques sont attaqués, le critère de la solidarité chrétienne doit jouer. Comment nous dire membres du Corps du Christ si nous restons indifférents à la persécution de certains d’entre nous, souvent réduits au silence et incapables de faire valoir leurs droits ou, tout simplement, de se faire respecter comme chrétiens ou communautés évangéliques ?
En s'appuyant sur notre plateforme de médias, l’action sur l’opinion publique est évidemment essentielle. Faire savoir est la condition de toute action, car rien n’est pire que le silence. D’où l’importance de l’action en direction des médias, des institutions et des populations.
Evidemment, ici comme ailleurs, la réticence de la part des chrétiens à agir comme des groupes de pression constitue une difficulté majeure. Mais, là encore, ne faudrait-il pas s’interroger sur notre dispersion et nos réticences à agir comme lobby, quand il s’agit de défenses des libertés et droits humains fondamentaux ?
Vous pouvez soutenir notre action :
- en faisant un don ponctuel ou régulier.
- en rejoignant notre équipe comme analyste, expert, professionnel de l'audiovisuel, défenseur des droits de l'homme, journaliste, théologien, etc.
- en priant pour nous.
- en nous contactant par email à l'adresse [email protected] ou par téléphone au par téléphone au +33 769138397
 JE FAIS UN DON
JE FAIS UN DON