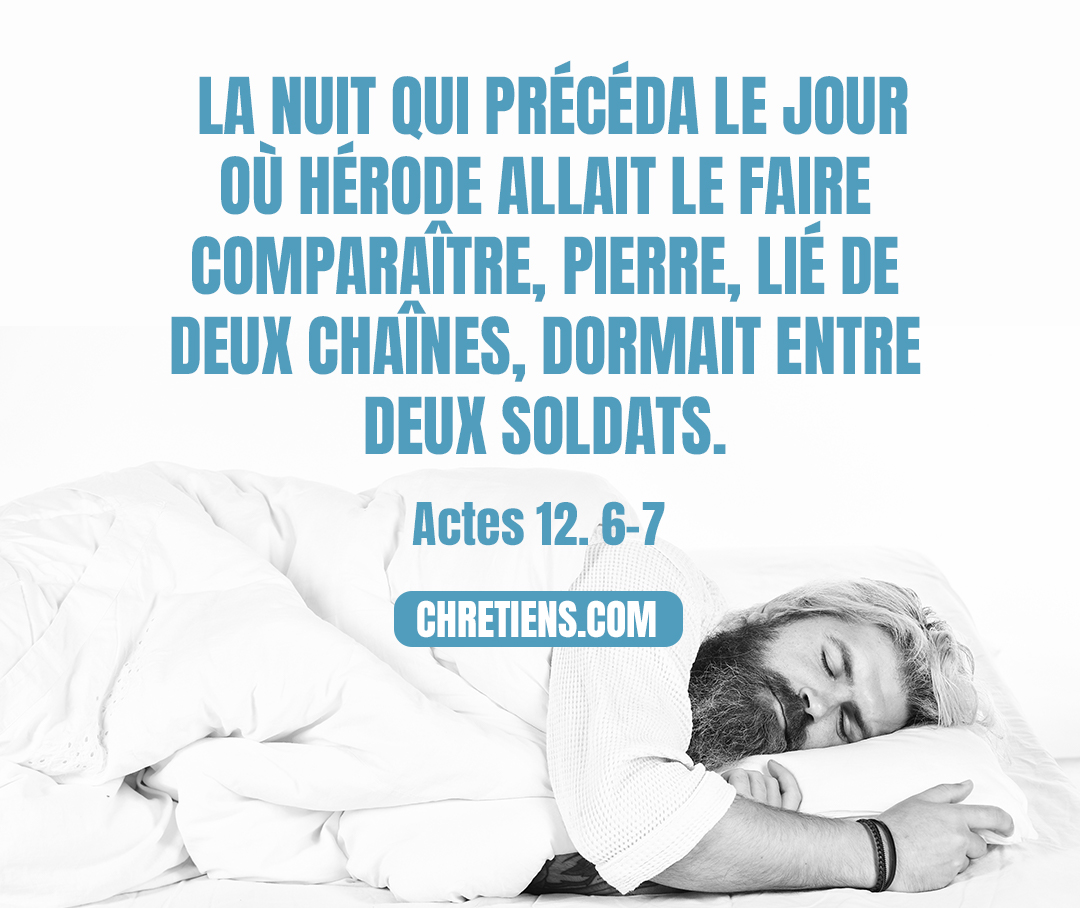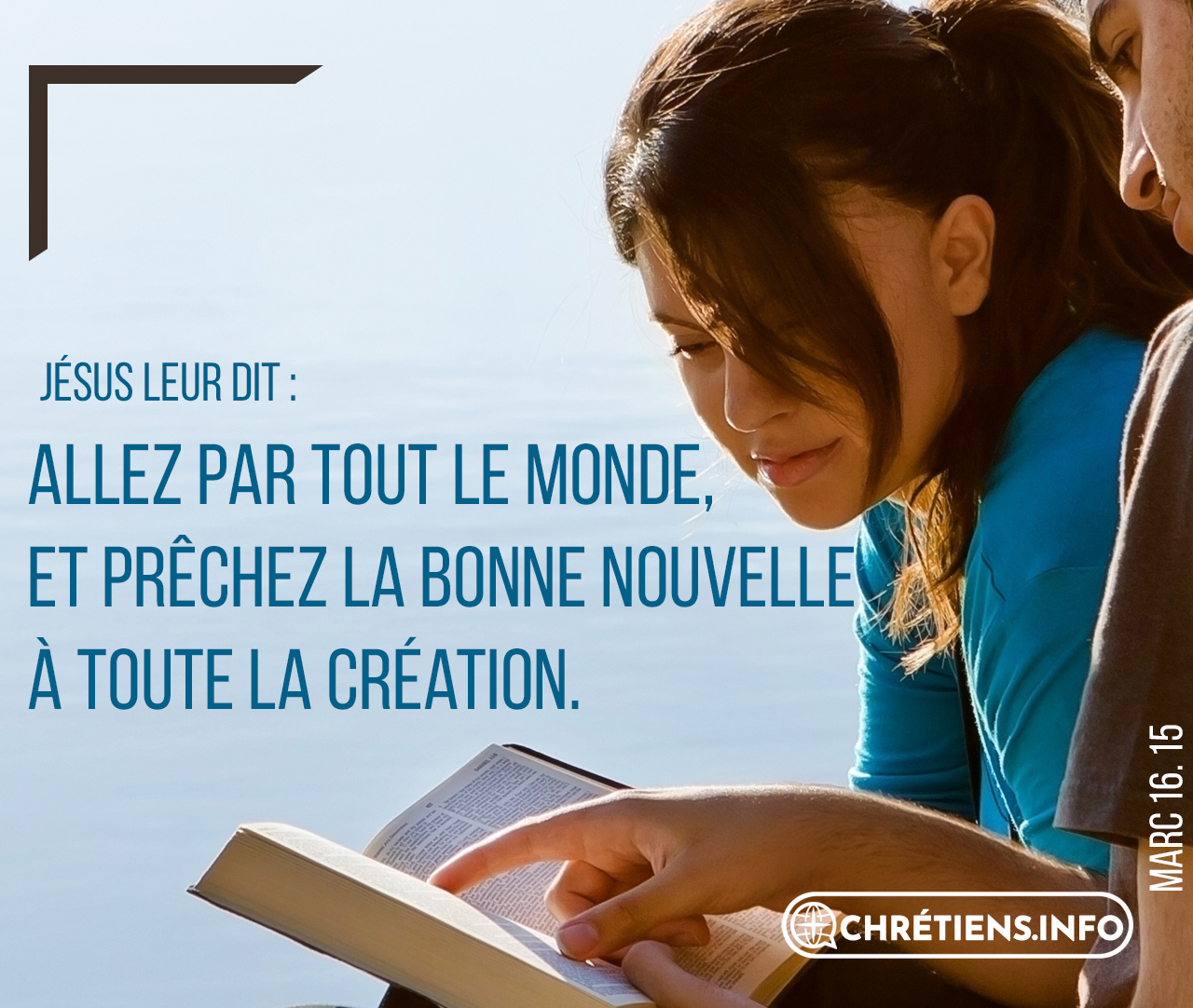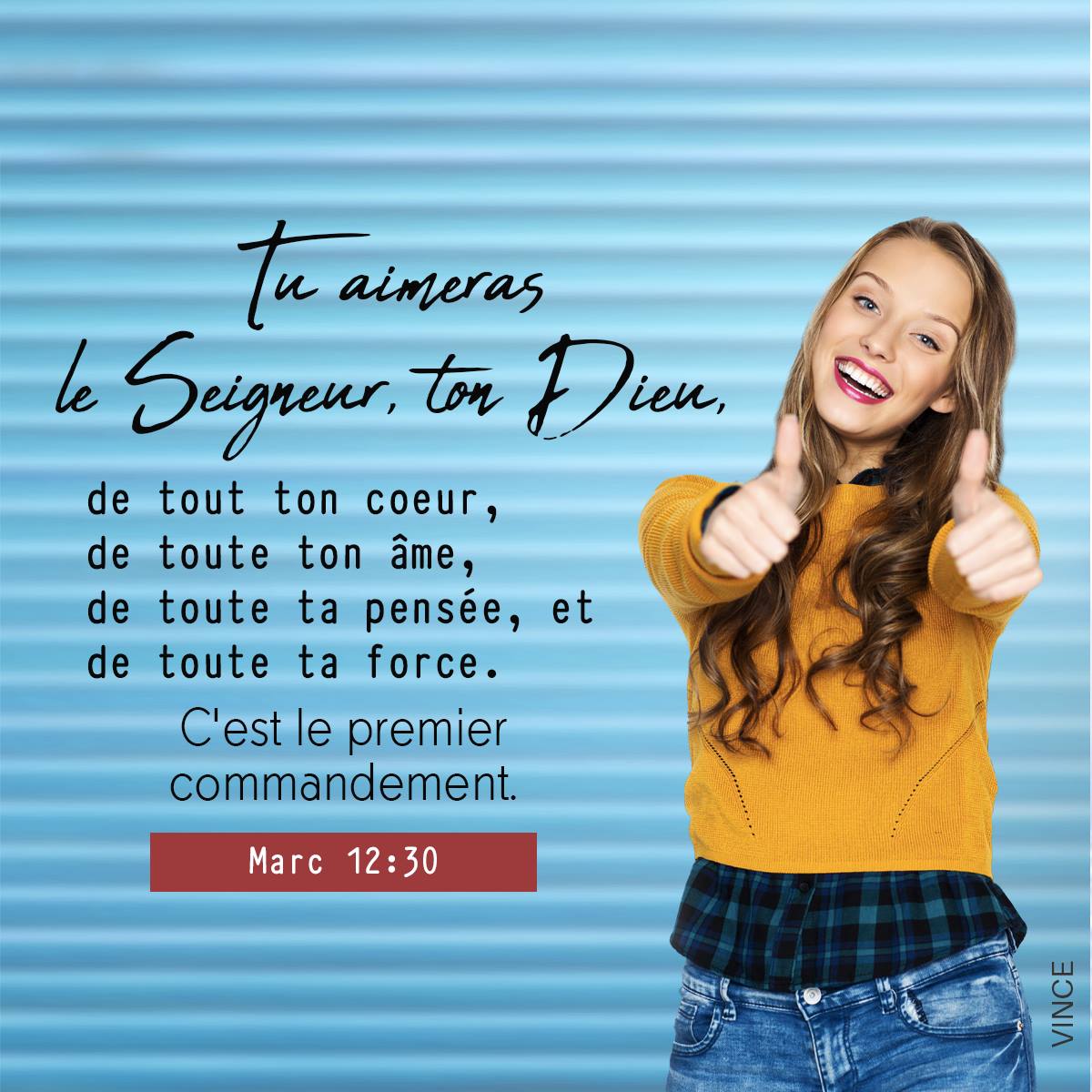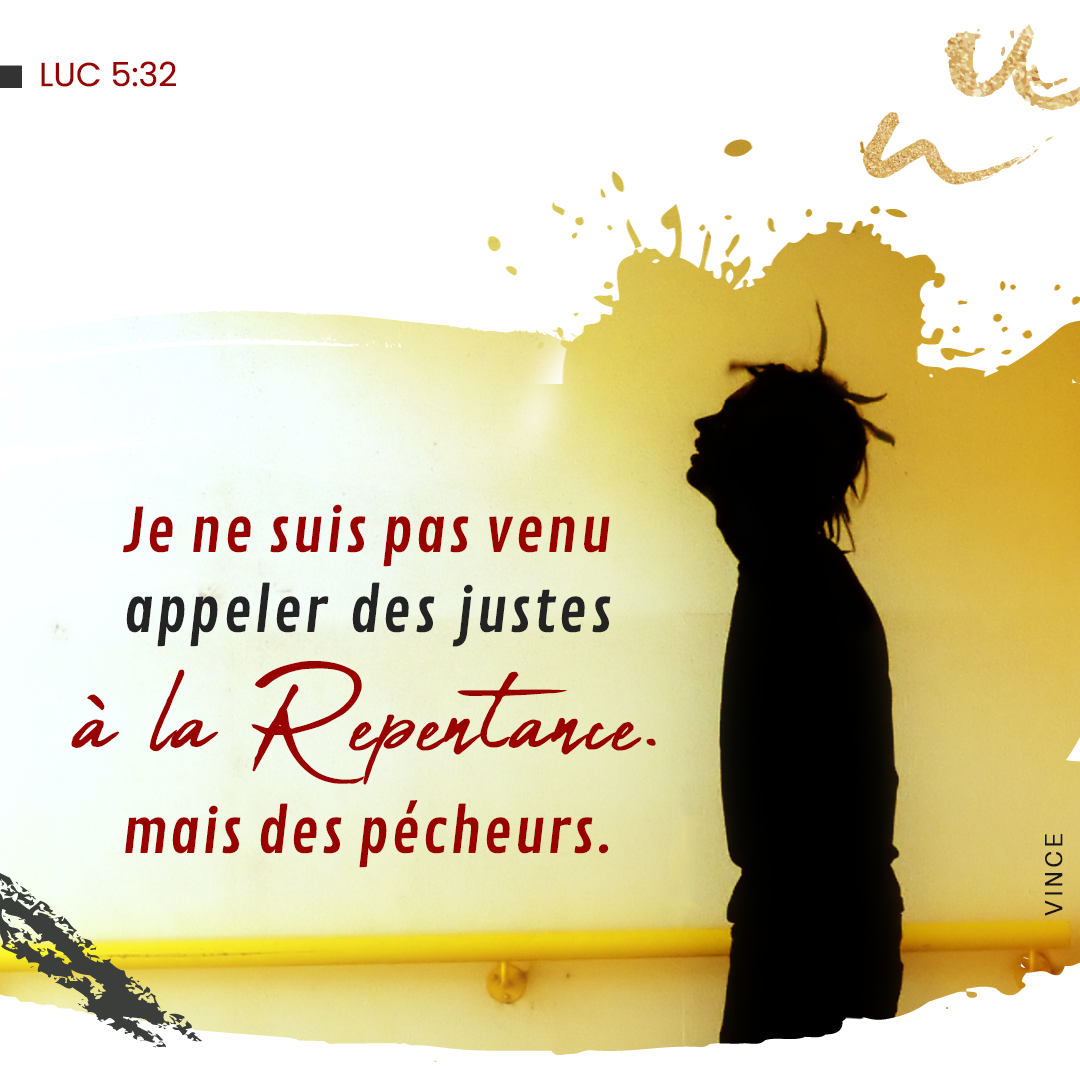Le président ivoirien Alassane Ouattara console ses compatriotes après la défaite des Eléphants

Le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé mardi ses compatriotes à ne pas céder au découragement après la lourde défaite des Eléphants de Côte d’Ivoire face à la Guinée équatoriale lors du troisième match de groupe à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023.
« Nous avons été déçus par le match des Eléphants (lundi), mais ce n’est que partie remise. Nous avons une jeune équipe, qui va s’améliorer au fil des années. Je voudrais donc dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager », a-t-il écrit sur le réseau social X.
« Comme le président (Félix) Houphouët-Boigny nous le disait toujours, ‘découragement n’est pas ivoirien’. Nous avons déjà remporté la CAN deux fois, en 1992 et en 2015. Et je suis sûr que nous la remporterons une troisième fois, très bientôt », a ajouté M. Ouattara en invitant l’ensemble des Ivoiriens à garder espoir.
Malgré l’humiliation subie face à la Guinée équatoriale (0-4), les joueurs de la sélection nationale ivoirienne maintiennent l’espoir de se qualifier en tant que l’une des meilleures équipes classées troisièmes. Tout se jouera ce mercredi.
En effet, parmi les six groupes, les quatre meilleures équipes classées troisièmes accèderont au tableau final de la CAN 2023. Théoriquement, avec seulement trois points et une différence de buts négative, les Eléphants ne semblent pas être en lice. Cependant, le scénario dans le groupe B lundi a ravivé les espoirs du pays hôte : le Ghana, en concédant un match nul 2-2 face au Mozambique, termine à la troisième place de ce groupe avec seulement deux points, plaçant ainsi une nation derrière la Côte d’Ivoire au classement des troisièmes.
Seuls deux groupes doivent encore définir leur qualification en 8e de finale. Dans le groupe E, une défaite de la Tunisie contre l’Afrique du Sud combinée à un revers de la Namibie face au Mali serait un atout majeur pour les hommes du sélectionneur Jean-Louis Gasset.

SOUTENEZ LE JOURNAL CHRÉTIEN ET RÉDUISEZ VOS IMPÔTS !
Le Journal Chrétien est 100% gratuit. Faites un don régulier et aidez-nous à poursuivre notre mission.
Vous êtes nombreux à nous demander comment le Journal Chrétien est financé. Notre mission, vous le savez, est de diffuser gratuitement les valeurs de l’Evangile. Nos ressources proviennent exclusivement des dons de nos lecteurs.
Certains lecteurs ont pris l’habitude de nous adresser un don ponctuel. D’autres privilégient un versement mensuel. Beaucoup me disent prier pour nous. En réalité, le Journal Chrétien a besoin que tous ses lecteurs se mobilisent à la mesure de leurs moyens. Songez que pour un don mensuel de 15€, vous ne dépensez réellement que 5€ ! Et votre don est défiscalisé !
Alors si vous estimez comme que la mission du Journal Chrétien est indispensable, veuillez nous soutenir. Votre générosité par le passé a permis au Journal Chrétien d’accomplir de grandes choses.
En 2025, la chaîne de télévision Chrétiens TV développée par le Journal Chrétien a débarqué sur le Canal 246 de Free, deuxième opérateur en France. Des négociations sont en cours pour étendre la diffusion de la chaîne à l'ensemble des opérateurs français.
Votre soutien financier nous aidera à :
👍 couvrir les frais de fonctionnement du Journal Chrétien ;
👍 produire des émissions de qualité pour sensibiliser et encourager ;
👍 accompagner les églises et communautés chrétiennes en difficulté ;
👍 transmettre l’héritage spirituel aux générations futures ;
👍 faire rayonner la foi chrétienne dans un esprit d’unité et d’amour.

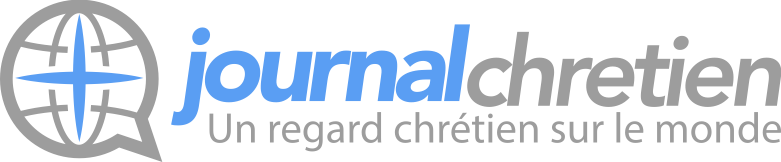





 JE FAIS UN DON MAINTENANT
JE FAIS UN DON MAINTENANT