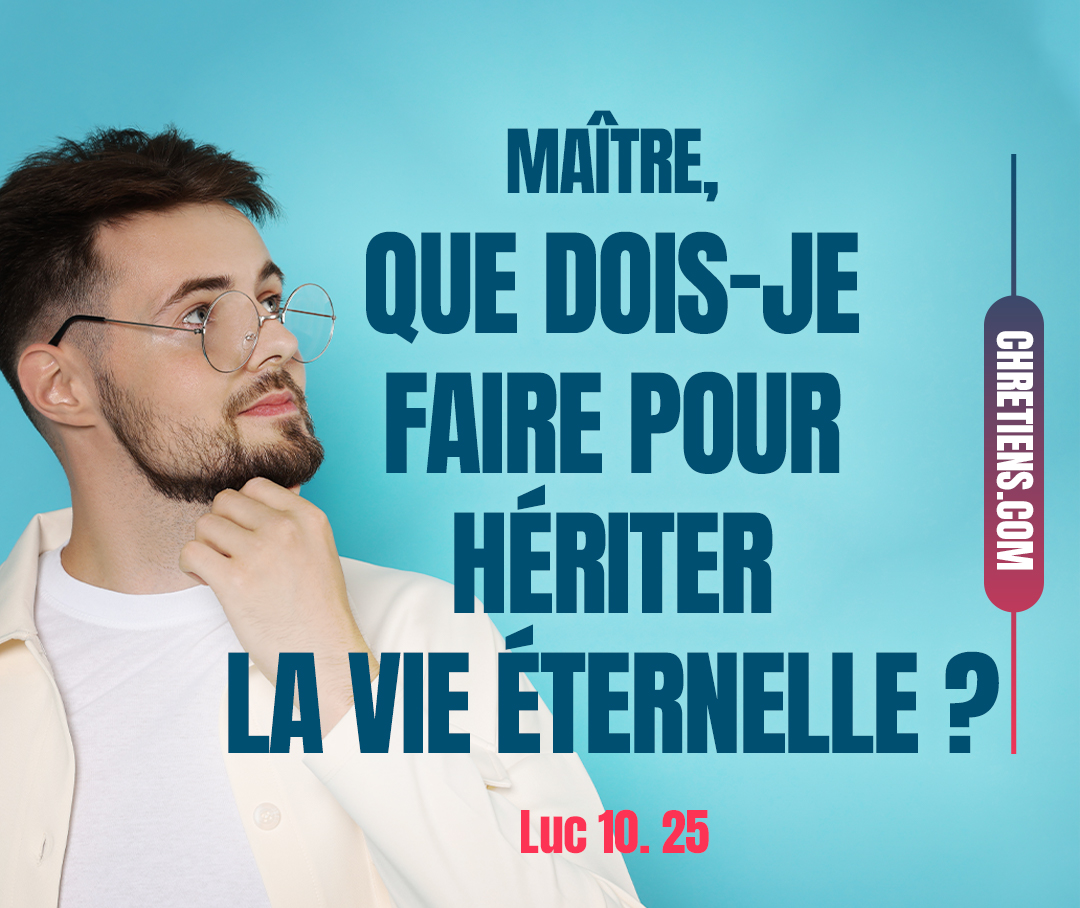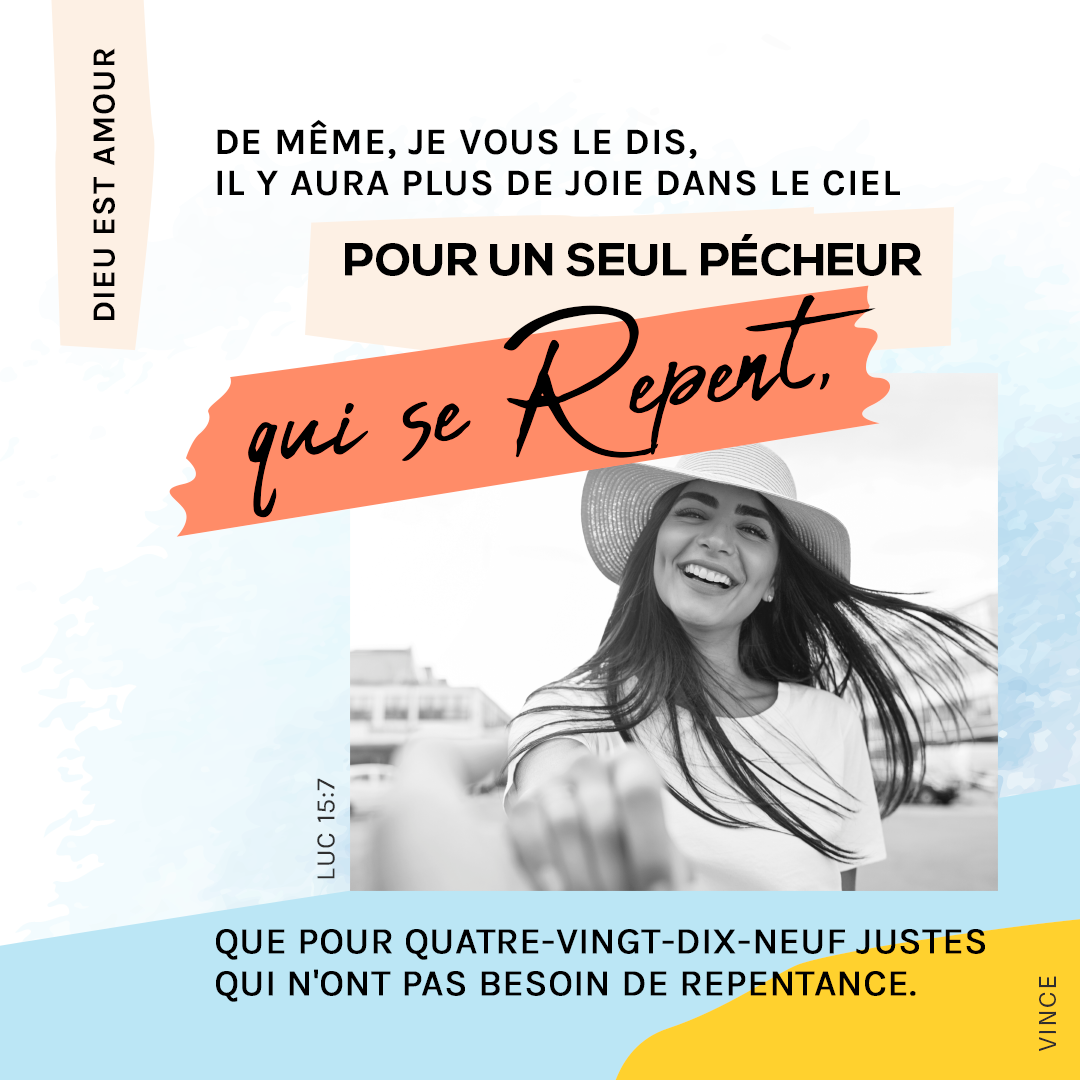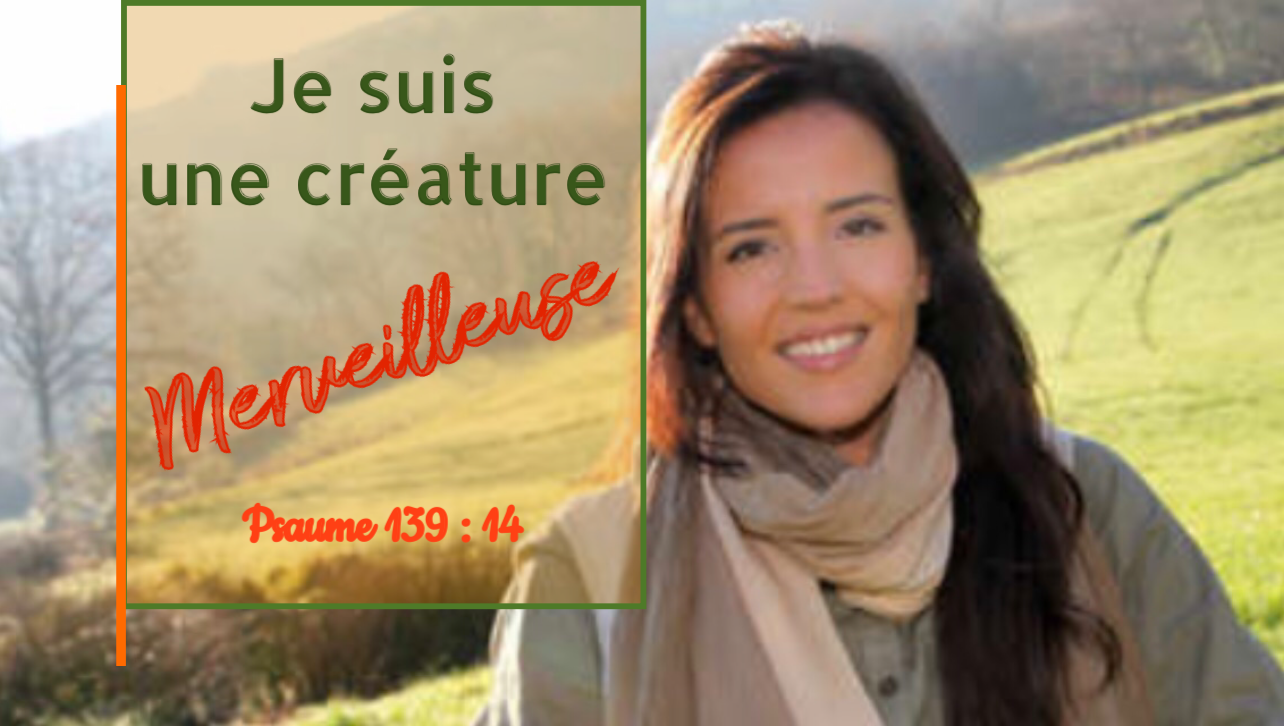Covid-19: Casse-tête sur la 2e dose après les restrictions pour le vaccin d’AstraZeneca

Plusieurs pays européens envisagent d’administrer des deuxièmes doses de vaccins contre le COVID-19 différentes des premières, certaines personnes ayant reçu une primo-injection d’AstraZeneca n’étant désormais plus éligibles à ce vaccin réservé aujourd’hui à des populations plus âgées.
L’Agence européenne du médicament (EMA) doit présenter ce mercredi lors d’une conférence à 16h00 (14h00 GMT) ses conclusions actualisées de pharmacovigilance sur le vaccin d’AstraZeneca et son lien éventuel avec la formation de caillots sanguins.
Suspendu quelques jours dans plusieurs pays le mois derniers sur fond d’inquiétudes sur un éventuel risque thromboembolique, le vaccin du laboratoire anglo-suédois a ensuite été réintégré dans la plupart des campagnes de vaccinations nationales après que l’EMA a réaffirmé sa balance bénéfices-risques favorable.
Mais le recours à ce vaccin développé en collaboration avec l’université d’Oxford, rebaptisé Vaxzeria, a alors été souvent limité aux populations les plus âgées, les cas de formations de caillots ou de thromboses veineuses, notamment cérébrales, ayant principalement été observés chez des femmes de moins de 55 ans.
Conséquence: un casse-tête pour les décideurs, contraints d’adapter la stratégie vaccinale pour les personnes ayant bénéficié d’une primo-injection avec le vaccin d’AstraZeneca mais n’étant plus éligibles pour le rappel du fait de leur âge.
RESPONSABILITÉ ENGAGÉE
Sans compter que toute administration d’un vaccin ne respectant pas les conditions définies par l’EMA serait considérée comme une utilisation hors autorisation de mise sur le marché, non validée. Les éventuels effets indésirables enregistrés relèveraient alors de la responsabilité des pays concernés.
Pour certains experts, l’utilisation de deux vaccins différents ne serait pas contre-indiquée dans la mesure où ils ciblent tous la même protéine Spike du virus SARS-CoV-2. Il n’existe en revanche aucune preuve que la production d’anticorps serait alors aussi importante que lorsque le système immunitaire a été stimulé avec un seul et même vaccin.
En France, où la vaccination concerne les plus de 70 ans depuis fin mars (contre les seuls plus de 75 ans auparavant), le vaccin d’AstraZeneca est désormais réservés aux personnes de 55 ans à 69 ans considérées comme prioritaires au vu de leur profil (comorbidités, personnel soignant, etc.) ainsi qu’à l’ensemble des personnes de plus de 70 ans.
Cela représenterait des centaines de milliers de personnes, pour lesquelles il faudra définir une stratégie avant le début du mois de mai – soit 12 semaines après les premières administrations d’AstraZeneca dans l’Hexagone.
Selon deux sources au fait de l’organisation de la campagne vaccinale, la Haute autorité de santé (HAS) française réfléchirait à utiliser dans ce cas-là les vaccins à ARN messager (ARNm) de Pfizer et BioNTech ou celui de Moderna pour la deuxième dose.
Ce point n’a pas encore été tranché, a ajouté une des sources, en précisant que les experts attendaient de disposer de davantage de données, notamment les résultats d’un essai britannique lancé en février pour analyser les effets d’une combinaison des vaccins AstraZeneca et Pfizer.
L’ALLEMAGNE A DÉJÀ AUTORISÉ LE « MIX » VACCINAL
Mais la date de publication des premiers résultats de cette étude n’est pas encore connue et la HAS n’a pas souhaité faire de commentaire.
A l’inverse, l’Allemagne a été le premier pays de l’Union européenne à recommander, dès la semaine dernière, l’utilisation d’une deuxième dose produite par un autre laboratoire chez les plus de 60 ans dont la première injection a été faite avec du vaccin AstraZeneca.
La Grande-Bretagne avait autorisé ce schéma vaccinal dans certaines circonstances dès la fin de l’année dernière, mais n’a pas eu besoin d’y avoir recours pour l’instant.
La précédente synthèse de l’EMA, rendue publique le 31 mars, portait sur 258 cas sérieux de troubles thromboemboliques, dont 45 mortels, sur un total de près de 20 millions de primo-injections réalisées dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.
L’agence avait alors conclu qu’il n’existait à date pas de lien avéré entre ce vaccin, développé en partenariat avec l’université d’Oxford, et ce risque thrombotique.
A ce stade, ses travaux n’avaient pas non plus permis d’identifier d’éventuels facteurs de risques favorisant les troubles thromboemboliques.
(Avec Emilio Parodi à Milan; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)
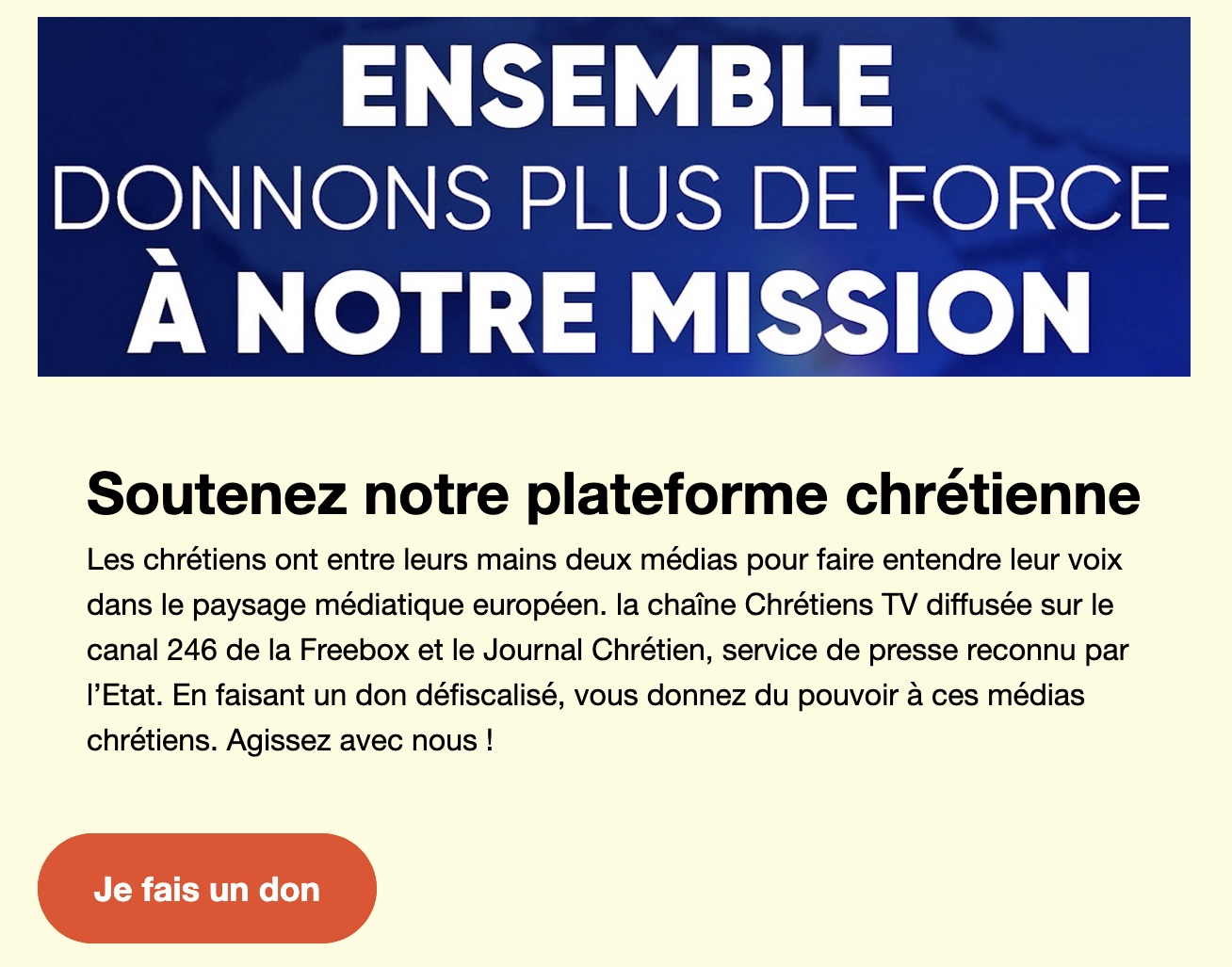
Faites un don maintenant pour nous aider à poursuivre notre mission !
Dans un paysage médiatique marqué par le mensonge, les fake news, les calomnies et les attaques contre les Evangéliques, le Journal Chrétien se positionne comme le média de la vérité qui propose une information indépendante et fiable, non biaisée par des intérêts d'actionnariat ou publicitaires.Les chrétiens protestants et évangéliques ont longtemps sous-estimé le pouvoir des médias. Les récentes polémiques concernant des reportages à charge contre les plus grandes églises évangéliques françaises posent la question des intentions des patrons des médias, de ces milliardaires qui ont surinvesti ce champ de bataille idéologique.
Ne perdons pas la bataille idéologique
Les achats de médias par des milliardaires ne sont pas toujours motivés par la rentabilité financière, mais plutôt par des intérêts idéologiques. Ils achètent les médias pour influencer l'opinion publique, mener des batailles culturelles et maintenir leur pouvoir économique et social.Les évangéliques pris pour cible
L’influence grandissante des évangéliques gêne certains patrons des médias qui, disons-le, sont engagés dans des loges ou des sectes pernicieuses. Très puissante aux États-Unis, où de nombreuses personnalités ont renoncé à l'occultisme et à la débauche pour se convertir à la foi évangélique, la percée de cette frange chrétienne de plus en plus présente en France fait trembler le monde des ténèbres.Faire contrepoids
A l'heure actuelle, les chaînes d’info font l’agenda, nourrissent les réseaux sociaux, orientent les débats publics. Le Journal Chrétien et sa chaîne Chrétiens TV veulent aller sur leur terrain en investissant la sphère politique et médiatique pour y proposer une autre hiérarchie de l’information. Il est question de mener la bataille culturelle pour faire contrepoids aux groupes de médias hostiles aux Evangéliques.A quoi serviront vos dons ?
Nous avons l’ambition de développer une plateforme de médias suffisamment compétitive. Vos dons nous permettront de créer des émissions chrétiennes de qualité, de réaliser plus d’investigation, de reportages et d’enquêtes de terrain, d'organiser des débats sur des sujets de société, et de recruter du personnel compétent.Il nous faudra également développer davantage notre présence sur le terrain, produire plus de reportages, investir dans du matériel.
Le Journal Chrétien est un média libre, indépendant, sans publicité, accessible à tous grâce à la fidélité et à la générosité de ses lecteurs.
Votre don (défiscalisable à 66%), petit ou grand, est plus qu’un geste. C’est un acte militant et chrétien !
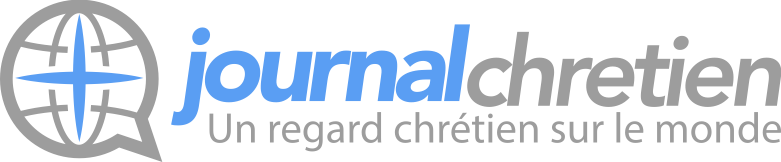

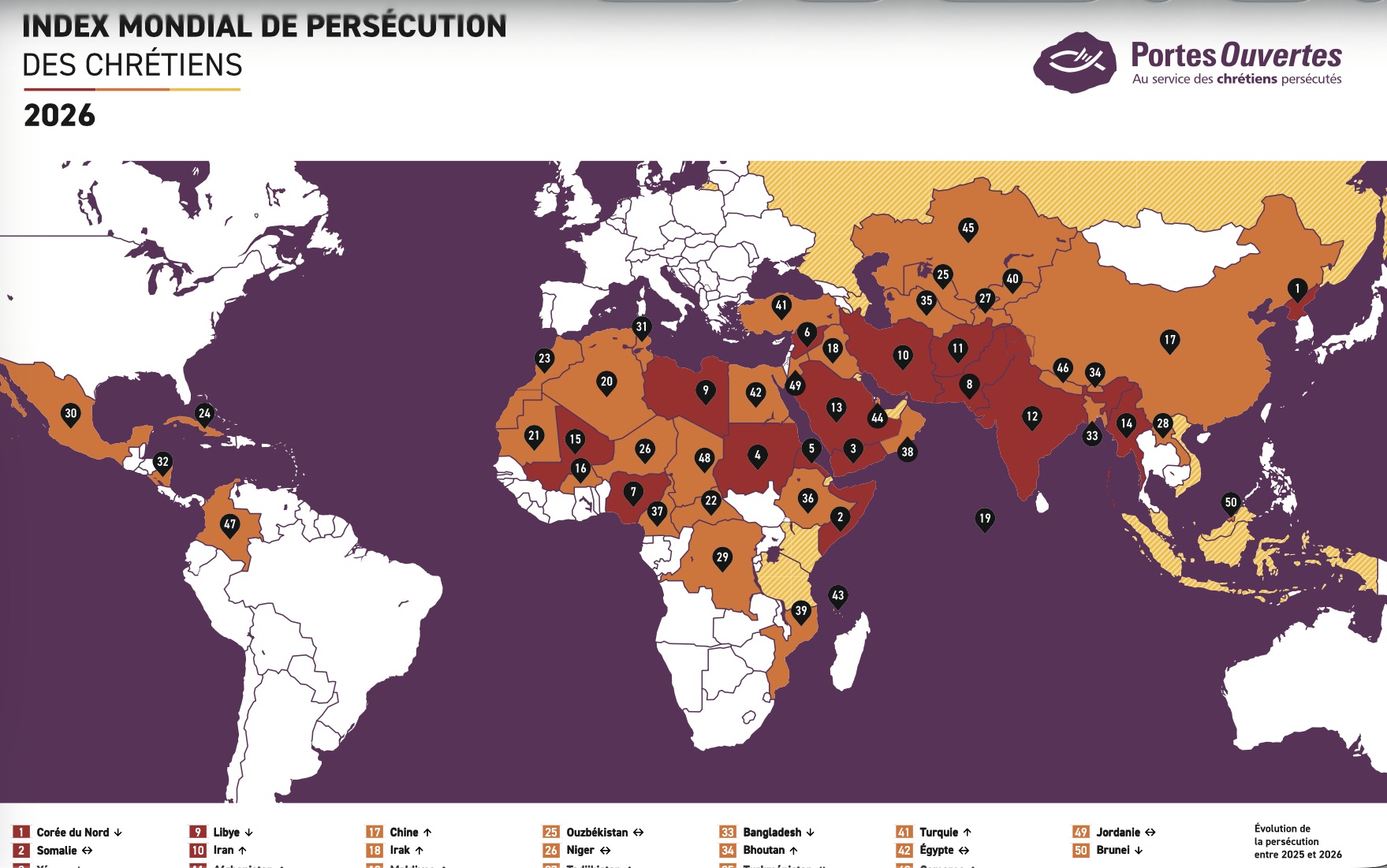



 JE FAIS UN DON MAINTENANT
JE FAIS UN DON MAINTENANT