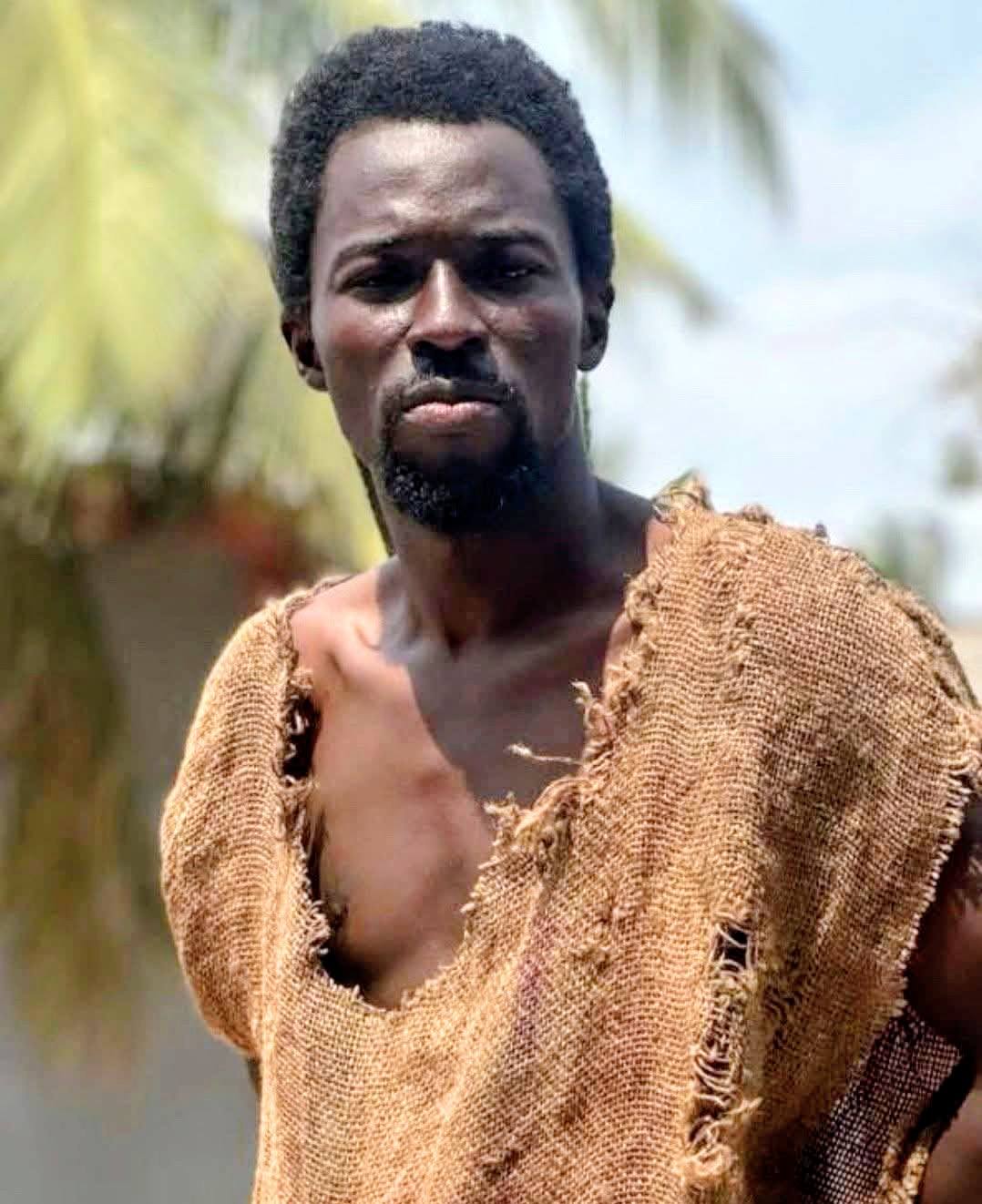François Bayrou propose une « banque » de parrainages pour la présidentielle
❤️ Nouveau: Soutenez la campagne de dons du Journal Chrétien
François Bayrou a annoncé jeudi la création d’une banque de parrainages pour les candidats à l’élection présidentielle toujours en quête des 500 paraphes nécessaires, estimant qu’il serait « scandaleux » que Marine Le Pen, Eric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon ne puissent concourir le 10 avril.
Pour l’heure, seuls le président sortant Emmanuel Macron, la candidate des Républicains (LR) Valérie Pécresse et la candidate socialiste Anne Hidalgo disposent de leurs parrainages.
Les autres candidats ont jusqu’au 4 mars pour recueillir leur sésame. Le système des parrainages existe depuis la première élection présidentielle au suffrage direct.
La « présentation » de cent élus était d’abord exigée pour empêcher une multiplication des candidatures, avant une réforme de 1976, régulièrement critiquée, portant ce nombre à 500.
« L’idée que je propose, c’est que des maires se regroupent pour dire ‘nous nous sommes prêts à examiner cette situation et s’il manque des signatures, nous sommes prêts regroupés que nous sommes, sans soutien politique (…), à répartir entre nous les signatures nécessaires », a expliqué François Bayrou sur BFM TV.
« C’est une banque de parrainages démocratique. Ce mouvement-là, je propose qu’on l’appelle ‘Notre Démocratie’, on va créer un site notredemocratie.fr, ce matin », a-t-il indiqué.
Un formulaire requérant l’état-civil de l’élu, sa fonction, son adresse postale et son adresse mail, avec une case « commentaire », était disponible jeudi matin à cette adresse.
Le Haut-commissaire au Plan propose que bénéficient de ce « prêt » les candidats crédités d’au moins 10% des intentions de vote dans les sondages.
« Je ne peux pas supporter l’idée que la démocratie soit ainsi déséquilibrée, déstabilisée », a plaidé l’ancien ministre centriste.
« Je ne suis pas de l’avis politique de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen, d’Eric Zemmour (…) mais je trouverais anormal, et même scandaleux, qu’ils ne puissent pas se présenter », a souligné le maire de Pau (Pyrénées-Atlantiques) et président du Mouvement Démocrate (MoDem).
(Rédigé par Sophie Louet, édité par Jean-Michel Bélot)

Faites un don maintenant pour nous aider à poursuivre notre mission !
Les chrétiens protestants et évangéliques ont longtemps sous-estimé le pouvoir des médias. Les récentes polémiques concernant des reportages à charge contre les plus grandes églises évangéliques françaises pose la question des intentions des patrons des médias, de ces milliardaires qui ont surinvesti ce champ de bataille idéologique.
Ne perdons pas la bataille idéologique
Les achats de médias par des milliardaires ne sont pas toujours motivés par la rentabilité financière, mais plutôt par des intérêts idéologiques. Ils achètent les médias pour influencer l'opinion publique, mener des batailles culturelles et maintenir leur pouvoir économique et social.Les évangéliques pris pour cible
L’influence grandissante des évangéliques gêne certains patrons des médias qui, disons-le, sont engagés dans des loges ou des sectes pernicieuses. Très puissante aux États-Unis, où de nombreuses personnalités ont renoncé à l'occultisme et à la débauche pour se convertir à la foi évangélique, la percé de cette frange chrétienne de plus en plus présente en France fait trembler le monde des ténèbres.Faire contrepoids
A l'heure actuelle, les chaînes d’info font l’agenda, nourrissent les réseaux sociaux, orientent les débats publics. Le Journal Chrétien et sa chaîne Chrétiens TV veulent aller sur leur terrain en investissant la sphère politique et médiatique pour y proposer une autre hiérarchie de l’information. Il est question de mener la bataille culturelle pour faire contrepoids aux groupes de médias hostiles aux Evangéliques.A quoi serviront vos dons ?
Nous avons l’ambition de développer une plateforme de médias suffisamment compétitive. Vos dons nous permettront de créer des émissions chrétiennes de qualité, de réaliser plus d’investigation, de reportages et d’enquêtes de terrain, d'organiser des débats sur des sujets de société, et de recruter du personnel compétent.Il nous faudra également développer davantage notre présence sur le terrain, produire plus de reportages, investir dans du matériel.
Le Journal Chrétien est un média libre, indépendant, sans publicité, accessible à tous grâce à la fidélité et à la générosité de ses lecteurs.
Votre don (défiscalisable à 66%), petit ou grand, est plus qu’un geste. C’est un acte militant et chrétien !
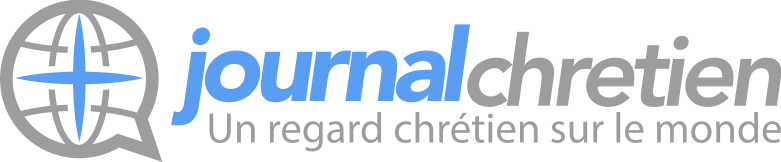





 FAIRE UN DON AU JOURNAL CHRETIEN
FAIRE UN DON AU JOURNAL CHRETIEN