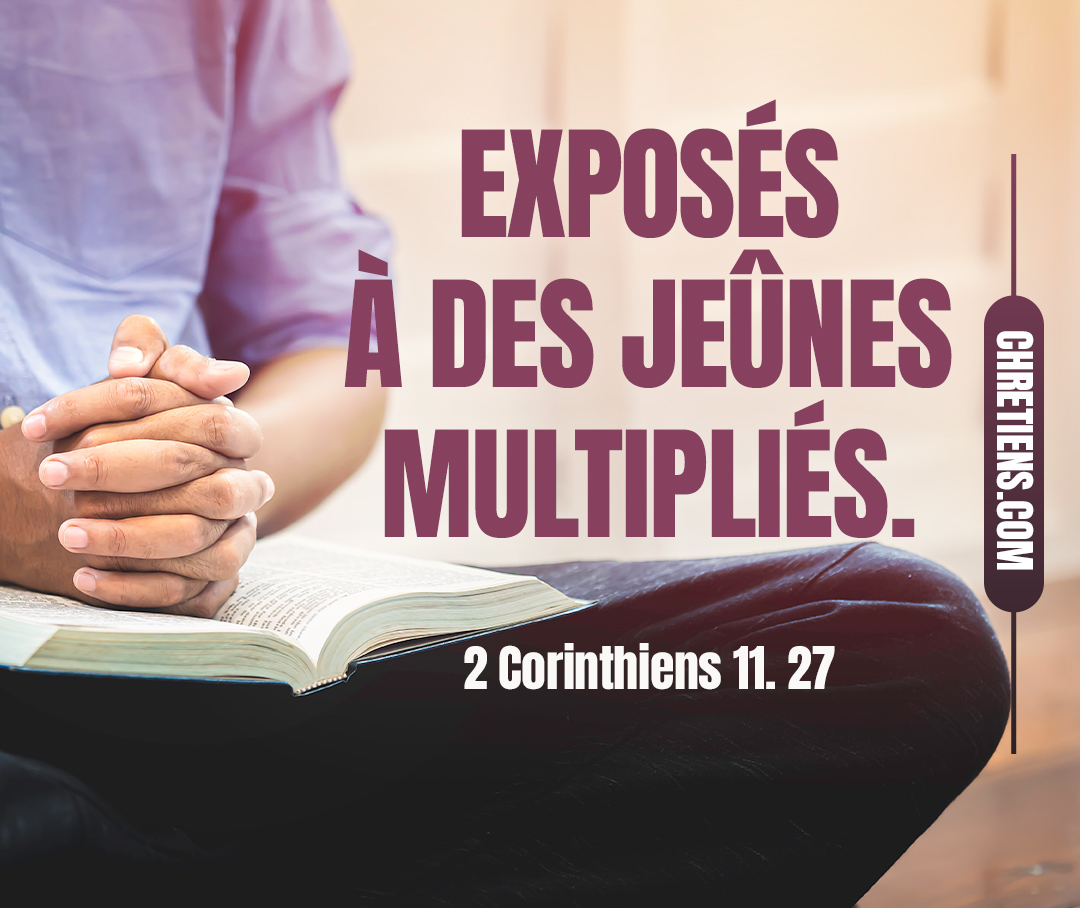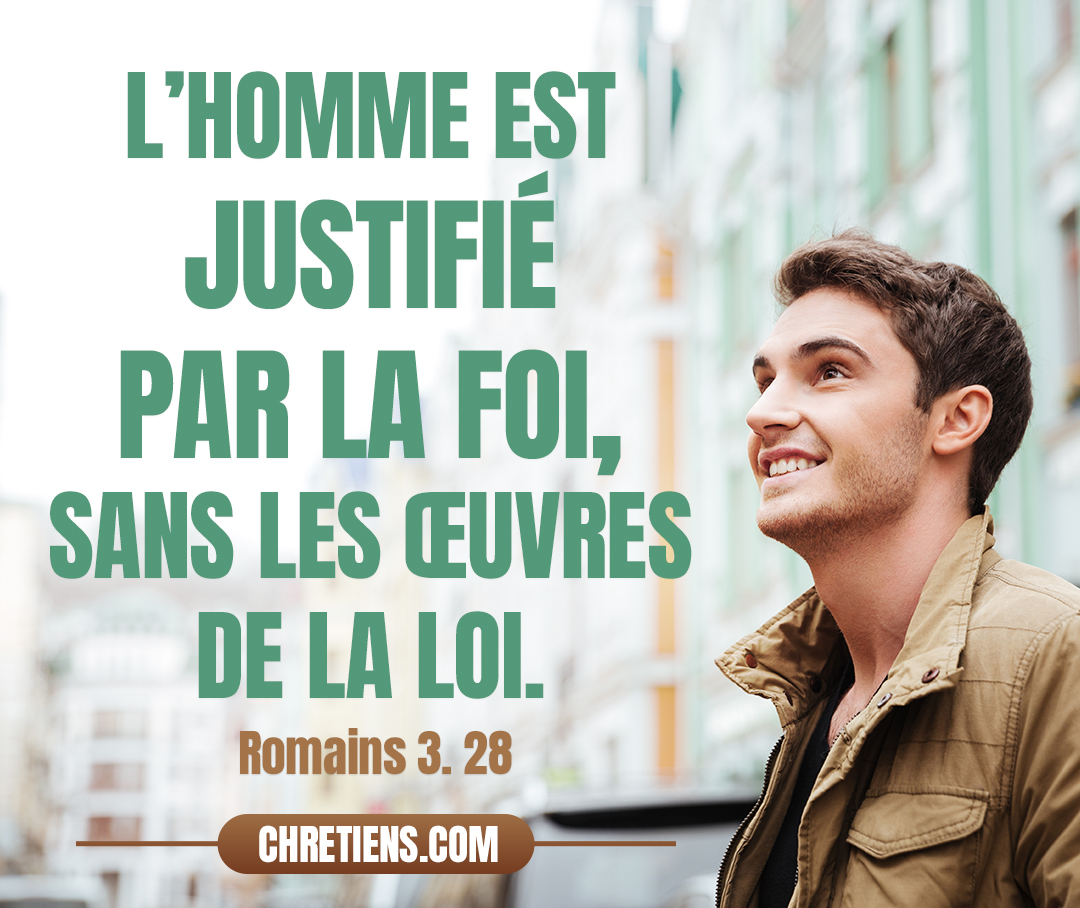Entretien de Recep Tayyip Erdogan avec Vladimir Poutine

ANKARA/MOSCOU (Reuters) – La Turquie et la Russie se sont entendues mardi sur un départ des combattants de la milice kurde syrienne YPG d’une zone de 30 km de profondeur le long la frontière syro-turque, ce qui va permettre d’éviter une reprise de l’offensive des forces d’Ankara, a annoncé le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.
Aux termes de l’accord, la police militaire russe et des garde-frontières syriens vont se déployer le long d’une partie de la frontière à partir de midi mercredi pour faciliter le retrait des derniers combattants kurdes et de leurs armes.
Ce retrait devrait être parachevé dans six jours, a précisé Sergueï Lavrov, selon lequel l’accord russo-turc mettra fin au bain de sang dans la région.
A Ankara, le ministère turc de la Défense a annoncé que les Etats-Unis ont informé la Turquie que le retrait des combattants kurdes de la « zone de sécurité » le long de la frontière syro-turque était terminé.
Il n’est pas nécessaire à l’heure actuelle de lancer une opération supplémentaire dans le Nord-Est syrien, précise la diplomatie turque dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi.
Les présidents russe Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan se sont entendus lors d’un entretien dans la station balnéaire de Sotchi sur le retrait des combattants kurdes des villes de Manbij et Tel Rifaat.
« Le principal objectif de l’opération est d’obtenir le départ des organisations terroristes PKK/YPG de la région et de faciliter le retour des réfugiés syriens », a déclaré Erdogan au côté de son homologue russe.
« Cette opération garantit aussi l’intégrité territoriale et l’unité politique de la Syrie », a-t-il ajouté.
La Turquie considère les Unités de protection du peuple (YPG) comme une organisation terroriste liée aux séparatistes kurdes du sud-est de son territoire. Elle souhaite établir une « zone de sécurité » en Syrie, le long de sa frontière, dont les YPG seraient exclues.
Une fois les combattants kurdes partis, les armées russe et turque effectueront des patrouilles conjointes dans le nord de la Syrie, jusqu’à 10 km de la frontière, prévoit l’accord conclu à Sotchi.
Les deux pays vont aussi travailler ensemble au retour des réfugiés syriens qui vivent en Turquie, a déclaré Erdogan.
LES KURDES DISENT S’ÊTRE RETIRÉS
En annonçant une pause des opérations militaires jeudi dernier sous la pression des Etats-Unis, le président turc avait donné aux miliciens kurdes jusqu’à 22h00 ce mardi (19h00 GMT) pour effectuer leur retrait de la région frontalière, sous peine de reprendre son offensive.
Le commandant des Forces démocratiques syriennes (FDS), dont les YPG sont la principale composante, a assuré que ses hommes avaient respecté toutes les conditions de la trêve, selon un membre de l’administration américaine.
Donald Trump, critiqué pour avoir ouvert la voie aux Turcs en annonçant le retrait des Etats-Unis du nord de la Syrie, avait évoqué lundi une éventuelle prolongation de la pause observée depuis jeudi mais Recep Tayyip Erdogan avait prévenu que l’offensive turque pourrait reprendre.
« Si les promesses que nous a faites l’Amérique ne sont pas tenues, nous continuerons notre opération là où nous l’avons laissée, cette fois avec une bien plus grande détermination », avait dit le président turc.
La Turquie dit vouloir sécuriser les 440 km de frontière avec la Syrie mais son offensive s’est pour l’instant concentrée sur deux localités dans le centre de cette bande de territoire, Ras al Aïn et Tal Abyad, distantes de 120 km.
À l’occasion d’une rare visite dans la province d’Idlib, près du dernier grand bastion rebelle dans le nord-ouest de la Syrie, le président syrien Bachar al Assad a qualifié Erdogan de « voleur ». « Maintenant il vole notre terre », a-t-il dit, cité par les médias syriens.
(Darya Korsunskaya et Tuvan Gumrukcu, avec Ece Toksabay; Bertrand Boucey et Tangi Salaün pour le service français, édité par Jean Terzian)

Le Journal Chrétien est 100% gratuit. Faites un don régulier et aidez-nous à poursuivre notre mission.
👉Suivez toute l'actualité du Journal Chrétien sur Google Actualités.
❤️Soutenez-nous sur https://www.jefaisundon.com (CB - PayPal - SEPA).
⚠️ La chaîne Chrétiens TV éditée par le Journal Chrétien est diffusée sur le canal 246 de la Freebox.
✝️Découvrez Bible.audio, plateforme d'étude biblique avec une vingtaine de traductions de la Bible, des commentaires, dictionnaires et lexiques bibliques, etc.
Votre soutien financier nous aidera à :
👍 couvrir les frais de fonctionnement du Journal Chrétien ;
👍 produire des émissions de qualité sur Chrétiens TV pour sensibiliser et encourager ;
👍 améliorer l'application de ressources bibliques Bible.audio ;
👍 transmettre l’héritage spirituel aux générations futures ;
👍 faire rayonner la foi chrétienne dans un esprit d’unité et d’amour.
👍 produire des émissions de qualité sur Chrétiens TV pour sensibiliser et encourager ;
👍 améliorer l'application de ressources bibliques Bible.audio ;
👍 transmettre l’héritage spirituel aux générations futures ;
👍 faire rayonner la foi chrétienne dans un esprit d’unité et d’amour.
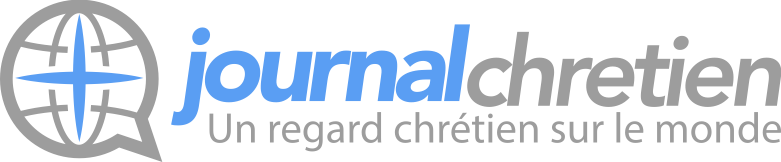





 JE FAIS UN DON MAINTENANT
JE FAIS UN DON MAINTENANT