Nucléaire iranien: Washington appelle le président Raïssi au dialogue

Les Etats-Unis ont appelé jeudi le nouveau président iranien Ebrahim Raïssi à reprendre les négociations sur le retour de Washington et de Téhéran dans le cadre de l’accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, répétant que la fenêtre diplomatique ne resterait pas ouverte indéfiniment.
Avec l’arrivée à la présidence iranienne d’Ebrahim Raïssi, qui a été investi jeudi, toutes les branches de l’exécutif à Téhéran sont désormais contrôlées par des partisans d’une ligne dure à l’égard de l’Occident, conformément à la position du guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei.
Les négociations indirectes menées cette année dans la capitale autrichienne Vienne entre les Etats-Unis et l’Iran ont été suspendues en juin, après plusieurs cycles de pourparlers, en parallèle de la tenue de l’élection présidentielle iranienne.
« Notre message au président Raïssi est le même que celui adressé à ses prédécesseurs (…) Les Etats-Unis vont défendre et faire avancer leurs intérêts et ceux de leurs partenaires en matière de sécurité nationale », a déclaré le porte-parole du département d’Etat américain.
« Nous espérons que l’Iran va saisir désormais l’opportunité d’avancer sur des solutions diplomatiques », a ajouté Ned Price devant des journalistes. « Nous exhortons l’Iran à revenir rapidement aux négociations afin que nous puissions tenter de boucler nos travaux ».
Dans la lignée des propos du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken la semaine dernière, le porte-parole du département d’Etat a souligné que « le processus ne peut pas se poursuivre indéfiniment » et que, à un moment donné, les bénéfices d’un retour à l’accord de 2015 seront éclipsés par les avancées du programme nucléaire iranien.
A la suite du retrait des Etats-Unis du Plan d’action global commun (PAGC, ou JCPoA en anglais) accompagné du rétablissement des sanctions américaines, décidé en 2018 par le président américain de l’époque Donald Trump, l’Iran a commencé à s’affranchir par étapes des termes de l’accord.
(Reportage Daphne Psaledakis et Doyinsola Oladipo; version française Jean Terzian)

Faites un don maintenant pour nous aider à poursuivre notre mission !
Les chrétiens protestants et évangéliques ont longtemps sous-estimé le pouvoir des médias. Les récentes polémiques concernant des reportages à charge contre les plus grandes églises évangéliques françaises posent la question des intentions des patrons des médias, de ces milliardaires qui ont surinvesti ce champ de bataille idéologique.
Ne perdons pas la bataille idéologique
Les achats de médias par des milliardaires ne sont pas toujours motivés par la rentabilité financière, mais plutôt par des intérêts idéologiques. Ils achètent les médias pour influencer l'opinion publique, mener des batailles culturelles et maintenir leur pouvoir économique et social.Les évangéliques pris pour cible
L’influence grandissante des évangéliques gêne certains patrons des médias qui, disons-le, sont engagés dans des loges ou des sectes pernicieuses. Très puissante aux États-Unis, où de nombreuses personnalités ont renoncé à l'occultisme et à la débauche pour se convertir à la foi évangélique, la percée de cette frange chrétienne de plus en plus présente en France fait trembler le monde des ténèbres.Faire contrepoids
A l'heure actuelle, les chaînes d’info font l’agenda, nourrissent les réseaux sociaux, orientent les débats publics. Le Journal Chrétien et sa chaîne Chrétiens TV veulent aller sur leur terrain en investissant la sphère politique et médiatique pour y proposer une autre hiérarchie de l’information. Il est question de mener la bataille culturelle pour faire contrepoids aux groupes de médias hostiles aux Evangéliques.A quoi serviront vos dons ?
Nous avons l’ambition de développer une plateforme de médias suffisamment compétitive. Vos dons nous permettront de créer des émissions chrétiennes de qualité, de réaliser plus d’investigation, de reportages et d’enquêtes de terrain, d'organiser des débats sur des sujets de société, et de recruter du personnel compétent.Il nous faudra également développer davantage notre présence sur le terrain, produire plus de reportages, investir dans du matériel.
Le Journal Chrétien est un média libre, indépendant, sans publicité, accessible à tous grâce à la fidélité et à la générosité de ses lecteurs.
Votre don (défiscalisable à 66%), petit ou grand, est plus qu’un geste. C’est un acte militant et chrétien !

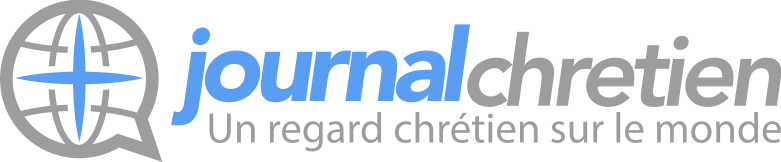





 FAIRE UN DON AU JOURNAL CHRETIEN
FAIRE UN DON AU JOURNAL CHRETIEN




