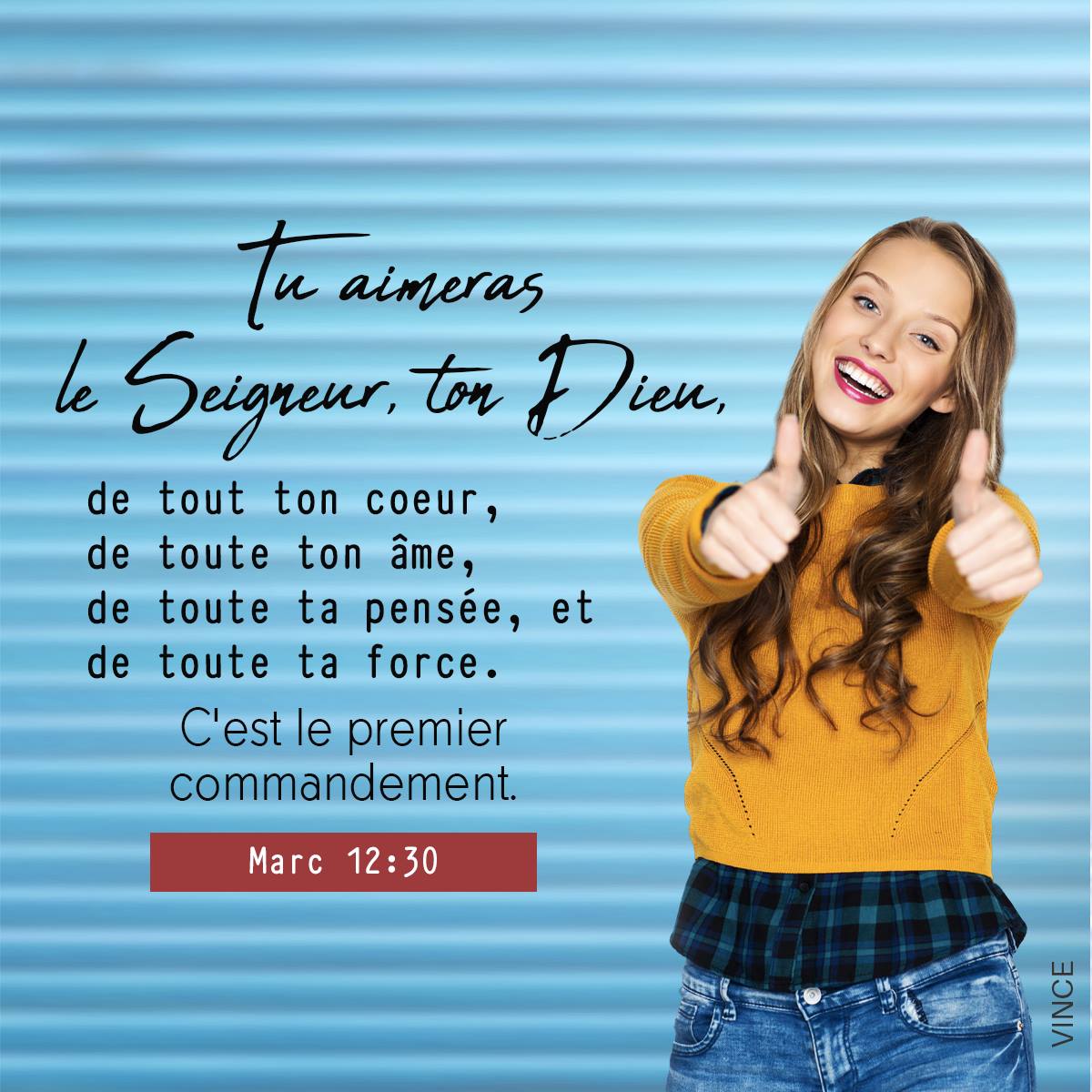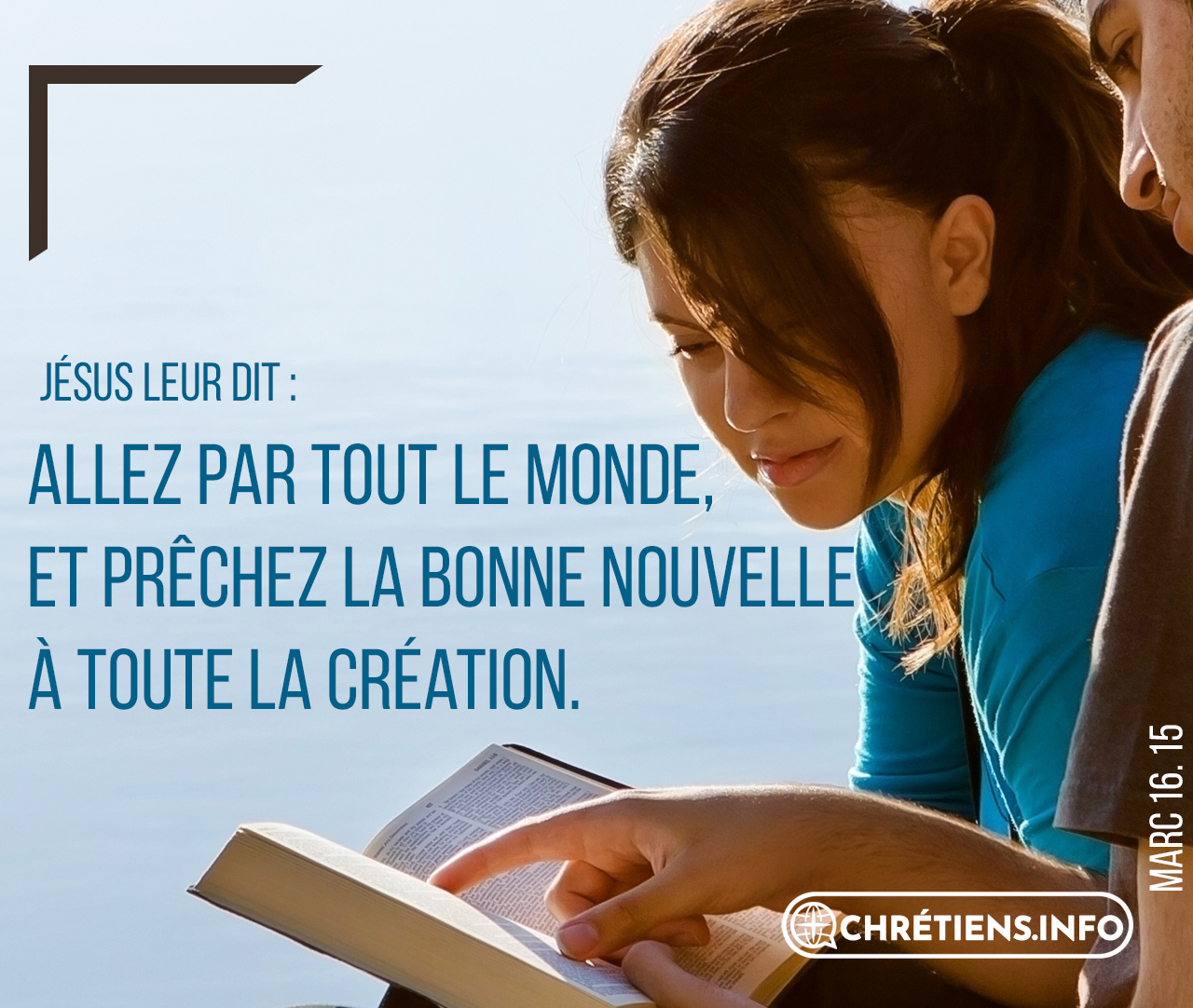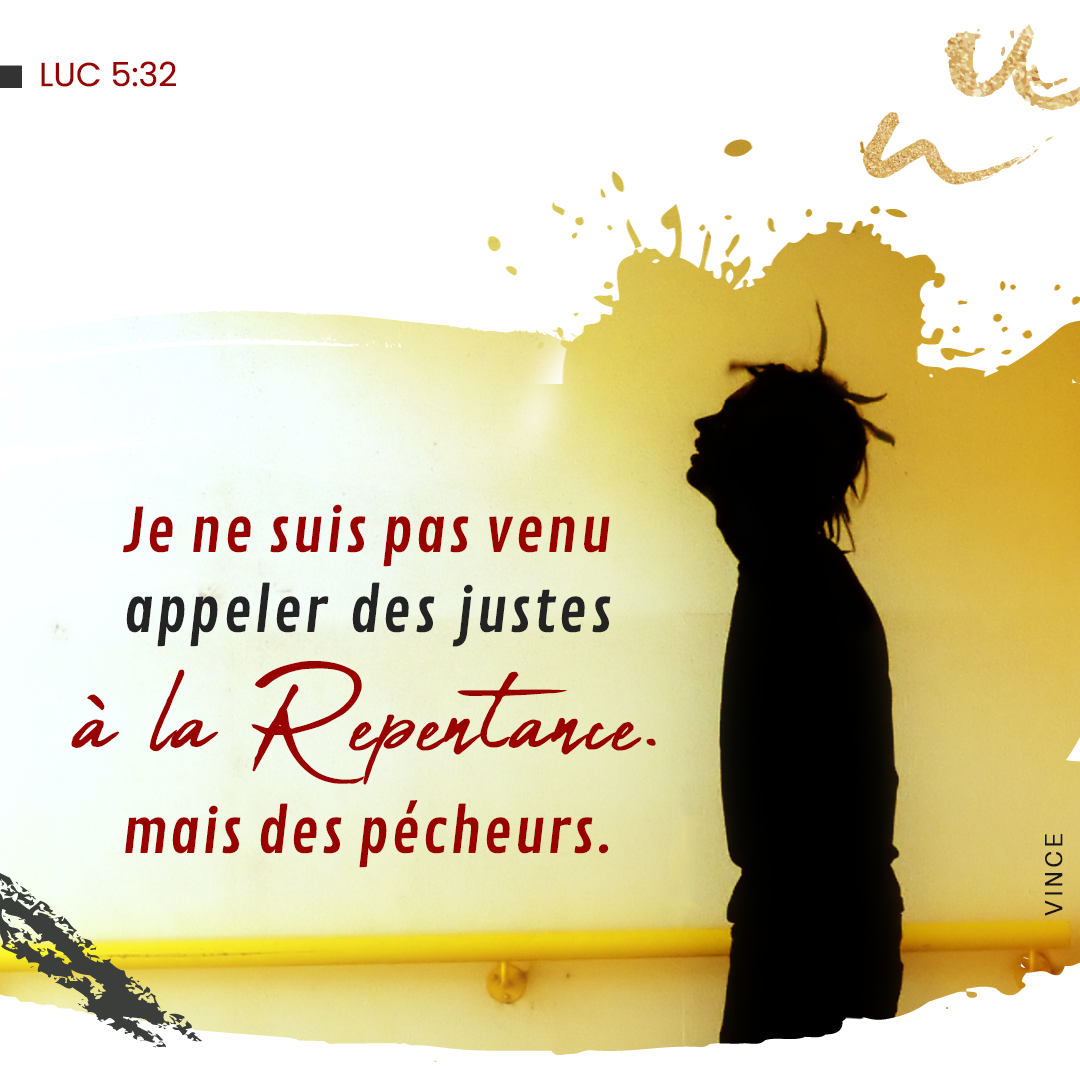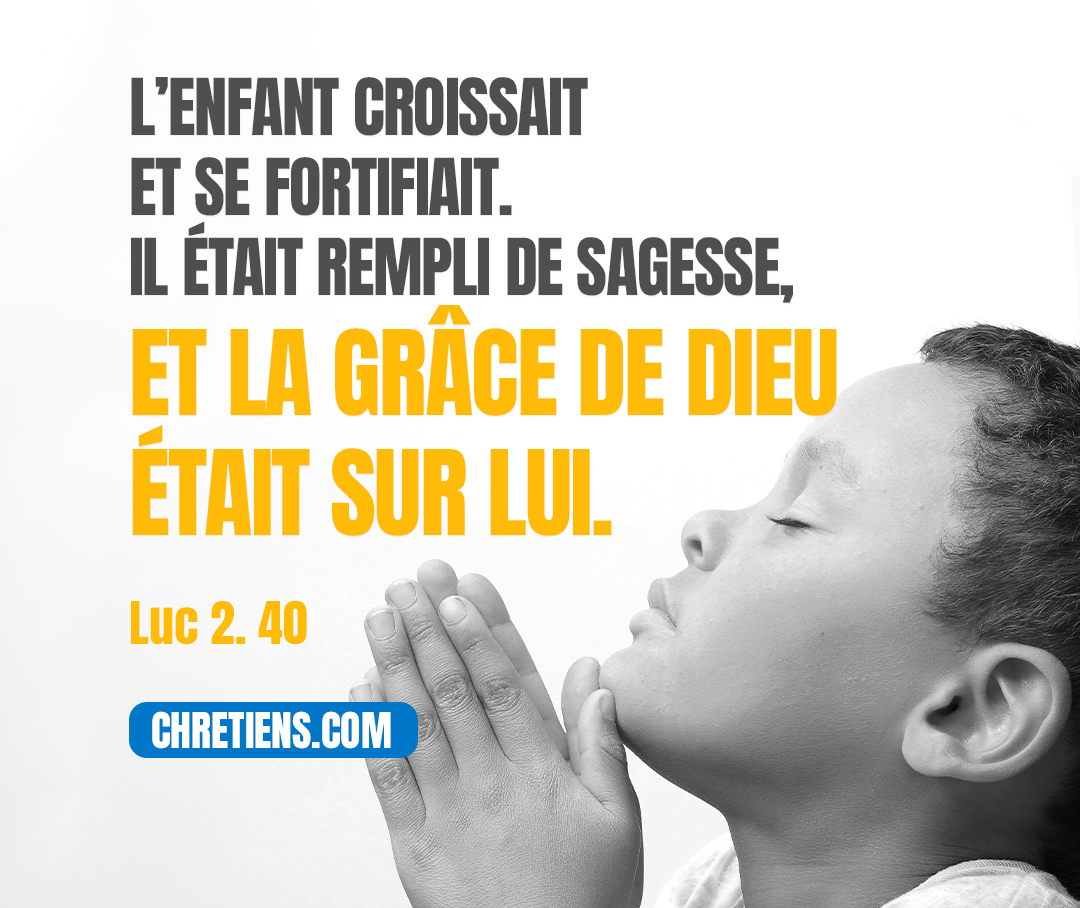Argentine: Les péronistes affronteront l’extrême-droite au second tour de la présidentielle

BUENOS AIRES (Reuters) – La coalition péroniste au pouvoir en Argentine a déjoué les pronostics et est arrivée en tête de l’élection présidentielle dimanche, préparant le terrain pour un second tour très polarisé le mois prochain entre le ministre de l’Economie Sergio Massa et le candidat ultralibéral d’extrême-droite Javier Milei.
Sergio Massa a obtenu 36,6% des voix, devançant Javier Milei qui a récolté un peu plus de 30% des voix, en dépit des sondages que le plaçait en tête du scrutin. La conservatrice Patricia Bullrich arrive en troisième position (23,8%), selon des résultats issus du dépouillement de près de 98% des suffrages.
Les autorités électorales ont déclaré que le taux de participation était d’environ 74%, soit le taux le plus faible pour une élection présidentielle depuis le retour de la démocratie en 1983 dans le pays.
La victoire inattendue du camp péroniste, malgré une inflation à trois chiffres pour la première fois depuis 1991, ouvre la voie à un second tour le 19 novembre qui verra s’affronter deux modèles économiques diamétralement opposés.
En dépit de la grave crise économique que traverse le pays, et qui met en difficulé la coalition péroniste de centre gauche, Sergio Massa a mis en avant les dépenses publiques pour la sécurité sociale et autres subventions du gouvernement, essentielles selon lui pour de nombreux Argentins en difficulté – un discours qui semble avoir porté ses fruits.
Javier Milei, quant à lui, propose des mesures radicales telles que la « dollarisation » de l’économie, et a critiqué ses principaux partenaires commerciaux, la Chine et le Brésil. Il est également favorable à une réduction de la taille du gouvernement et est opposé à l’avortement, légalisé en 2020.
(Reportage Nicolas Misculin ; avec la contribution de Eliana Raszewski, Jorge Otaola, Maximilian Heath, Lucila Sigal, Walter Bianchi, Claudia Gaillard, Leo Benassatto et Miguel Lo Bianco ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)
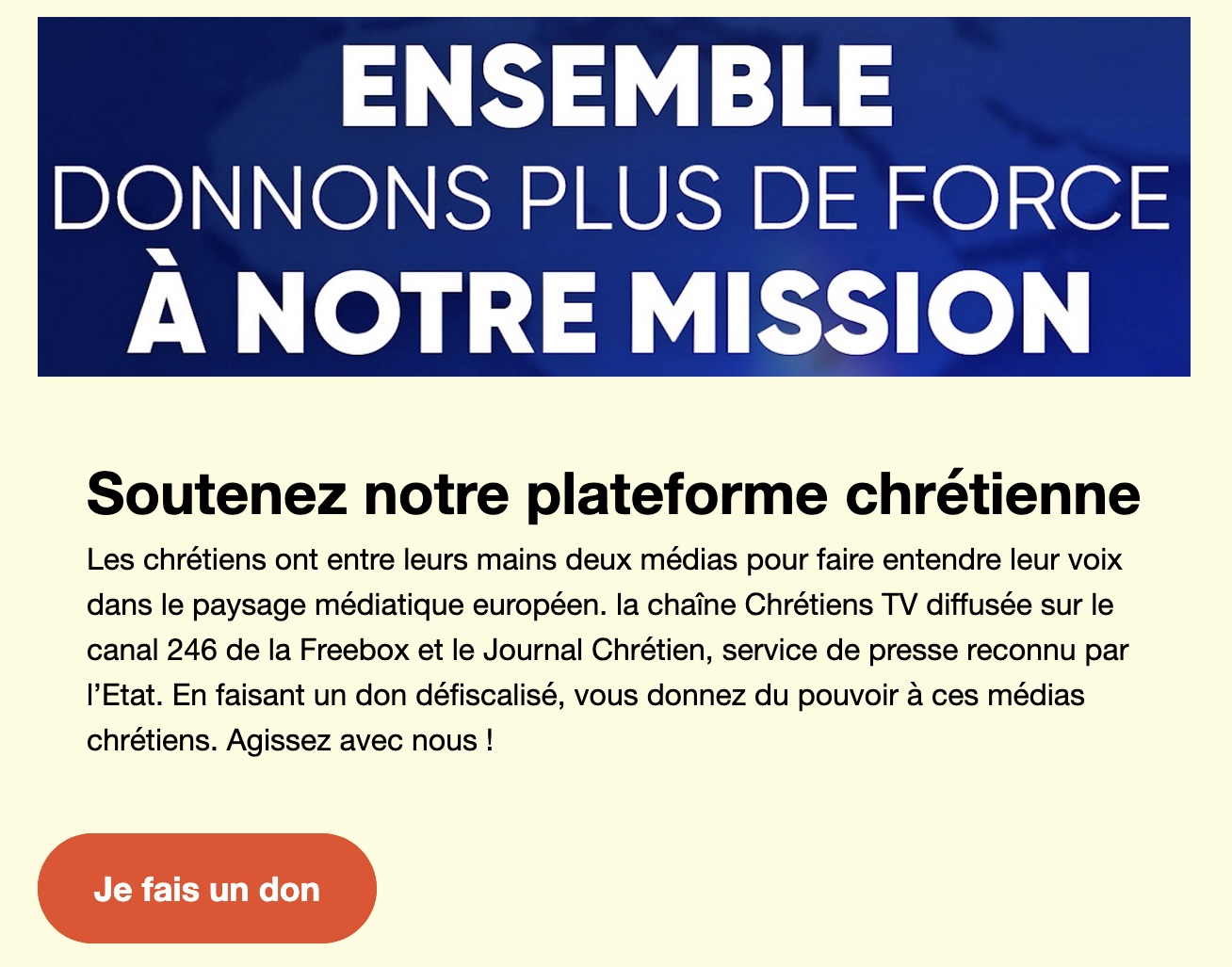
Faites un don maintenant pour nous aider à poursuivre notre mission !
Dans un paysage médiatique marqué par le mensonge, les fake news, les calomnies et les attaques contre les Evangéliques, le Journal Chrétien se positionne comme le média de la vérité qui propose une information indépendante et fiable, non biaisée par des intérêts d'actionnariat ou publicitaires.Les chrétiens protestants et évangéliques ont longtemps sous-estimé le pouvoir des médias. Les récentes polémiques concernant des reportages à charge contre les plus grandes églises évangéliques françaises posent la question des intentions des patrons des médias, de ces milliardaires qui ont surinvesti ce champ de bataille idéologique.
Ne perdons pas la bataille idéologique
Les achats de médias par des milliardaires ne sont pas toujours motivés par la rentabilité financière, mais plutôt par des intérêts idéologiques. Ils achètent les médias pour influencer l'opinion publique, mener des batailles culturelles et maintenir leur pouvoir économique et social.Les évangéliques pris pour cible
L’influence grandissante des évangéliques gêne certains patrons des médias qui, disons-le, sont engagés dans des loges ou des sectes pernicieuses. Très puissante aux États-Unis, où de nombreuses personnalités ont renoncé à l'occultisme et à la débauche pour se convertir à la foi évangélique, la percée de cette frange chrétienne de plus en plus présente en France fait trembler le monde des ténèbres.Faire contrepoids
A l'heure actuelle, les chaînes d’info font l’agenda, nourrissent les réseaux sociaux, orientent les débats publics. Le Journal Chrétien et sa chaîne Chrétiens TV veulent aller sur leur terrain en investissant la sphère politique et médiatique pour y proposer une autre hiérarchie de l’information. Il est question de mener la bataille culturelle pour faire contrepoids aux groupes de médias hostiles aux Evangéliques.A quoi serviront vos dons ?
Nous avons l’ambition de développer une plateforme de médias suffisamment compétitive. Vos dons nous permettront de créer des émissions chrétiennes de qualité, de réaliser plus d’investigation, de reportages et d’enquêtes de terrain, d'organiser des débats sur des sujets de société, et de recruter du personnel compétent.Il nous faudra également développer davantage notre présence sur le terrain, produire plus de reportages, investir dans du matériel.
Le Journal Chrétien est un média libre, indépendant, sans publicité, accessible à tous grâce à la fidélité et à la générosité de ses lecteurs.
Votre don (défiscalisable à 66%), petit ou grand, est plus qu’un geste. C’est un acte militant et chrétien !
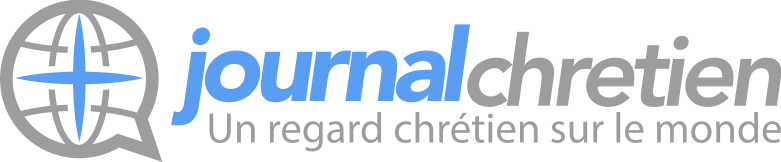

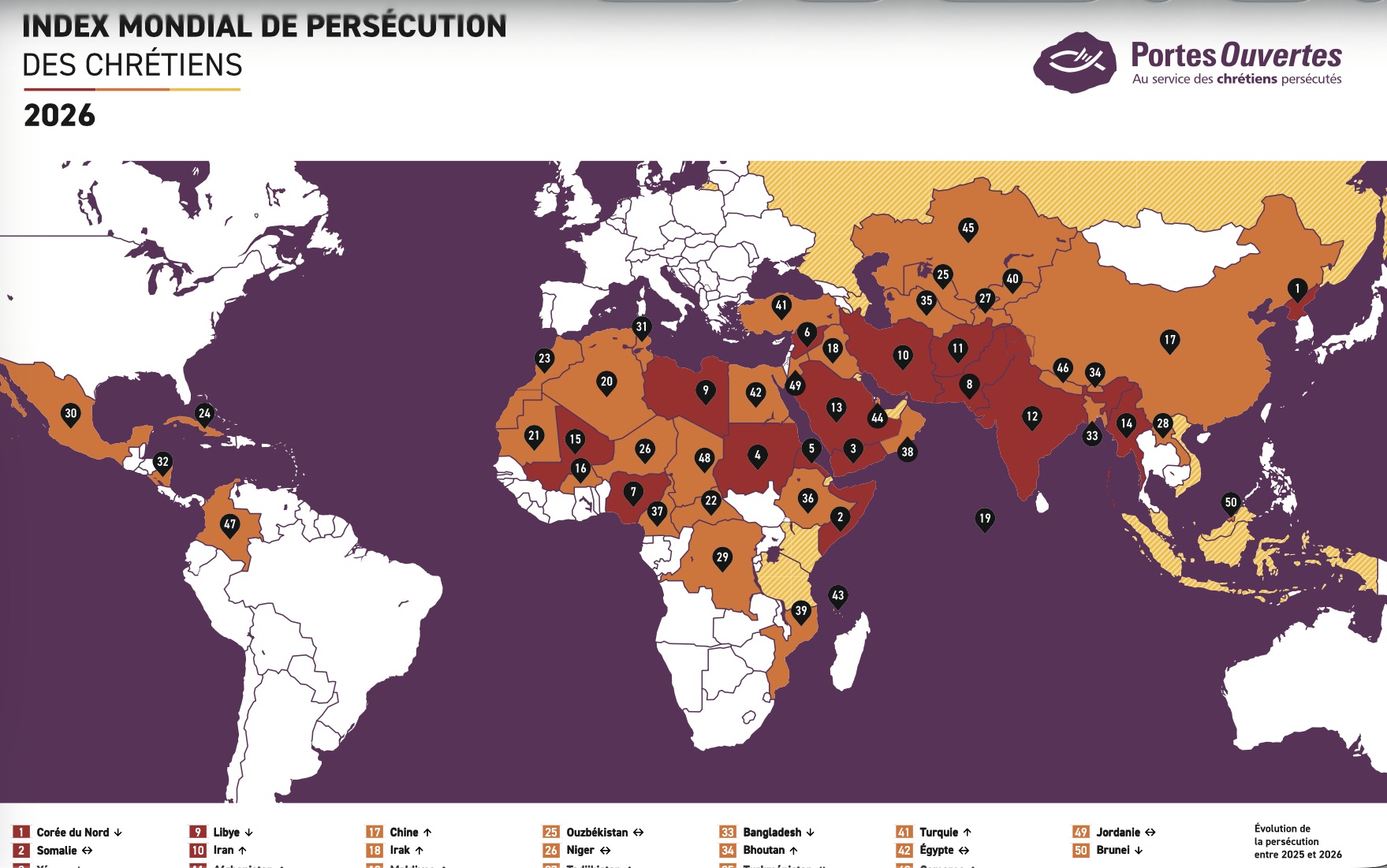




 JE FAIS UN DON MAINTENANT
JE FAIS UN DON MAINTENANT