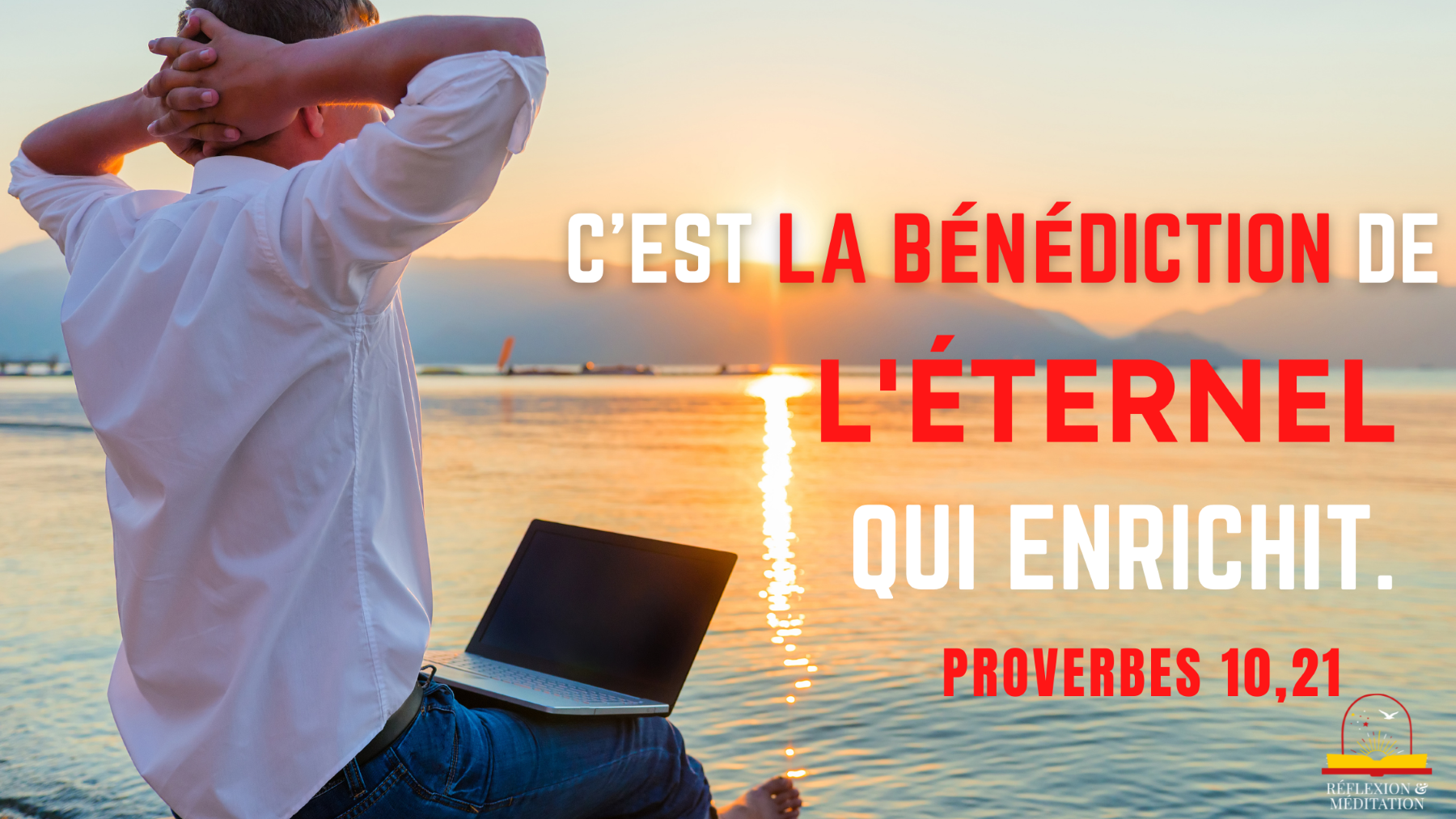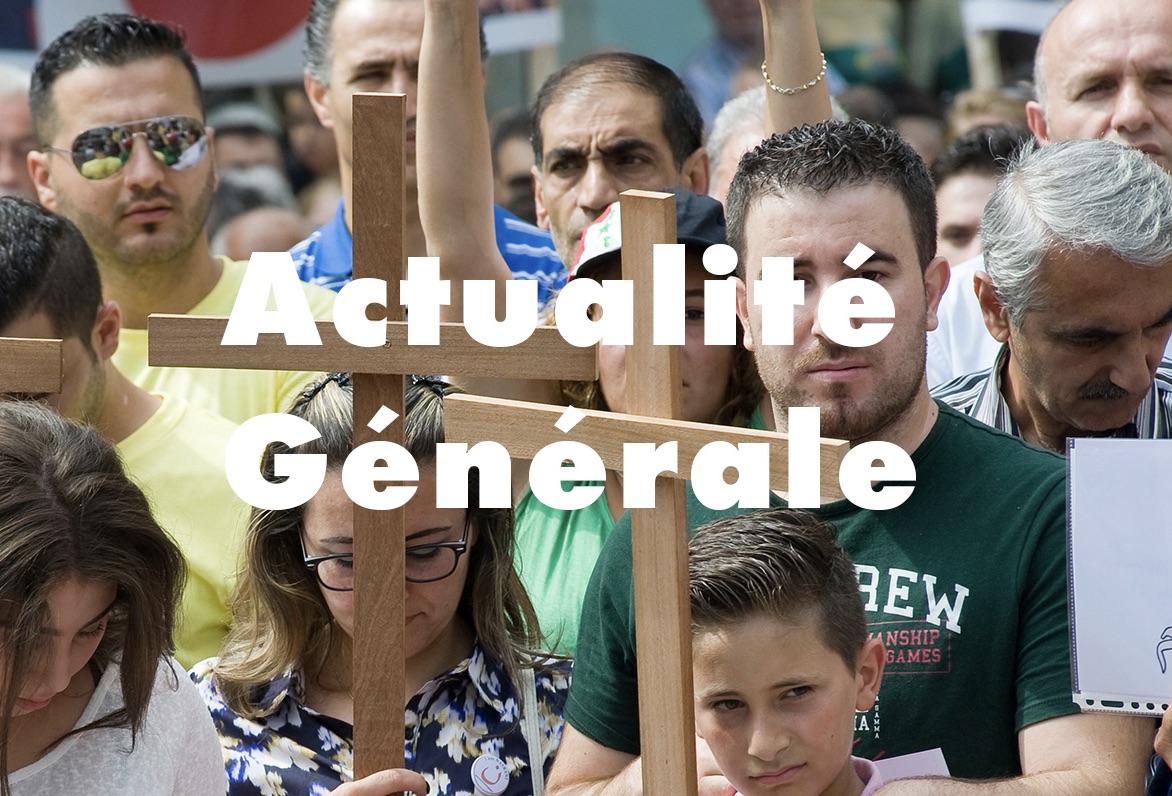Iliad: Bénéfice en hausse de 5,4% au premier trimestre, tiré par les ventes en France et en Italie
par Mathieu Rosemain
PARIS (Reuters) – Iliad a fait état vendredi d’un bénéfice brut au premier trimestre en hausse de 5,4% sur un an, tiré par des revenus plus élevés en France et en Italie.
L’opérateur télécoms a vu son EBITDAaL, l’un des principaux indicateurs de rentabilité du secteur, s’élever à 714 millions d’euros sur la période, a indiqué la maison-mère de Free dans un communiqué, tandis que le chiffre d’affaires du premier trimestre a augmenté de 4,8% pour atteindre 1,9 milliard d’euros.
Iliad, que son fondateur Xavier Niel a retiré de la cote l’année dernière dans le cadre d’un rachat de 3,1 milliards d’euros, a réaffirmé son objectif de croissance dans les trois pays où le groupe est présent.
Ces pays comprennent également la Pologne, où l’entreprise a récemment acquis le câblo-opérateur polonais UPC auprès de l’américain Liberty Global.
« Notre première priorité c’est le développement organique », a déclaré le directeur général Thomas Reynaud, ajoutant que le groupe était ouvert aux acquisitions, notamment en Italie, où son offre de 11,25 milliards d’euros pour racheter les activités de Vodafone a été rejetée par l’opérateur britannique.
« Si jamais il devait y avoir une forme de consolidation (en Italie) et si un acteur souhaitait vendre son actif italien, on serait amené à le regarder », a déclaré Thomas Reynaud lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.
Iliad cherche également à conclure un accord avec son rival Wind Tre en Italie pour partager les coûts du déploiement de leur réseau mobile.
Thomas Reynaud a déclaré en mars qu’Iliad était proche d’un accord avec Wind Tre, propriété du conglomérat Hutchinson. Les pourparlers sont toujours en cours et une transaction n’a pas encore été finalisée, a déclaré un porte-parole d’Iliad.
(Reportage de Mathieu Rosemain, rédigé par Alexander Smith ; version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer)
Vous aimez nos publications ? Engagez-vous !
Les systèmes politiques et médiatiques ont besoin que s'exercent des contre-pouvoirs. Une majorité de journaux, télévisions et radios appartiennent à quelques milliardaires ou à des multinationales très puissantes souhaitant faire du profit, privant les citoyens d’un droit fondamental : avoir accès à une information libre de tout conflit d’intérêt.Le Journal Chrétien, service de presse en ligne bénéficiant d’un agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse du Ministère de la Culture, assure un contre-pouvoir à l’ensemble des acteurs sociaux, en vérifiant les discours officiels, en décryptant l'actualité, en révélant des informations de première importance ou en portant le témoignage des dominés.
La qualité de notre travail est reconnu par les médias séculiers. Dernièrement, le président du Journal Chrétien a accordé une longue interview à Sud Ouest, le deuxième quotidien régional français avec une diffusion totale de 219 000 exemplaires.
ENGAGEZ VOUS !
Quand les évangéliques sont attaqués, calomniés ou traités avec mépris par les médias traditionnels, un silence de notre part ne serait pas chrétien. Une telle attitude montrerait un renoncement suspect à se faire respecter et à exiger des médias mondains un tel respect.Lorsque les pasteurs et les églises évangéliques sont attaqués, le critère de la solidarité chrétienne doit jouer. Comment nous dire membres du Corps du Christ si nous restons indifférents à la persécution de certains d’entre nous, souvent réduits au silence et incapables de faire valoir leurs droits ou, tout simplement, de se faire respecter comme chrétiens ou communautés évangéliques ?
En s'appuyant sur notre plateforme de médias, l’action sur l’opinion publique est évidemment essentielle. Faire savoir est la condition de toute action, car rien n’est pire que le silence. D’où l’importance de l’action en direction des médias, des institutions et des populations.
Evidemment, ici comme ailleurs, la réticence de la part des chrétiens à agir comme des groupes de pression constitue une difficulté majeure. Mais, là encore, ne faudrait-il pas s’interroger sur notre dispersion et nos réticences à agir comme lobby, quand il s’agit de défenses des libertés et droits humains fondamentaux ?
Vous pouvez soutenir notre action :
- en faisant un don ponctuel ou régulier.
- en rejoignant notre équipe comme analyste, expert, professionnel de l'audiovisuel, défenseur des droits de l'homme, journaliste, théologien, etc.
- en priant pour nous.
- en nous contactant par email à l'adresse [email protected] ou par téléphone au par téléphone au +33 769138397
 JE FAIS UN DON
JE FAIS UN DON