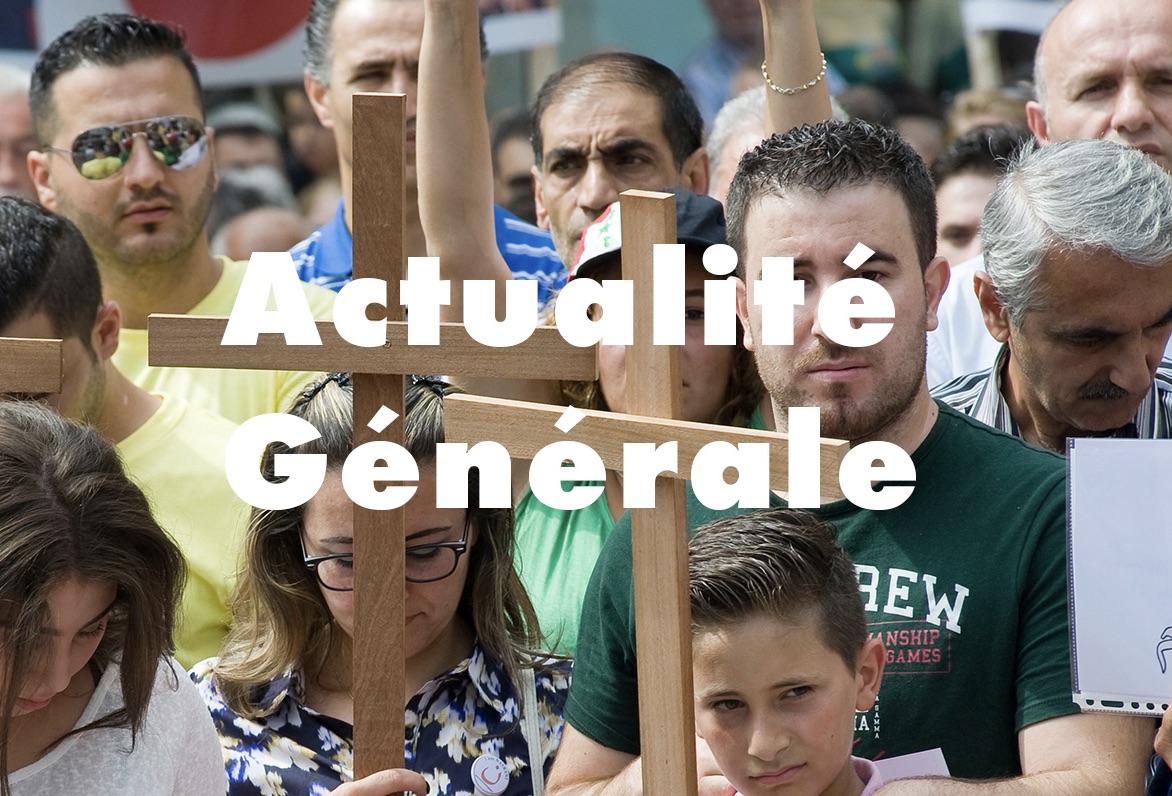La ‘taxe Gafa’ prélevée par la France à nouveau dans le viseur de Trump
(Reuters) – Donald Trump a fait savoir jeudi qu’il prévoyait de prendre des mesures contre la France et le Canada pour les taxes que les deux pays prélèvent sur les revenus des géants technologiques américains, dits les « Gafa », une question qui irrite de longue date le président américain.
Le Parlement français a adopté en juillet 2019, soit lors du premier mandat présidentiel de Donald Trump, une loi prévoyant de taxer à 3% les revenus des sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires sur leurs activités numériques d’au moins 750 millions d’euros au niveau mondial et de plus de 25 millions d’euros en France.
Une trentaine de sociétés devaient être concernées, pour la plupart américaines, ce qui avait alors poussé Donald Trump à menacer la France de représailles.
Washington avait ensuite suspendu à plusieurs reprises les surtaxes annoncées sur des produits français. L’administration du président américain Joe Biden les avait finalement abandonnées en 2021, un accord chapeauté par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ayant été trouvé pour réformer la fiscalité des multinationales.
Donald Trump a dévoilé jeudi une feuille de route pour la mise en oeuvre de taxes dites réciproques pour tous les pays qui imposeraient des droits de douane ou d’autres mesures sur les produits américains.
Un document de la Maison blanche, stipulant que « seule l’Amérique peut être autorisée à taxer les firmes américaines », se plaint que la France et le Canada se servent de taxes sur les services numériques pour collecter individuellement plus de 500 millions de dollars par an auprès d’entreprises américaines.
« Globalement, ces taxes non-réciproques coûtent plus de 2 milliards de dollars par an aux firmes américaines », est-il écrit dans le document. « Des taxes douanières réciproques vont ramener de l’équité et de la prospérité (…) ».
Aucun commentaire n’a été obtenu dans l’immédiat auprès du ministère français de l’Economie et des Finances.
(Rédigé par Jean Terzian, avec David Ljunggren et Leigh Thomas)
Vous aimez nos publications ? Engagez-vous !
Les systèmes politiques et médiatiques ont besoin que s'exercent des contre-pouvoirs. Une majorité de journaux, télévisions et radios appartiennent à quelques milliardaires ou à des multinationales très puissantes souhaitant faire du profit, privant les citoyens d’un droit fondamental : avoir accès à une information libre de tout conflit d’intérêt.Le Journal Chrétien, service de presse en ligne bénéficiant d’un agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse du Ministère de la Culture, assure un contre-pouvoir à l’ensemble des acteurs sociaux, en vérifiant les discours officiels, en décryptant l'actualité, en révélant des informations de première importance ou en portant le témoignage des dominés.
La qualité de notre travail est reconnu par les médias séculiers. Dernièrement, le président du Journal Chrétien a accordé une longue interview à Sud Ouest, le deuxième quotidien régional français avec une diffusion totale de 219 000 exemplaires.
ENGAGEZ VOUS !
Quand les évangéliques sont attaqués, calomniés ou traités avec mépris par les médias traditionnels, un silence de notre part ne serait pas chrétien. Une telle attitude montrerait un renoncement suspect à se faire respecter et à exiger des médias mondains un tel respect.Lorsque les pasteurs et les églises évangéliques sont attaqués, le critère de la solidarité chrétienne doit jouer. Comment nous dire membres du Corps du Christ si nous restons indifférents à la persécution de certains d’entre nous, souvent réduits au silence et incapables de faire valoir leurs droits ou, tout simplement, de se faire respecter comme chrétiens ou communautés évangéliques ?
En s'appuyant sur notre plateforme de médias, l’action sur l’opinion publique est évidemment essentielle. Faire savoir est la condition de toute action, car rien n’est pire que le silence. D’où l’importance de l’action en direction des médias, des institutions et des populations.
Evidemment, ici comme ailleurs, la réticence de la part des chrétiens à agir comme des groupes de pression constitue une difficulté majeure. Mais, là encore, ne faudrait-il pas s’interroger sur notre dispersion et nos réticences à agir comme lobby, quand il s’agit de défenses des libertés et droits humains fondamentaux ?
Vous pouvez soutenir notre action :
- en faisant un don ponctuel ou régulier.
- en rejoignant notre équipe comme analyste, expert, professionnel de l'audiovisuel, défenseur des droits de l'homme, journaliste, théologien, etc.
- en priant pour nous.
- en nous contactant par email à l'adresse [email protected] ou par téléphone au par téléphone au +33 769138397
 JE FAIS UN DON
JE FAIS UN DON