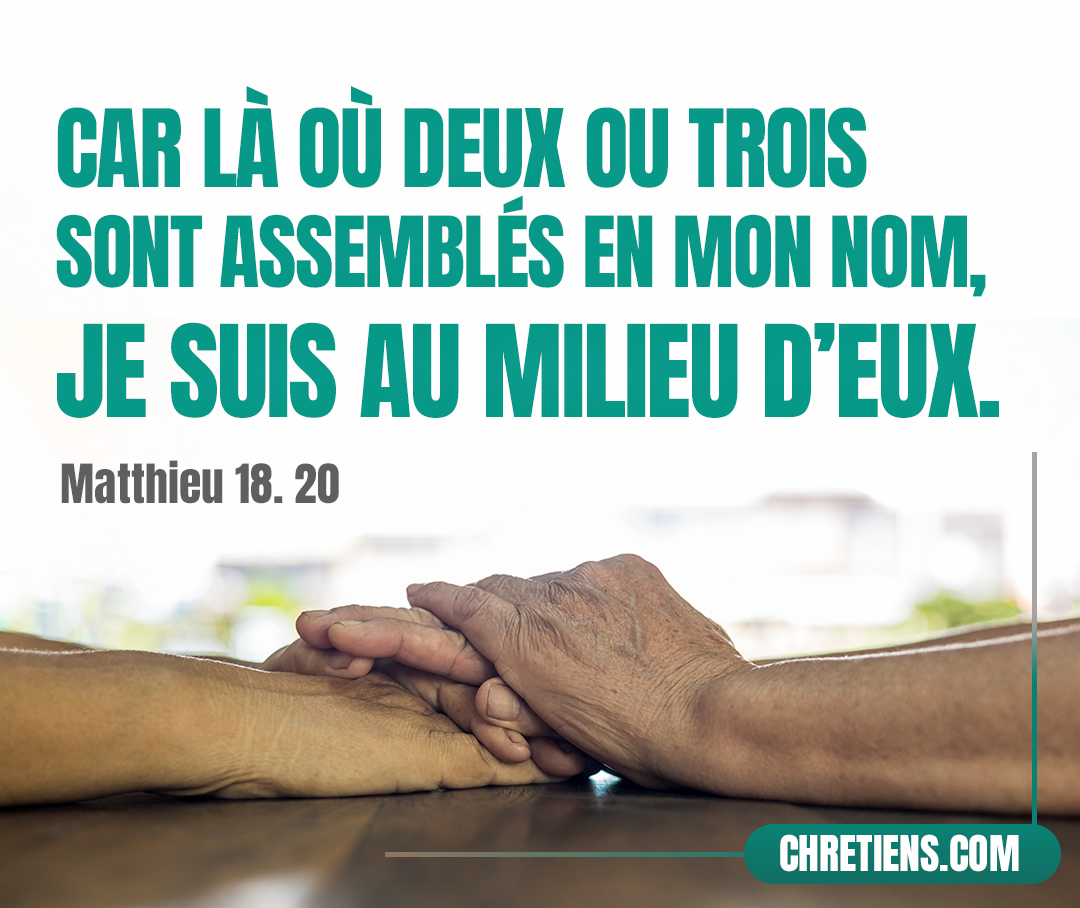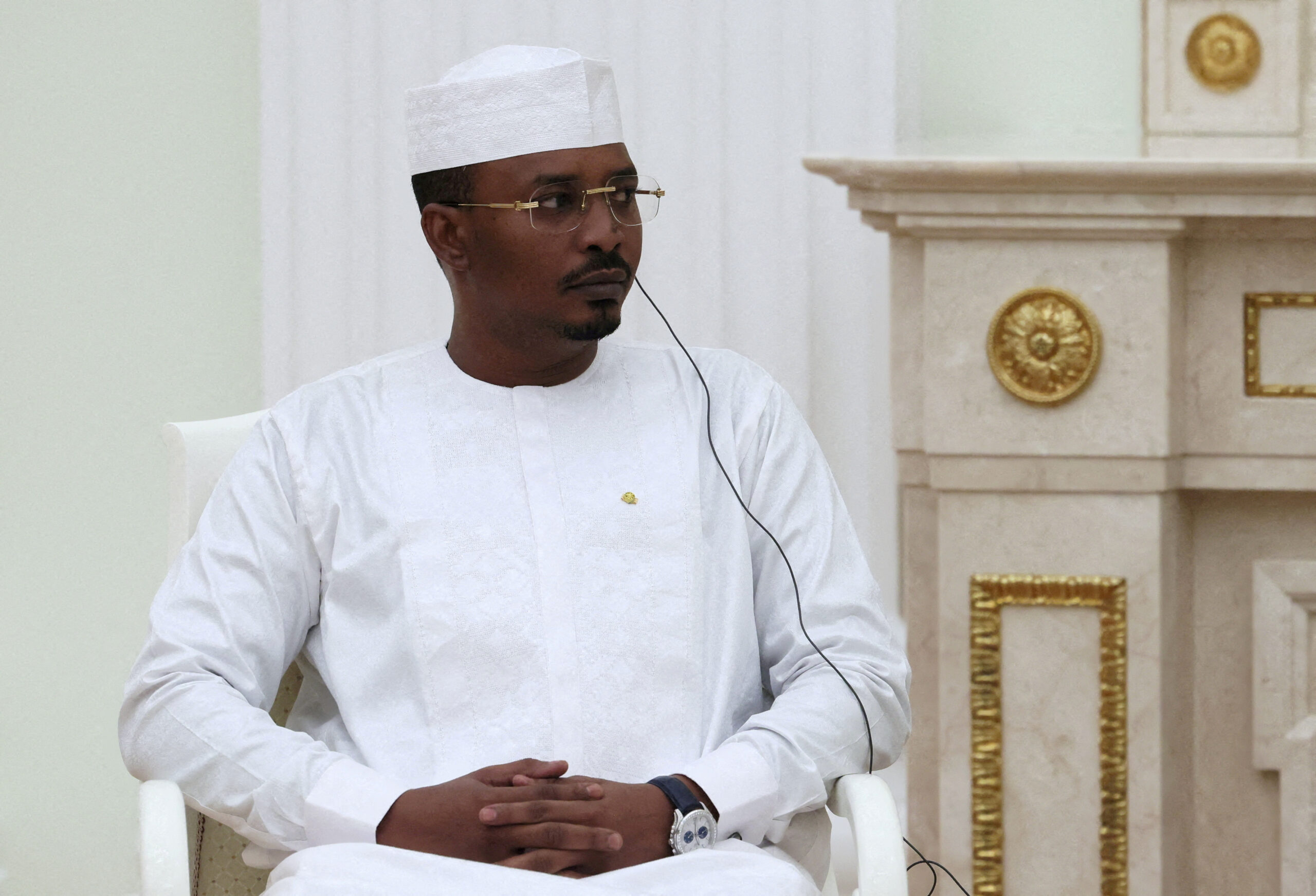Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête des intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle française de 2022

Le premier tour de l’élection présidentielle est prévu ce dimanche 10 avril en France. Parmi les douze candidats qui ont officiellement battu campagne, seuls trois ont franchi la barre symbolique des 10% des intentions de vote au premier tour et sont en capacité de se qualifier au second tour, selon les derniers sondages.
Il s’agit du président sortant Emmanuel Macron toujours en tête des enquêtes d’opinion avec 27 % des intentions de vote au premier tour, selon les dernières enquêtes Ifop, Ipsos et Opinion Way en date du mercredi 6 avril.
Dans son programme politique, M. Macron s’est fixé comme objectif de faire de la France dans les cinq prochaines années, une nation « plus indépendante », dans un contexte mondial de plus en plus marqué par des crises multiples.
Indépendance militaire avec une augmentation du budget des armées d’ici 2025, indépendance agricole, industrielle et productive avec, notamment la construction de six réacteurs nucléaires dans le domaine énergétique, a annoncé le président sortant.
Le candidat du mouvement « la République en marche » a également mis en avant pendant la campagne, ses réalisations que sont entre autres, la réduction des impôts comme la taxe d’habitation, la baisse de l’impôt sur le revenu ou encore la réduction du chômage.
Marine Le Pen, candidate d’extrême droite arrive en seconde position et réduit l’écart avec le président sortant. Elle est désormais créditée à la date du mercredi 6 avril, de 23,5% des intentions de vote dans l’enquête Ifop, 23% dans Opinion-way et de 22% dans l’enquête Ipsos.
La candidate nationaliste reste fidèle à sa ligne anti-immigration. « Un Etranger en situation irrégulière ne sera jamais régularisable », a-t-elle déclaré en meeting à Perpignan. La suppression du droit du sol et le durcissement des règles de naturalisation sont également au coeur de son programme politique. A ce combat contre l’immigration s’ajoute celui contre « l’islamisme politique » sur fond d’interdiction du port du voile dans l’espace public.
Jean-Luc Mélenchon, candidat de l’Union populaire (gauche) figure en troisième position, et pourrait créer la surprise à cette élection selon certains observateurs. M. Mélenchon a vite surclassé dans les sondages, le candidat d’extrême droite Eric Zemmour et la candidate de droite Valerie Pécresse. Il engrange ainsi 17,5 % des voix dans l’enquête Ifop, 17 % dans celle d’Ipsos et de 16 % chez Opinion Way.
Cette dynamique s’explique surtout par le projet politique du candidat de l’Union populaire, notamment axé sur l’inflation et le pouvoir d’achat. Jean-Luc Mélenchon propose le « blocage immédiat » des prix des produits de première nécessité dont le gaz et l’électricité, en réponse à l’inflation.
Le candidat de gauche le mieux placé selon les sondages plaide également en faveur des 35 heures hebdomadaire de durée du travail et la majoration des heures supplémentaires ainsi que l’augmentation du SMIC de 1.269 à 1.400 euros nets par mois.
Les candidats Eric Zemmour (extrême droite) et Valerie Pécresse (droite) arrivent en quatrième position (ex-aequo) et se situent entre 8,5 à 9% des intentions de vote. Yannick Jadot, le candidat écologiste récolte 6%, le candidat communiste Fabien Roussel 3,5%, et Jean Lassalle 2,5%.
La participation reste cependant l’inconnue décisive de ce scrutin. La crainte d’une abstention record grandit chez les candidats et les instituts de sondages après une campagne électorale parasitée par le conflit russo-ukrainien et ses conséquences, mais aussi par la crise sanitaire qui a empêché la tenue de grands meetings politiques.
Selon une enquête Ipsos/Sopra Steria réalisée pour France Inter, 30% des électeurs, interrogés à douze jours du premier tour, ne sont pas sûrs d’aller voter, ce qui serait un « record d’abstention » pour un premier tour dans la Vème République selon les sondeurs. L’on retrouve ces abstentionnistes potentiels chez les ménages modestes comme les ouvriers (36%), les employés (35%) et les foyers à revenu mensuel inférieur à 2000 euros (37%), précise l’enquête.

Faites un don maintenant pour nous aider à poursuivre notre mission !
Chers amis chrétiens,
Alors que le besoin d'espérance se fait davantage sentir dans le monde, le Journal Chrétien devient un soutien précieux pour tous ceux qui souhaitent nourrir leur réflexion, leur foi ou simplement découvrir des messages chrétiens porteurs de sens et de bienveillance.
Depuis novembre 2025, la chaîne Chrétiens TV développée par le Journal Chrétien est incluse dans le bouquet de l'opérateur Free (Canal 246).
Cette avancée majeure est une opportunité pour la communauté chrétienne qui peut diffuser largement l'Evangile à la télévision. Nous comptons sur votre générosité pour faire face aux coûts élevés de cette couverture médiatique.
Si vous avez déjà fait un don au Journal Chrétien et que vous ne l’ayez pas renouvelé, sachez que l’avenir du Journal Chrétien ne pourra pas s’écrire sans vous. Pourriez-vous renouveler votre don cette année ?
Si vous n'avez jamais fait un don au Journal Chrétien, vous pouvez nous soutenir maintenant et recevoir un reçu fiscal au titre de l’année 2025 (déductible à 66% de votre impôt sur le revenu). Votre don est indispensable, nous comptons sur vous !
En comptant sur votre soutien et forte d’une grande espérance, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2026.
Pour nous contacter par mail : [email protected]
L'équipe de Journal Chrétien

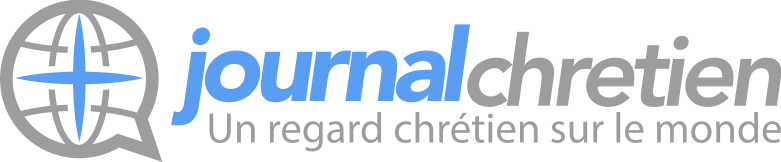





 JE FAIS UN DON MAINTENANT
JE FAIS UN DON MAINTENANT