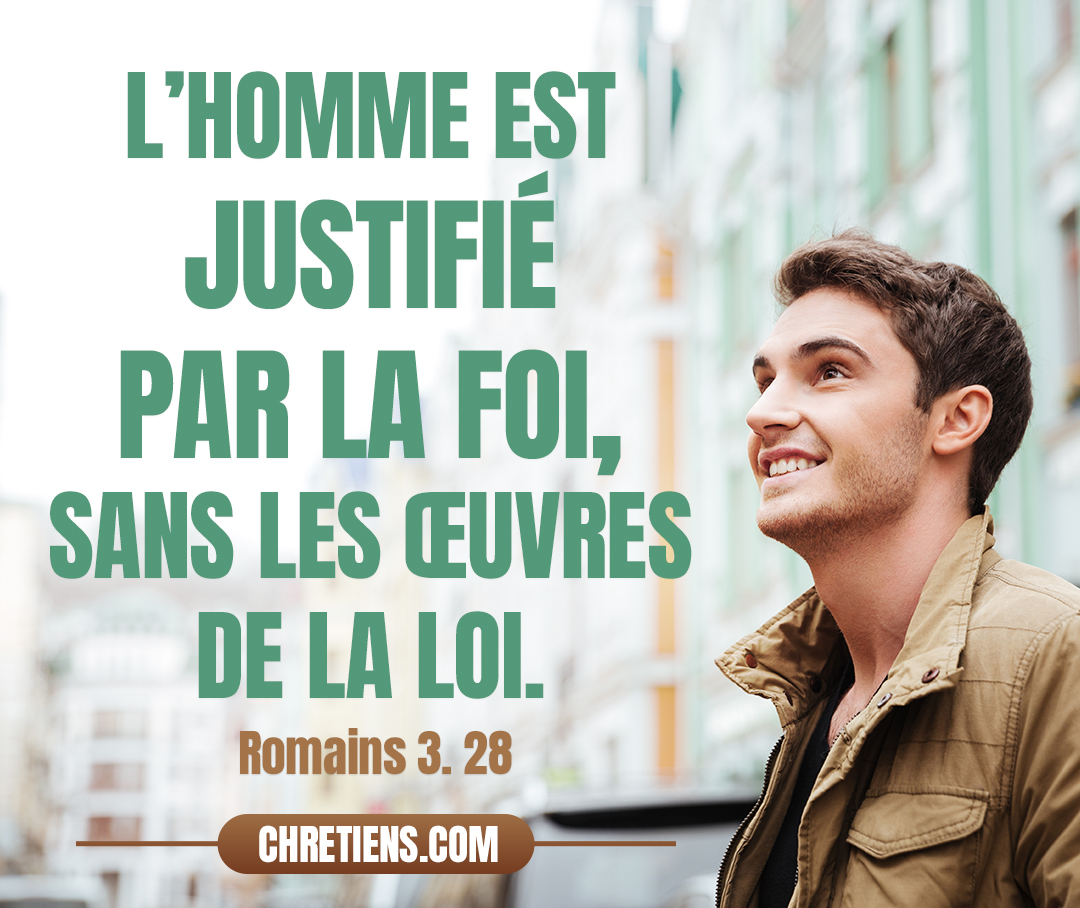L’Arabie saoudite double ses importations de mazout russe au deuxième trimestre

MOSCOU/LONDRES/DUBAI (Reuters) – L’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a plus que doublé au deuxième trimestre ses importations de mazout russe utilisé pour alimenter ses centrales électriques afin de préserver ses stocks de brut destinés à l’exportation et de répondre à la forte demande liée à la période estivale.
La Russie, frappée par des sanctions occidentales depuis l’invasion de l’Ukraine, considérée par Moscou comme « une opération spéciale », vend désormais ses hydrocarbures à prix réduits en Chine, en Inde et dans plusieurs pays africains et du Moyen-Orient.
Les ventes de mazout russe auprès de ces pays représentent pour le président américain Joe Biden un nouveau défi alors que son administration cherche à isoler la Russie et à la priver des importants revenus tirés de ses exportations d’énergie.
Joe Biden doit se rendre en Arabie saoudite cette semaine dans l’espoir de convaincre Ryad d’accroître la production de brut de l’Opep, ce qui permettrait de faire baisser les prix du pétrole, qui exacerbent les pressions inflationnistes.
Mais le royaume, qui a conservé ses liens avec la Russie dans le cadre de l’alliance entre l’Opep et d’autres pays producteurs de pétrole (Opep+), dispose de peu de marges pour accroître ses capacités.
Les données consultées par Reuters montrent que l’Arabie saoudite a importé 647.000 tonnes (48.000 barils par jour) de mazout de Russie via les ports russes et estoniens entre avril-juin, contre 320.000 tonnes sur la même période il y a un an.
Sur l’année 2021, l’Arabie saoudite a importé 1,05 million de tonnes de mazout russe.
Contactés, les ministères saoudien et russe de l’Energie ont refusé de s’exprimer sur le sujet.
L’Arabie saoudite importe depuis plusieurs années du mazout russe, ce qui permet au royaume de réduire ses besoins en raffinage de pétrole brut pour ses produits et de baisser la quantité de pétrole qu’il doit utiliser pour produire de l’électricité, lui offrant ainsi plus de stocks pour le brut destiné à l’exportation sur les marchés internationaux, vendu à des prix plus élevés.
(Reportage Reuters; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)

Le Journal Chrétien est 100% gratuit. Faites un don régulier et aidez-nous à poursuivre notre mission.
👉Suivez toute l'actualité du Journal Chrétien sur Google Actualités.
❤️Soutenez-nous sur https://www.jefaisundon.com (CB - PayPal - SEPA).
⚠️ La chaîne Chrétiens TV éditée par le Journal Chrétien est diffusée sur le canal 246 de la Freebox.
✝️Découvrez Bible.audio, plateforme d'étude biblique avec une vingtaine de traductions de la Bible, des commentaires, dictionnaires et lexiques bibliques, etc.
Votre soutien financier nous aidera à :
👍 couvrir les frais de fonctionnement du Journal Chrétien ;
👍 produire des émissions de qualité sur Chrétiens TV pour sensibiliser et encourager ;
👍 améliorer l'application de ressources bibliques Bible.audio ;
👍 transmettre l’héritage spirituel aux générations futures ;
👍 faire rayonner la foi chrétienne dans un esprit d’unité et d’amour.
👍 produire des émissions de qualité sur Chrétiens TV pour sensibiliser et encourager ;
👍 améliorer l'application de ressources bibliques Bible.audio ;
👍 transmettre l’héritage spirituel aux générations futures ;
👍 faire rayonner la foi chrétienne dans un esprit d’unité et d’amour.
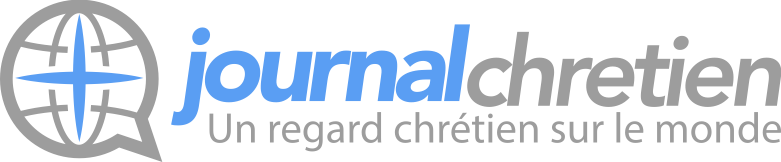






 JE FAIS UN DON MAINTENANT
JE FAIS UN DON MAINTENANT