La Russie accuse l’Ukraine de l’incriminer à tort dans l’attaque du théâtre de Marioupol

(Reuters) – Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré jeudi qu’affirmer que l’armée russe avait bombardé un théâtre à Marioupol était un mensonge et que la vérité émergerait malgré ce qu’il désigne comme des tentatives d’incriminer à tort Moscou.
Les autorités ukrainiennes ont accusé mercredi les forces russes d’avoir largué une puissante bombe sur un théâtre, où selon elles des centaines de civils – dont de nombreux enfants – avaient trouvé refuge alors que la ville portuaire stratégique est assiégée depuis plus de deux semaines par les troupes russes.
Reuters n’a pas été en mesure de vérifier ces informations.
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré jeudi lors d’un point de presse que Kyiv essayait de rejeter la responsabilité de cette attaque sur les forces russes.
Le gouvernement ukrainien n’a pas immédiatement répondu à des demandes de commentaire au sujet des déclarations de Maria Zakharova.
Le ministère russe de la Défense avait déjà démenti les accusations ukrainiennes et accusé le bataillon Azov, une milice ukrainienne d’extrême droite, d’avoir fait exploser le bâtiment après y avoir détenu des otages et tiré sur les forces russes des étages supérieurs.
Les combattants du bataillon Azov ont une base à Marioupol. L’Ukraine s’en tient à sa version des faits.
Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, a déclaré dans un communiqué que les images ukrainiennes semblaient montrer que toutes les fenêtres des bâtiments voisins étaient intactes et qu’il n’y avait aucune preuve au sol d’un bombardement venu des airs.
Les autorités ukrainiennes n’ont pas immédiatement répondu à des demandes de commentaires au sujet des déclarations d’Igor Konachenkov.
(Reportage Reuters, version française Valentine Baldassari, édité par Jean-Michel Bélot)

Faites un don maintenant pour nous aider à poursuivre notre mission !
Les chrétiens protestants et évangéliques ont longtemps sous-estimé le pouvoir des médias. Les récentes polémiques concernant des reportages à charge contre les plus grandes églises évangéliques françaises posent la question des intentions des patrons des médias, de ces milliardaires qui ont surinvesti ce champ de bataille idéologique.
Ne perdons pas la bataille idéologique
Les achats de médias par des milliardaires ne sont pas toujours motivés par la rentabilité financière, mais plutôt par des intérêts idéologiques. Ils achètent les médias pour influencer l'opinion publique, mener des batailles culturelles et maintenir leur pouvoir économique et social.Les évangéliques pris pour cible
L’influence grandissante des évangéliques gêne certains patrons des médias qui, disons-le, sont engagés dans des loges ou des sectes pernicieuses. Très puissante aux États-Unis, où de nombreuses personnalités ont renoncé à l'occultisme et à la débauche pour se convertir à la foi évangélique, la percée de cette frange chrétienne de plus en plus présente en France fait trembler le monde des ténèbres.Faire contrepoids
A l'heure actuelle, les chaînes d’info font l’agenda, nourrissent les réseaux sociaux, orientent les débats publics. Le Journal Chrétien et sa chaîne Chrétiens TV veulent aller sur leur terrain en investissant la sphère politique et médiatique pour y proposer une autre hiérarchie de l’information. Il est question de mener la bataille culturelle pour faire contrepoids aux groupes de médias hostiles aux Evangéliques.A quoi serviront vos dons ?
Nous avons l’ambition de développer une plateforme de médias suffisamment compétitive. Vos dons nous permettront de créer des émissions chrétiennes de qualité, de réaliser plus d’investigation, de reportages et d’enquêtes de terrain, d'organiser des débats sur des sujets de société, et de recruter du personnel compétent.Il nous faudra également développer davantage notre présence sur le terrain, produire plus de reportages, investir dans du matériel.
Le Journal Chrétien est un média libre, indépendant, sans publicité, accessible à tous grâce à la fidélité et à la générosité de ses lecteurs.
Votre don (défiscalisable à 66%), petit ou grand, est plus qu’un geste. C’est un acte militant et chrétien !

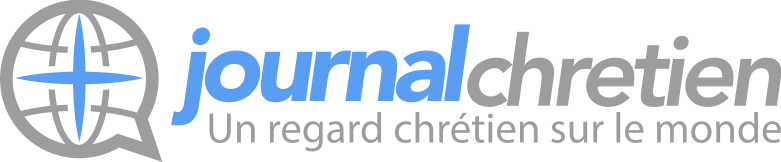





 FAIRE UN DON AU JOURNAL CHRETIEN
FAIRE UN DON AU JOURNAL CHRETIEN







