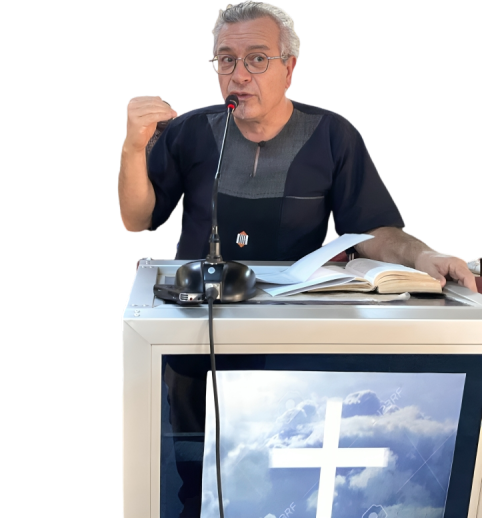La chrétienne pakistanaise Mehak Afzal libérée au Pakistan
La chrétienne pakistanaise Mehak Afzal, qui a été enlevée en juin 2021 et mariée de force à un musulman, est parvenue à se libérer elle-même.
En février 2023, Mehak avait 15 ans lorsque sa mère Kiran et son frère Hamza ont pu rencontrer les collaborateurs de CSI venus de Suisse dans le cadre du foyer protégé de CSI. À ce moment-là, Mehak était encore entre les mains de son ravisseur.
La mère de neuf enfants nous avait alors remerciés pour l’assistance juridique que CSI offrait depuis 2022 à sa famille durement éprouvée. « Merci également de nous avoir aidés à créer une entreprise de couture et de nous avoir mis à disposition une moto pour nous rendre aux audiences du tribunal. »
Harcelée depuis longtemps
Revenons au début de l’année 2021. Kiran s’inquiète depuis plusieurs mois pour sa fille Mehak qui est harcelée régulièrement par un musulman inconnu sur le chemin de l’école. « Par crainte d’un enlèvement, j’ai dû convaincre ma fille de ne plus aller à l’école, ce qui n’a pas été facile », explique Kiran. Mais même cette mesure radicale ne suffit pas à la protéger.
Un soir de juin 2021, Kiran a rendez-vous chez le médecin et doit laisser Mehak seule à la maison avec ses trois jeunes sœurs. L’agresseur semble bien informé : c’est ce moment qu’il choisit pour s’introduire dans l’appartement avec deux de ses frères et sa mère. Il kidnappe Mehak avant de la contraindre à se convertir à l’islam et à l’épouser.
De graves conséquences
Lorsque Kiran rentre chez elle et apprend ce qui s’est passé, elle se rend immédiatement auprès de la police avec son fils Hamza pour que des recherches soient menées au plus tôt, mais la jeune fille est introuvable. C’est surtout son père qui souffre de sa disparition. Pendant deux jours, il cherche sa fille sans relâche. « Où est-elle ? Où est-elle ? », ne cesse-t-il de crier. Totalement effondré, il perd même temporairement la vue. Depuis, il ne se remet que difficilement et ne peut plus travailler à cause de sa maladie psychique.
L’enlèvement de Mehak a également des conséquences pour ses deux sœurs aînées. Par peur qu’il leur arrive quelque chose, elles ne vont plus à l’école.
Les recherches finissent par aboutir et le tribunal délivre un mandat d’arrêt contre le coupable, mais les policiers musulmans refusent d’arrêter le coupable. Pendant plusieurs mois, la famille de Mehak ne cesse de les supplier, en vain. Les parents savent certes où vit leur fille, mais il serait trop dangereux de chercher à s’approcher de la maison où elle est détenue.
Enfin libre !
En 2022, CSI commence à soutenir la famille avec un avocat. Depuis, il est possible de temps à autre de contacter Mehak par téléphone et de la réconforter. Elle a désormais la certitude que ses parents sont hors de danger et que sa famille l’attend à la maison.
La nouvelle tombe juste avant Noël, le 23 décembre 2023 : Mehak est parvenue à se libérer elle-même des griffes de son tortionnaire et à rentrer chez elle ! Malheureusement, elle ne s’y trouve pas en sécurité, car elle risque d’être enlevée une nouvelle fois par celui qui prétend être son mari. Anjum, partenaire de CSI, met tout en œuvre pour que Mehak et sa famille puissent être hébergés en lieu sûr.
CSI continue d’apporter une aide juridique à la famille Afzal afin que le mariage forcé soit annulé par le tribunal. Kiran est très heureuse : « Chaque jour, nous avons prié Dieu pour que Mehak puisse être à nouveau avec nous. Nous savions que rien n’est impossible à Dieu. Maintenant, ma fille est de retour. Nous sommes très reconnaissants à CSI pour son aide juridique et financière. Notre fille est rentrée ! »
Mehak souffre toujours du traumatisme laissé par ses années de captivité. Elle exprime néanmoins sa gratitude avec un sourire : « J’ai été enlevée et mariée de force. Sous de graves menaces, j’ai été forcée de me convertir à l’islam. Quelle chance d’être à nouveau avec mon père et ma mère ! Je suis tellement reconnaissante à CSI pour son aide. »
Reto Baliarda
Vous aimez nos publications ? Engagez-vous !
Les systèmes politiques et médiatiques ont besoin que s'exercent des contre-pouvoirs. Une majorité de journaux, télévisions et radios appartiennent à quelques milliardaires ou à des multinationales très puissantes souhaitant faire du profit, privant les citoyens d’un droit fondamental : avoir accès à une information libre de tout conflit d’intérêt.Le Journal Chrétien, service de presse en ligne bénéficiant d’un agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse du Ministère de la Culture, assure un contre-pouvoir à l’ensemble des acteurs sociaux, en vérifiant les discours officiels, en décryptant l'actualité, en révélant des informations de première importance ou en portant le témoignage des dominés.
La qualité de notre travail est reconnu par les médias séculiers. Dernièrement, le président du Journal Chrétien a accordé une longue interview à Sud Ouest, le deuxième quotidien régional français avec une diffusion totale de 219 000 exemplaires.
ENGAGEZ VOUS !
Quand les évangéliques sont attaqués, calomniés ou traités avec mépris par les médias traditionnels, un silence de notre part ne serait pas chrétien. Une telle attitude montrerait un renoncement suspect à se faire respecter et à exiger des médias mondains un tel respect.Lorsque les pasteurs et les églises évangéliques sont attaqués, le critère de la solidarité chrétienne doit jouer. Comment nous dire membres du Corps du Christ si nous restons indifférents à la persécution de certains d’entre nous, souvent réduits au silence et incapables de faire valoir leurs droits ou, tout simplement, de se faire respecter comme chrétiens ou communautés évangéliques ?
En s'appuyant sur notre plateforme de médias, l’action sur l’opinion publique est évidemment essentielle. Faire savoir est la condition de toute action, car rien n’est pire que le silence. D’où l’importance de l’action en direction des médias, des institutions et des populations.
Evidemment, ici comme ailleurs, la réticence de la part des chrétiens à agir comme des groupes de pression constitue une difficulté majeure. Mais, là encore, ne faudrait-il pas s’interroger sur notre dispersion et nos réticences à agir comme lobby, quand il s’agit de défenses des libertés et droits humains fondamentaux ?
Vous pouvez soutenir notre action :
- en faisant un don ponctuel ou régulier.
- en rejoignant notre équipe comme analyste, expert, professionnel de l'audiovisuel, défenseur des droits de l'homme, journaliste, théologien, etc.
- en priant pour nous.
- en nous contactant par email à l'adresse [email protected] ou par téléphone au par téléphone au +33 769138397
 JE FAIS UN DON
JE FAIS UN DON