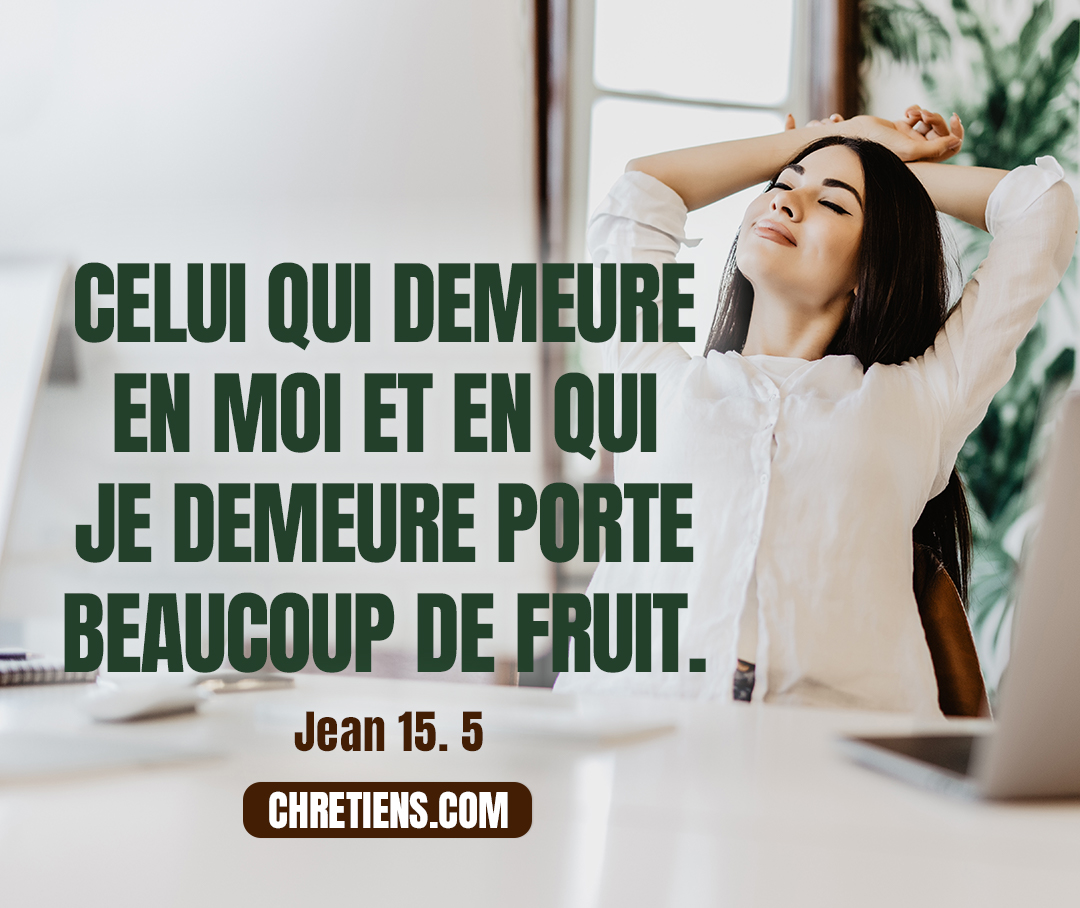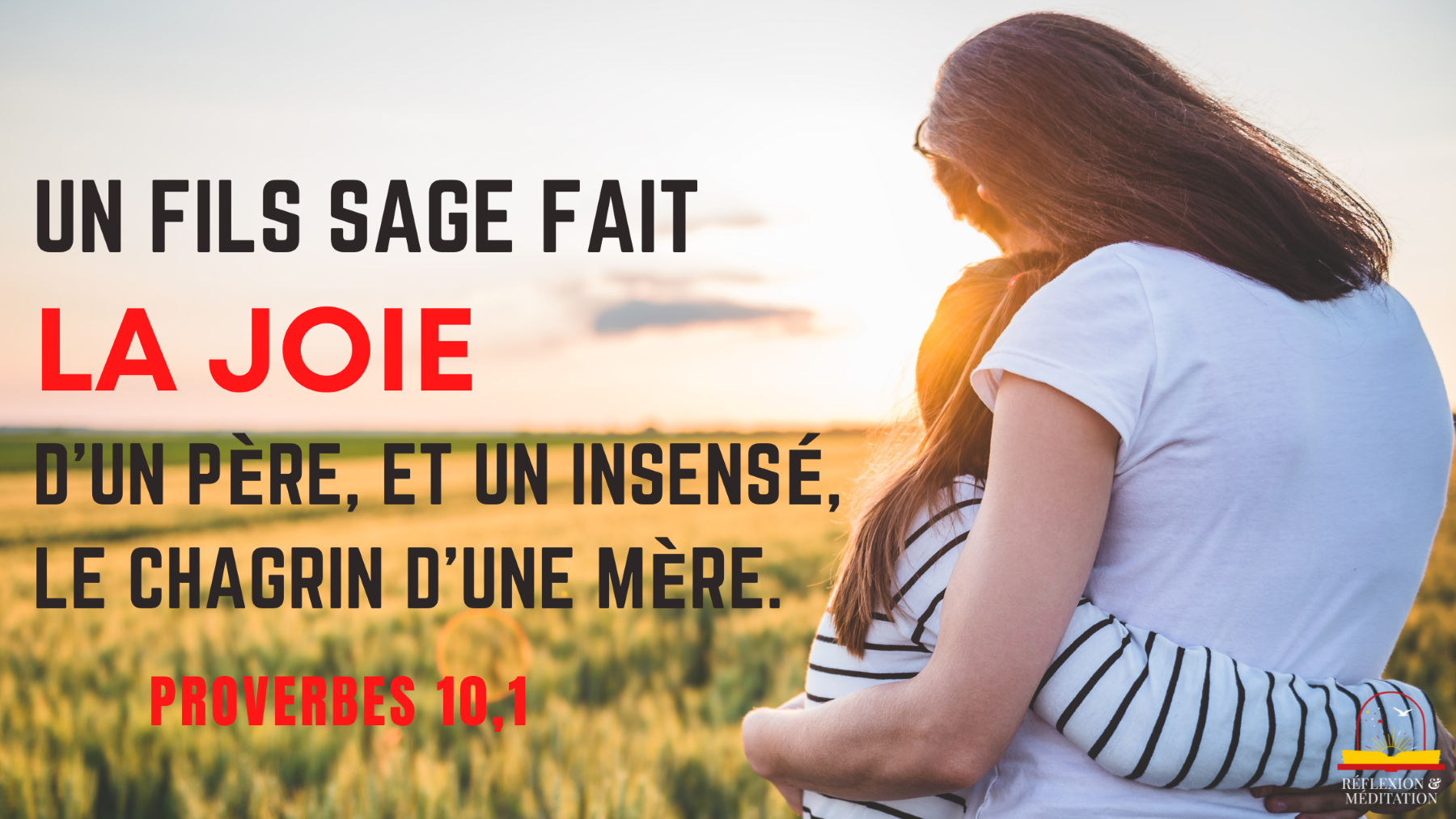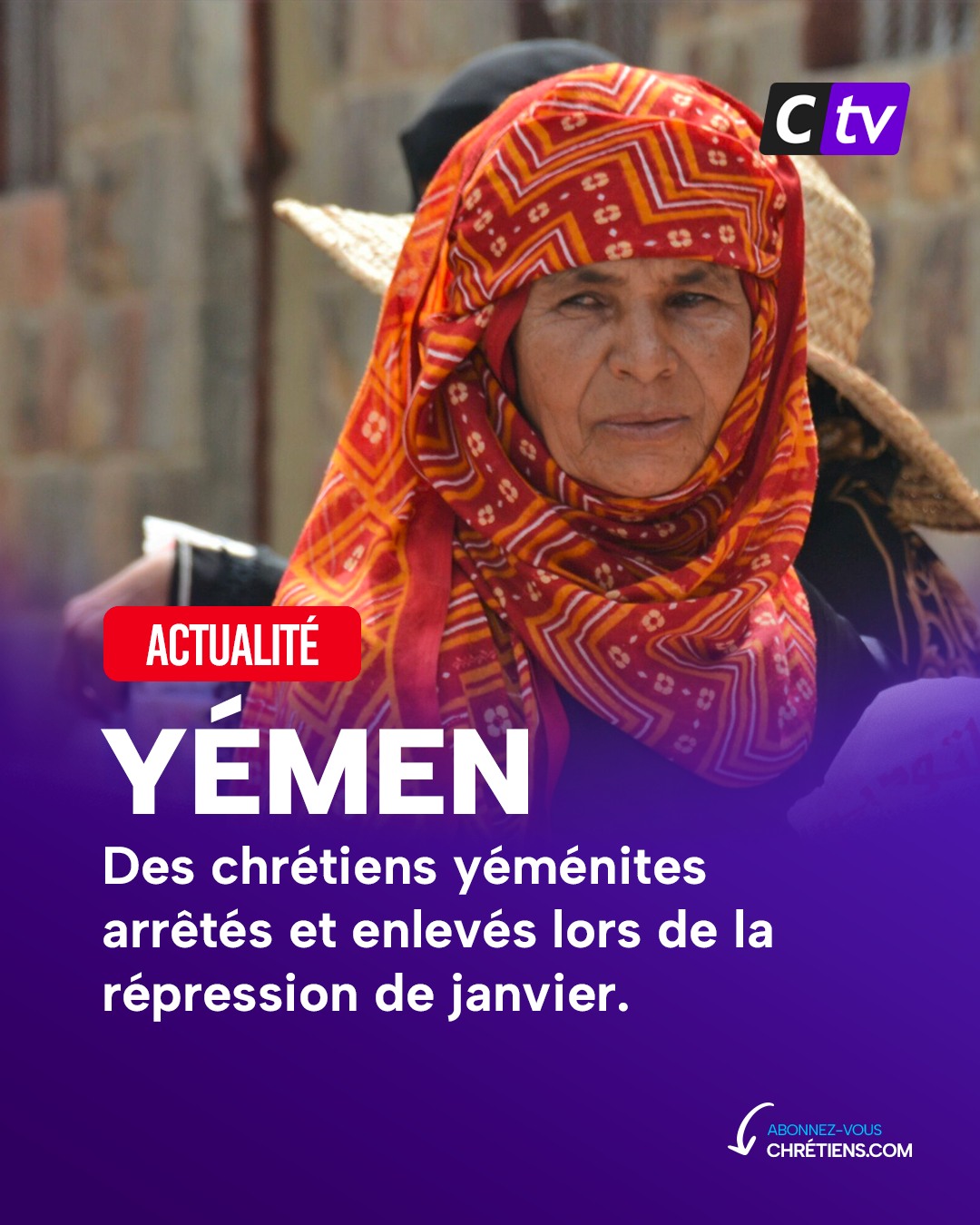Nouvelle journée de perturbations dans les transports

PARIS (Reuters) – Les transports étaient encore très perturbés samedi en France pour le troisième jour consécutif dans le cadre du mouvement de protestation contre la réforme des retraites avant une semaine décisive dans le bras de fer engagé entre les syndicats et l’exécutif, qui a promis de mener son projet à bien mais « sans brutalité ».
Pour le week-end, la SNCF prévoit un TGV sur six en moyenne, 15% des Transilien et des perturbations sur les liaisons internationales avec un train sur deux pour l’Eurostar, deux sur trois pour le Thalys et aucune circulation pour le Lyria, vers la Suisse, ou le SVI, vers l’Italie.
Côté RATP, le trafic était « extrêmement » réduit samedi, avec neuf lignes de métro fermées. Il le sera encore dimanche avant d’être « très perturbé » lundi, à la veille d’une nouvelle journée de manifestations mardi à l’appel de l’intersyndicale (CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, Unef, MNL et UNL).
Dans les airs, contrairement à jeudi et vendredi, la direction générale de l’aviation civile (DGAC) n’a pas demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols mais prévoyait tout de même des retards et des perturbations.
Les déplacements ont aussi été compliqués samedi dans une dizaine de régions de France par des blocages routiers et des opérations escargots organisés à l’appel de l’organisation des transporteurs routiers européens (Otre) pour protester contre la « hausse de la fiscalité sur le gazole professionnel ».
Le mouvement social contre le projet de réforme visant à faire fusionner les 42 régimes de retraite existants en un système universel par points à partir de 2025, devrait se poursuivre au moins jusqu’à mercredi, date des annonces promises par le Premier ministre Edouard Philippe.
Pressé par les syndicats de sortir rapidement du silence sur les détails de cette promesse de campagne d’Emmanuel Macron, le chef du gouvernement a annoncé vendredi qu’il présenterait « l’intégralité » du projet de réforme – et non plus l’architecture générale comme initialement prévu -, devant le Conseil économique social et environnemental (Cese).
LES SYNDICATS DE LA SNCF APPELLENT À AMPLIFIER LA GRÈVE
« Le débat pourra ainsi s’organiser autour de propositions claires qui prendront en compte bien des propositions formulées par les organisations syndicales », a-t-il déclaré.
Forts de la mobilisation massive enregistrée jeudi – avec plus de 800.000 personnes dans les rues -, les syndicats seront reçus lundi avec les organisations patronales par le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, et la ministre des Solidarités, Agnès Buzyn.
Si le gouvernement a exclu de renoncer au système par points – comme le réclament certains syndicats -, il a toutefois fait des gestes d’ouverture ces derniers jours, se disant prêt à discuter de la date de mise en oeuvre de la réforme ou encore se disant « attentif » à trouver le « juste équilibre » financier.
Vendredi, le Premier ministre est allé encore un peu plus loin en faisant un geste à l’égard des personnels de la RATP et de la SNCF, en leur promettant de ne pas changer les règles « en cours de partie ».
Il s’est par ailleurs également de nouveau engagé à une revalorisation des salaires des enseignants pour qu’ils ne soient pas les perdants de la réforme, reconnaissant qu’une « application absurde des nouvelles règles les pénaliserait ».
Des ouvertures qui n’ont manifestement pas convaincu les trois principaux syndicats représentatifs du personnel de la SNCF (CGT-Cheminots, Unsa Ferroviaire, Sud-Rail) qui, réunis en intersyndicale à Paris ce samedi, ont appelé à « suivre et amplifier la grève partout ».
Déjà présents dans le cortège jeudi, quelque 2.000 « Gilets jaunes », dont le mouvement inédit avait pris de court l’exécutif en novembre 2018 et l’avait contraint à annoncer une série de mesures en faveur du pouvoir d’achat, se sont quant à eux réunis samedi à Paris, a constaté une journaliste de Reuters.
Les manifestants, qui ont défilé de Bercy à Porte de Versailles, ont essuyé des tirs de gaz lacrymogène lorsqu’ils ont voulu converger vers le quartier de Montparnasse où se tenait une manifestation contre le chômage et la précarité, en présence de la CGT.
(Marine Pennetier, avec Noémie Olive, édité par Bertrand Boucey)

NE MANQUONS PAS NOTRE RENDEZ-VOUS AVEC l'HISTOIRE - TOUS MOBILISÉS POUR LA TÉLÉVISION CHRÉTIENNE !
Les chrétiens protestants et évangéliques ont à leur disposition de puissants médias pour faire entendre leur voix dans le paysage audiovisuel français.
Un service de presse reconnu par l'Etat
Le Journal Chrétien est un service de presse en ligne bénéficiant d’un agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse du Ministère de la Culture. Il est membre du Syndicat de la Presse Indépendante d’Information en Ligne (SPIIL), un syndicat professionnel français créé en afin de défendre les intérêts professionnels des éditeurs de presse en ligne indépendants. Il fait partie des sources d'information officielles de Google actualités dans tous les pays francophones.Dans un paysage médiatique marqué par le mensonge et les fake news et les calomnies, le Journal Chrétien se positionne comme le média de la vérité qui passe l'information au tamis de l'Évangile. Nos journalistes et correspondants essaient de s'approcher de la vérité des faits avec beaucoup d'humilité. Le professionnalisme des experts impliqués dans le Journal Chrétien garantit une procédure de sélection de grande qualité et un suivi des projets très rigoureux. Quand les pasteurs et leurs églises sont victimes de dénonciations calomnieuses, le Journal Chrétien mène des investigations pour rétablir la vérité.
Une chaîne de télévision chrétienne incluse dans la Freebox
Votre soutien financier nous aidera à :
👍 produire des émissions de qualité pour sensibiliser et encourager ;
👍 accompagner les églises et communautés chrétiennes en difficulté ;
👍 transmettre l’héritage spirituel aux générations futures ;
👍 faire rayonner la foi chrétienne dans un esprit d’unité et d’amour.

Aidez-nous à porter la lumière de l'Evangile à la télévision !
Chrétiens TV, la chaîne de télévision chrétienne développée par le Journal Chrétien est diffusée sur le canal 246 de la Freebox en France. Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent nourrir leur réflexion, leur foi ou simplement découvrir des programmes porteurs de sens et de bienveillance. En faisant un don, petit ou grand, vous permettez à cette chaîne d’innover au quotidien pour une information toujours plus qualitative, plus d’émissions et de reportages édifiants, de décryptage de l’actualité et d’événements à la lumière de la Bible.
Ensemble, construisons un espace où la foi est honorée, respectée et protégée !

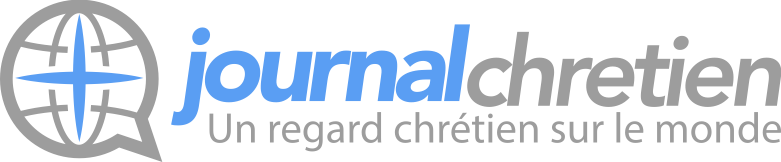





 JE FAIS UN DON MAINTENANT
JE FAIS UN DON MAINTENANT