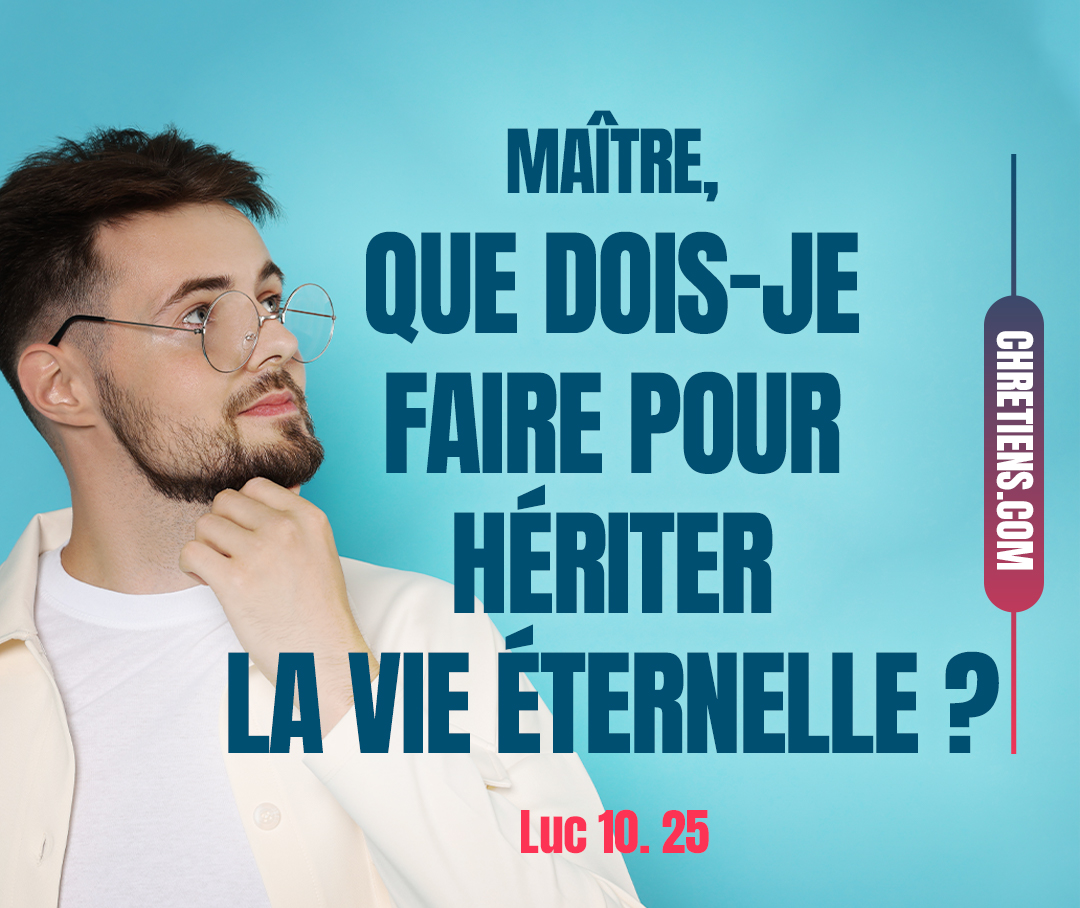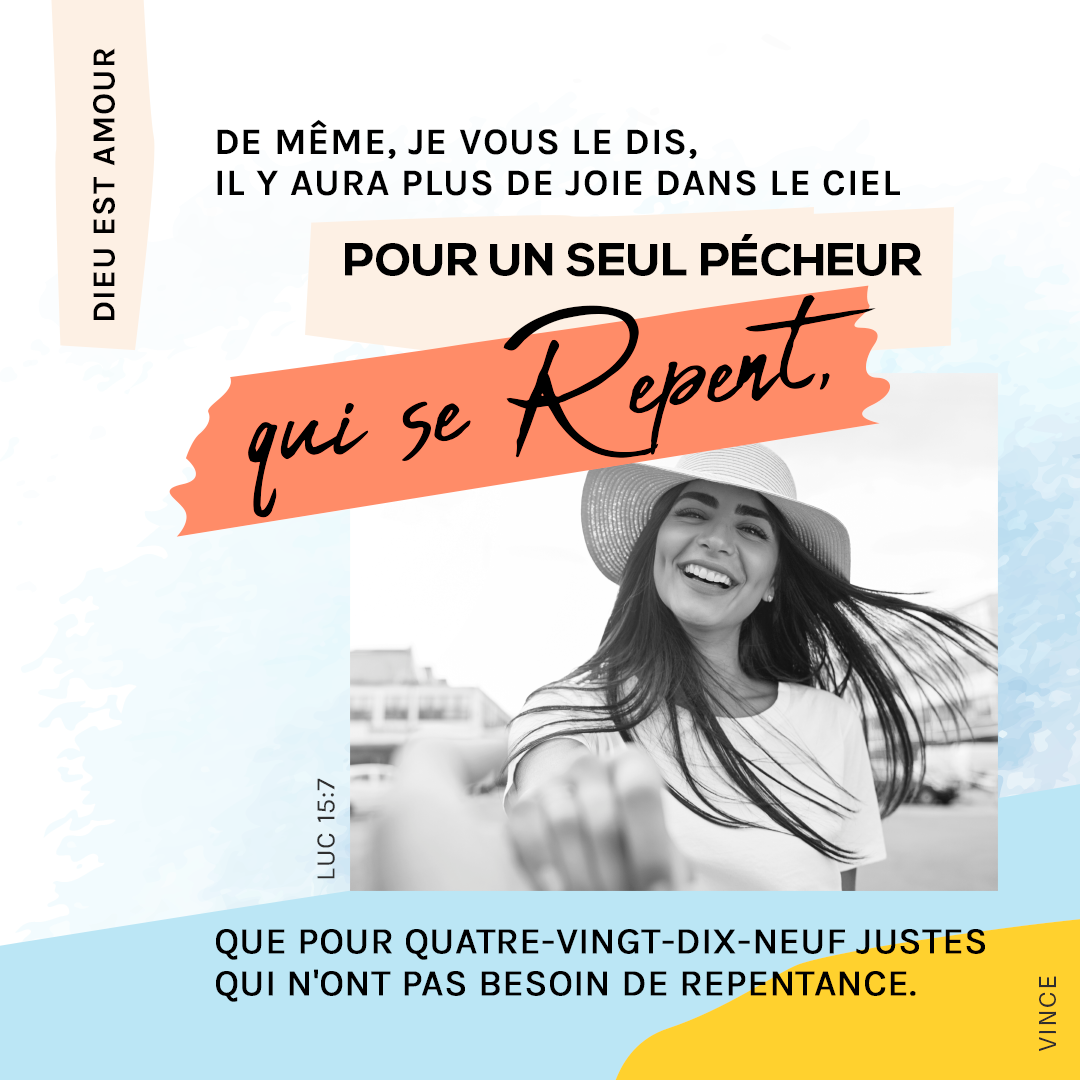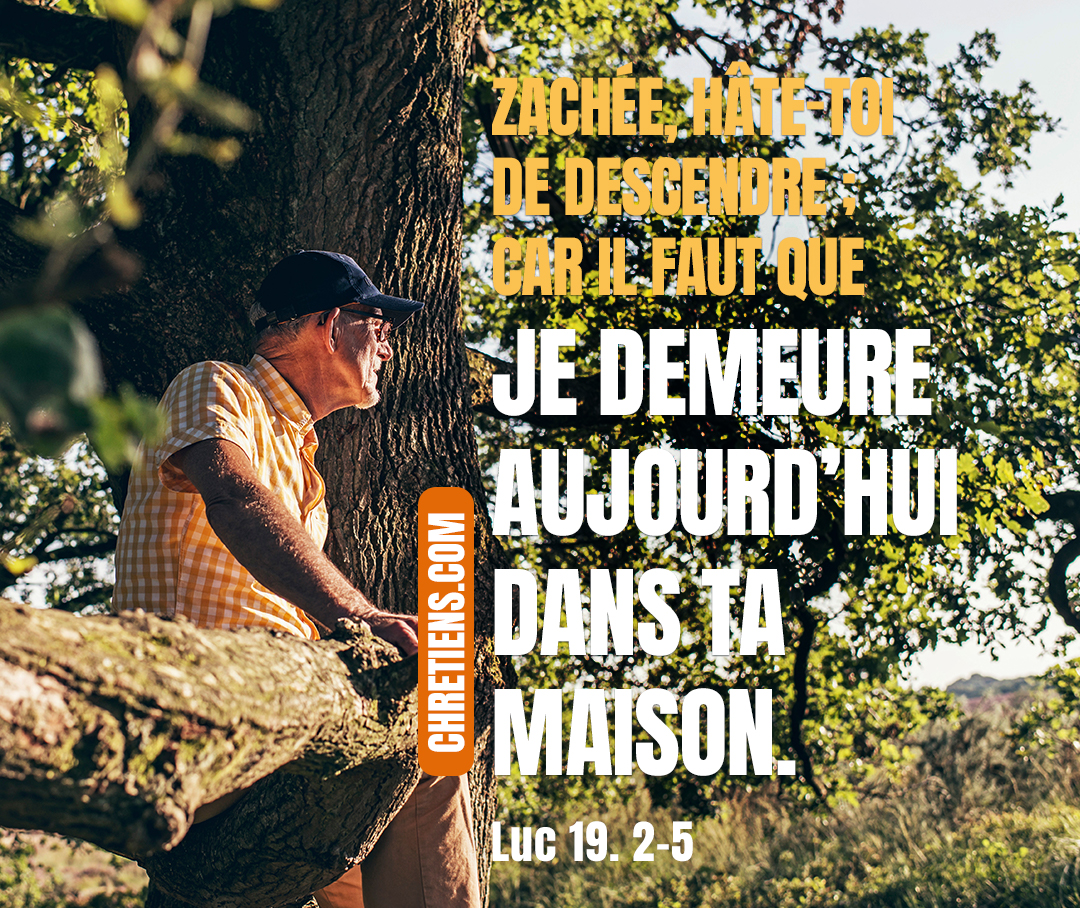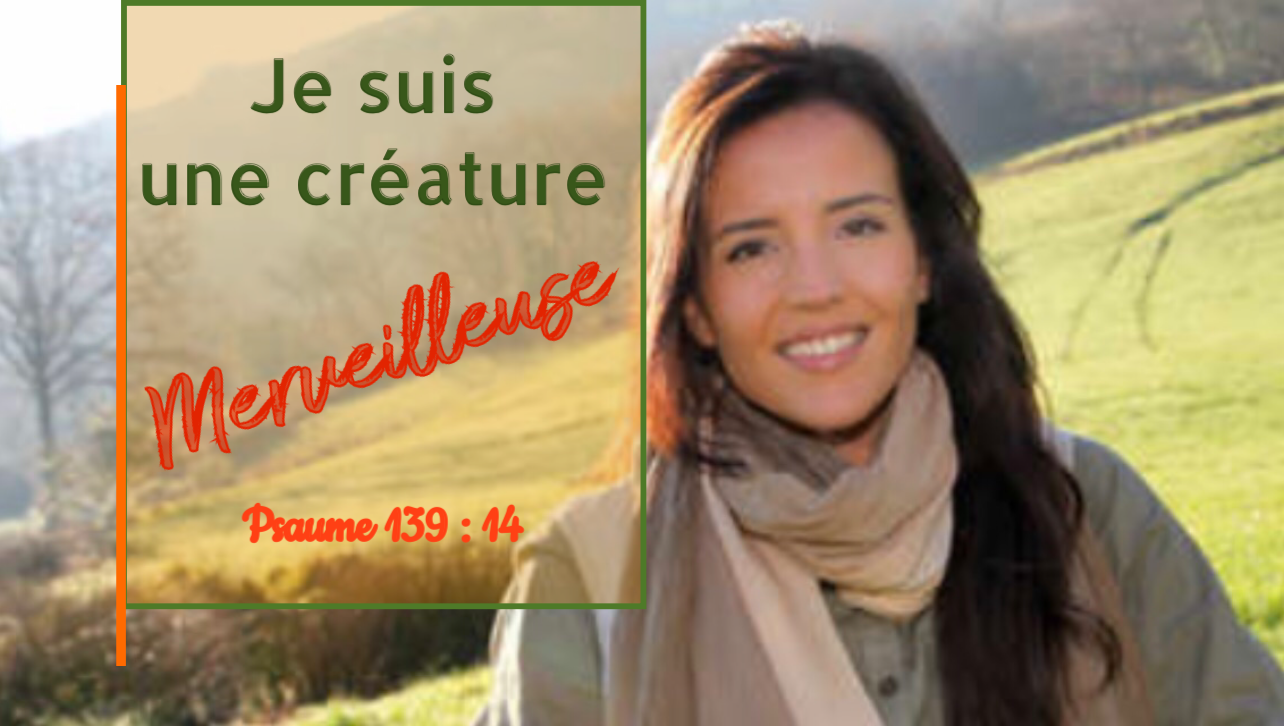Castaner élu président du groupe LaRem à l’Assemblée

PARIS (Reuters) – L’ancien ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a été élu jeudi président du groupe La République en marche à l’Assemblée nationale, un rôle-clé pour le camp Emmanuel Macron à 18 mois de l’élection présidentielle de 2022.
Redevenu député des Alpes-de-Haute-Provence après son départ de la place Beauvau lors du changement de gouvernement au début de l’été, Christophe Castaner l’a emporté avec 25 voix d’avance sur la députée des Yvelines Aurore Bergé au terme d’un vote électronique.
Le successeur de Gilles Le Gendre aura la difficile tâche de rassembler un groupe hétéroclite qui a connu une trentaine de défections depuis 2017, passant de 314 à 279 membres, en deçà de la majorité absolue.
Dans un entretien au Journal du dimanche, Christophe Castaner a dit son souhait de redonner au groupe une « fierté collective » grâce à « plus de transparence, plus de débats, plus d’exigence avec le gouvernement. »
Le vote des lois d’ici la fin du quinquennat dépendra des alliances du parti présidentiel avec le MoDem et une partie de l’UDI, un oeil rivé sur la prochaine course à l’Elysée.
« Nous devons chasser en meute et oublier nos différences. Et ce qui va nous rapprocher, ce n’est pas le mouvement, ni nos partenaires, ni les élections régionales du printemps prochain, c’est un homme : Emmanuel Macron », a dit à Reuters le député Patrick Vignal, qui a voté Castaner.
Sous couvert d’anonymat, un autre député confirme l’attachement des élus LaRem au locataire de l’Elysée tout en prédisant des mois difficiles au nouveau patron du groupe.
« Tous les députés savent pourquoi et grâce à qui ils sont là. Mais demain si on enlève Emmanuel Macron, il n’y a plus rien », dit-il. « Pour le président du groupe, la tâche sera rude d’autant que la situation du pays est très difficile à cause de l’épidémie. Il faut fédérer, initier une dynamique et trancher plutôt que dicter une conduite. Ce ne sera pas une partie de plaisir. »
(Elizabeth Pineau)

NE MANQUONS PAS NOTRE RENDEZ-VOUS AVEC l'HISTOIRE - TOUS MOBILISÉS POUR LA TÉLÉVISION CHRÉTIENNE !
Les chrétiens protestants et évangéliques ont à leur disposition de puissants médias pour faire entendre leur voix dans le paysage audiovisuel français.
Un service de presse reconnu par l'Etat
Le Journal Chrétien est un service de presse en ligne bénéficiant d’un agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse du Ministère de la Culture. Il est membre du Syndicat de la Presse Indépendante d’Information en Ligne (SPIIL), un syndicat professionnel français créé en afin de défendre les intérêts professionnels des éditeurs de presse en ligne indépendants. Il fait partie des sources d'information officielles de Google actualités dans tous les pays francophones.Dans un paysage médiatique marqué par le mensonge et les fake news et les calomnies, le Journal Chrétien se positionne comme le média de la vérité qui passe l'information au tamis de l'Évangile. Nos journalistes et correspondants essaient de s'approcher de la vérité des faits avec beaucoup d'humilité. Le professionnalisme des experts impliqués dans le Journal Chrétien garantit une procédure de sélection de grande qualité et un suivi des projets très rigoureux. Quand les pasteurs et leurs églises sont victimes de dénonciations calomnieuses, le Journal Chrétien mène des investigations pour rétablir la vérité.
Une chaîne de télévision chrétienne incluse dans la Freebox
Votre soutien financier nous aidera à :
👍 produire des émissions de qualité pour sensibiliser et encourager ;
👍 accompagner les églises et communautés chrétiennes en difficulté ;
👍 transmettre l’héritage spirituel aux générations futures ;
👍 faire rayonner la foi chrétienne dans un esprit d’unité et d’amour.

Aidez-nous à porter la lumière de l'Evangile à la télévision !
Chrétiens TV, la chaîne de télévision chrétienne développée par le Journal Chrétien est diffusée sur le canal 246 de la Freebox en France. Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent nourrir leur réflexion, leur foi ou simplement découvrir des programmes porteurs de sens et de bienveillance. En faisant un don, petit ou grand, vous permettez à cette chaîne d’innover au quotidien pour une information toujours plus qualitative, plus d’émissions et de reportages édifiants, de décryptage de l’actualité et d’événements à la lumière de la Bible.
Ensemble, construisons un espace où la foi est honorée, respectée et protégée !

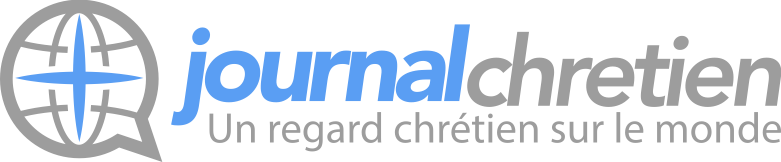
 JE FAIS UN DON MAINTENANT
JE FAIS UN DON MAINTENANT