Climat: Davantage de mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de Paris, dit l’Onu
❤️ Nouveau: Soutenez la campagne de dons du Journal Chrétien
(Reuters) – Le monde n’est pas sur la bonne trajectoire pour freiner le réchauffement climatique et des mesures supplémentaires sont nécessaires à tous les niveaux, ont averti les Nations unies vendredi, à l’approche de négociations internationales cruciales visant à endiguer la crise climatique.
Le « Bilan mondial », dernier avertissement en date des Nations unies sur les périls climatiques, servira de base aux négociations de la COP28 qui se tiendront à Dubaï à la fin de l’année.
Le rapport, point culminant de deux ans d’évaluation de l’accord de Paris sur le climat signé en 2015, synthétise des milliers de contributions d’experts, de gouvernements et de militants.
« L’accord de Paris a déclenché des actions sur le climat presque partout dans le monde, en fixant des objectifs et en envoyant des signaux sur l’urgence de résoudre la crise climatique », indique le rapport. « Bien que les efforts se poursuivent, il faut maintenant faire beaucoup plus sur tous les fronts. »
Près de 200 pays se sont mis d’accord en 2015 à Paris pour limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius par rapport aux températures précédant la révolution industrielle et pour s’efforcer de contenir l’augmentation à 1,5 degrés.
Bien que chaque pays soit responsable de ses efforts climatiques, les signataires ont également convenu de présenter un point d’étape d’ici 2023 afin de déterminer où porteront les prochains efforts.
Les Nations unies ont déclaré que les engagements des pays pris pour le moment en matière de réduction des émissions étaient insuffisants pour maintenir les températures en deçà du seuil de 1,5 degré.
Plus de 20 gigatonnes de réduction supplémentaire des émissions de CO2 sont nécessaires d’ici 2030, et les émissions nettes doivent être nulles d’ici 2050, afin d’atteindre les objectifs fixés, selon l’évaluation de l’Onu.
« TÂCHES AUDACIEUSES »
Le rapport invite les pays à réduire de 67% à 92% l’utilisation du charbon, utilisé « sans modération », d’ici à 2030 par rapport à 2019, et à l’éliminer pratiquement en tant que source d’électricité d’ici à 2050.
L’électricité à faible teneur en carbone ou sans carbone doit représenter jusqu’à 99% de l’électricité mondiale d’ici le milieu du siècle, et la captation du carbone doit surmonter les obstacles technologiques qui s’opposent à son développement.
Le rapport plaide également pour que des fonds soient développés pour soutenir la croissance faiblement carbonée, des milliards de dollars étant encore investis dans les combustibles fossiles.
« Le rapport suggère une liste de tâches audacieuses pour les gouvernements, afin de limiter le réchauffement à 1,5 degré et de protéger les populations du monde entier de la dévastation climatique », a déclaré Tom Evans, conseiller politique sur la diplomatie climatique au sein du groupe de réflexion britannique sur le climat E3G.
Des engagements sont nécessaires pour éliminer progressivement les combustibles fossiles, fixer des objectifs de développement des énergies renouvelables pour 2030, veiller à ce que le système financier finance l’action climatique et mobiliser des fonds pour s’adapter et tempérer les impacts du réchauffement climatique, a-t-il ajouté.
« Tout engagement qui serait en deçà de ce que suggère le rapport ne permettra pas d’atteindre les objectifs. »
Sultan Al Jaber, qui présidera la prochaine Conférence climat de l’Onu qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre aux Émirats arabes unis, a déclaré à Reuters que le bilan donnait une bonne orientation et qu’il invitait les États et les dirigeants du secteur privé à se rendre à la COP28 avec des engagements concrets.
Vendredi, le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres a déclaré aux dirigeants du G20 qu’ils avaient le pouvoir de résoudre une crise climatique qui « échappe à tout contrôle ».
(Reportage David Stanway à Singapour et Riham Alkousaa àBerlin, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)

Faites un don maintenant pour nous aider à poursuivre notre mission !
Les chrétiens protestants et évangéliques ont longtemps sous-estimé le pouvoir des médias. Les récentes polémiques concernant des reportages à charge contre les plus grandes églises évangéliques françaises pose la question des intentions des patrons des médias, de ces milliardaires qui ont surinvesti ce champ de bataille idéologique.
Ne perdons pas la bataille idéologique
Les achats de médias par des milliardaires ne sont pas toujours motivés par la rentabilité financière, mais plutôt par des intérêts idéologiques. Ils achètent les médias pour influencer l'opinion publique, mener des batailles culturelles et maintenir leur pouvoir économique et social.Les évangéliques pris pour cible
L’influence grandissante des évangéliques gêne certains patrons des médias qui, disons-le, sont engagés dans des loges ou des sectes pernicieuses. Très puissante aux États-Unis, où de nombreuses personnalités ont renoncé à l'occultisme et à la débauche pour se convertir à la foi évangélique, la percé de cette frange chrétienne de plus en plus présente en France fait trembler le monde des ténèbres.Faire contrepoids
A l'heure actuelle, les chaînes d’info font l’agenda, nourrissent les réseaux sociaux, orientent les débats publics. Le Journal Chrétien et sa chaîne Chrétiens TV veulent aller sur leur terrain en investissant la sphère politique et médiatique pour y proposer une autre hiérarchie de l’information. Il est question de mener la bataille culturelle pour faire contrepoids aux groupes de médias hostiles aux Evangéliques.A quoi serviront vos dons ?
Nous avons l’ambition de développer une plateforme de médias suffisamment compétitive. Vos dons nous permettront de créer des émissions chrétiennes de qualité, de réaliser plus d’investigation, de reportages et d’enquêtes de terrain, d'organiser des débats sur des sujets de société, et de recruter du personnel compétent.Il nous faudra également développer davantage notre présence sur le terrain, produire plus de reportages, investir dans du matériel.
Le Journal Chrétien est un média libre, indépendant, sans publicité, accessible à tous grâce à la fidélité et à la générosité de ses lecteurs.
Votre don (défiscalisable à 66%), petit ou grand, est plus qu’un geste. C’est un acte militant et chrétien !
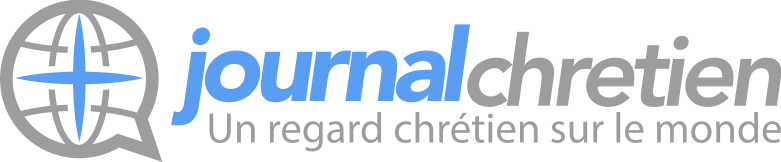






 FAIRE UN DON AU JOURNAL CHRETIEN
FAIRE UN DON AU JOURNAL CHRETIEN







