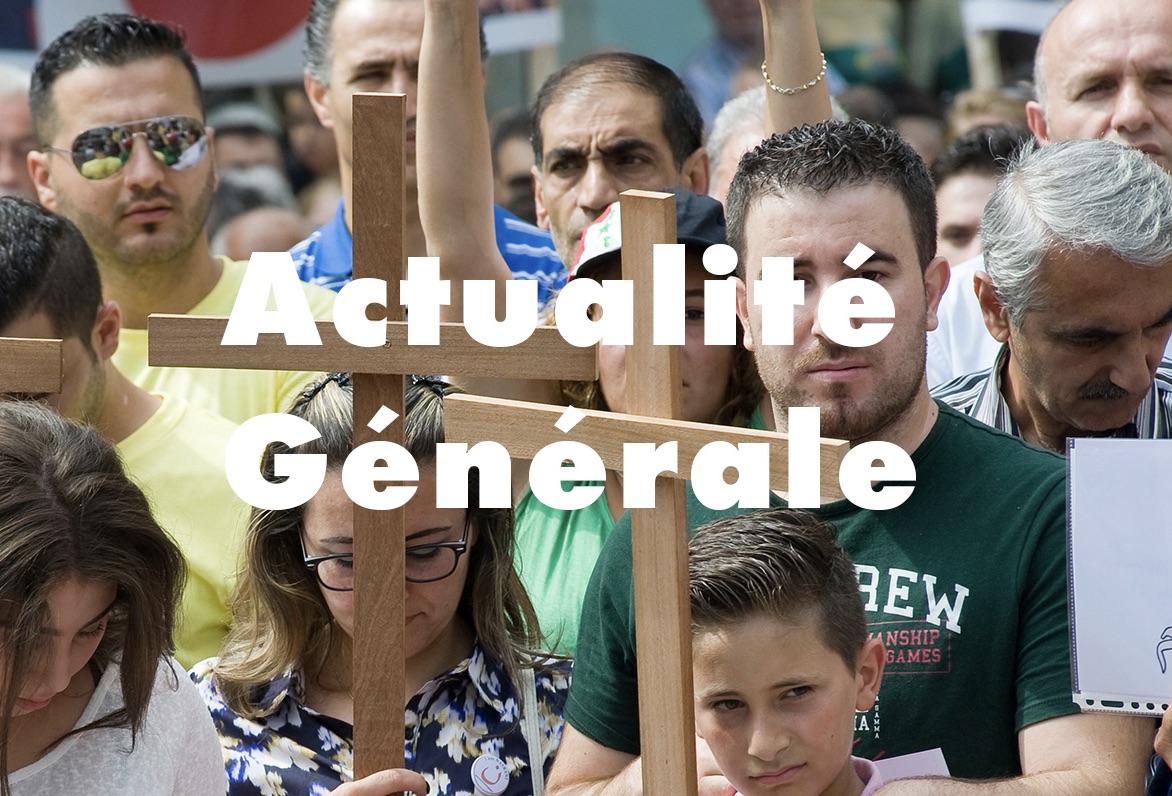Campari veut ouvrir des bars pour aiguiser les envies d’apéritif
par Francesca Landini
MILAN (Reuters) – Campari prévoit d’ouvrir plusieurs bars en Europe et au-delà, afin d’exploiter le succès de ses spiritueux et l’engouement pour l’apéritif à l’italienne, a déclaré son directeur général.
La semaine dernière, le groupe italien a fait état d’une augmentation de 29% de ses ventes à périmètre constant au cours des trois premiers mois de l’année, grâce à l’explosion de la demande pour ses amers Aperol et Campari lors de la réouverture des bars et des restaurants en Europe.
Mardi, Campari a aussi annoncé la signature d’un accord portant sur le rachat de la marque française d’apéritifs amers Picon et les actifs connexes de Diageo pour environ 119 millions d’euros.
Les boissons du groupe se sont bien vendues pour la consommation à domicile durant la pandémie de COVID-19, mais servir un cocktail bien fait reste l’un des meilleurs moyens de gagner de nouveaux clients, explique Bob Kunze-Concewitz, directeur général de Campari.
« Dans les cinq prochaines années, nous aimerions avoir des (bars) Camparino à Londres, New York, Singapour », a-t-il dit à des journalistes, ajoutant prévoir l’ouverture de 50 à 100 terrasses dans le monde.
Bob Kunze-Concewitz n’a pas précisé le coût de l’investissement.
Le groupe a racheté le bar Camparino sur la place centrale de Milan pour 5,6 millions d’euros en 2018 et a dépensé 6,5 millions d’euros supplémentaires pour éliminer la dette accumulée par le point de vente et le moderniser.
En 2020, Campari a payé 4,2 millions d’euros pour s’assurer un espace à Venise où, l’année suivante, il a ouvert Terrazza (Terrasse) Aperol.
Bien que le verre soit la première cause d’inflation des coûts, le groupe n’envisage pas de se tourner vers d’autres conditionnements.
« Nous ne pensons pas à remplacer le verre. D’abord parce que le verre est le plus durable, ensuite parce qu’il n’a pas d’impact sur la qualité du liquide et sur le goût, et enfin parce que tant de magie serait perdue avec le tetra pak ou le plastique », a déclaré Bob Kunze-Concewitz.
(Reportage Francesca Landini, version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)
Vous aimez nos publications ? Engagez-vous !
Les systèmes politiques et médiatiques ont besoin que s'exercent des contre-pouvoirs. Une majorité de journaux, télévisions et radios appartiennent à quelques milliardaires ou à des multinationales très puissantes souhaitant faire du profit, privant les citoyens d’un droit fondamental : avoir accès à une information libre de tout conflit d’intérêt.Le Journal Chrétien, service de presse en ligne bénéficiant d’un agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse du Ministère de la Culture, assure un contre-pouvoir à l’ensemble des acteurs sociaux, en vérifiant les discours officiels, en décryptant l'actualité, en révélant des informations de première importance ou en portant le témoignage des dominés.
La qualité de notre travail est reconnu par les médias séculiers. Dernièrement, le président du Journal Chrétien a accordé une longue interview à Sud Ouest, le deuxième quotidien régional français avec une diffusion totale de 219 000 exemplaires.
ENGAGEZ VOUS !
Quand les évangéliques sont attaqués, calomniés ou traités avec mépris par les médias traditionnels, un silence de notre part ne serait pas chrétien. Une telle attitude montrerait un renoncement suspect à se faire respecter et à exiger des médias mondains un tel respect.Lorsque les pasteurs et les églises évangéliques sont attaqués, le critère de la solidarité chrétienne doit jouer. Comment nous dire membres du Corps du Christ si nous restons indifférents à la persécution de certains d’entre nous, souvent réduits au silence et incapables de faire valoir leurs droits ou, tout simplement, de se faire respecter comme chrétiens ou communautés évangéliques ?
En s'appuyant sur notre plateforme de médias, l’action sur l’opinion publique est évidemment essentielle. Faire savoir est la condition de toute action, car rien n’est pire que le silence. D’où l’importance de l’action en direction des médias, des institutions et des populations.
Evidemment, ici comme ailleurs, la réticence de la part des chrétiens à agir comme des groupes de pression constitue une difficulté majeure. Mais, là encore, ne faudrait-il pas s’interroger sur notre dispersion et nos réticences à agir comme lobby, quand il s’agit de défenses des libertés et droits humains fondamentaux ?
Vous pouvez soutenir notre action :
- en faisant un don ponctuel ou régulier.
- en rejoignant notre équipe comme analyste, expert, professionnel de l'audiovisuel, défenseur des droits de l'homme, journaliste, théologien, etc.
- en priant pour nous.
- en nous contactant par email à l'adresse [email protected] ou par téléphone au par téléphone au +33 769138397
 JE FAIS UN DON
JE FAIS UN DON