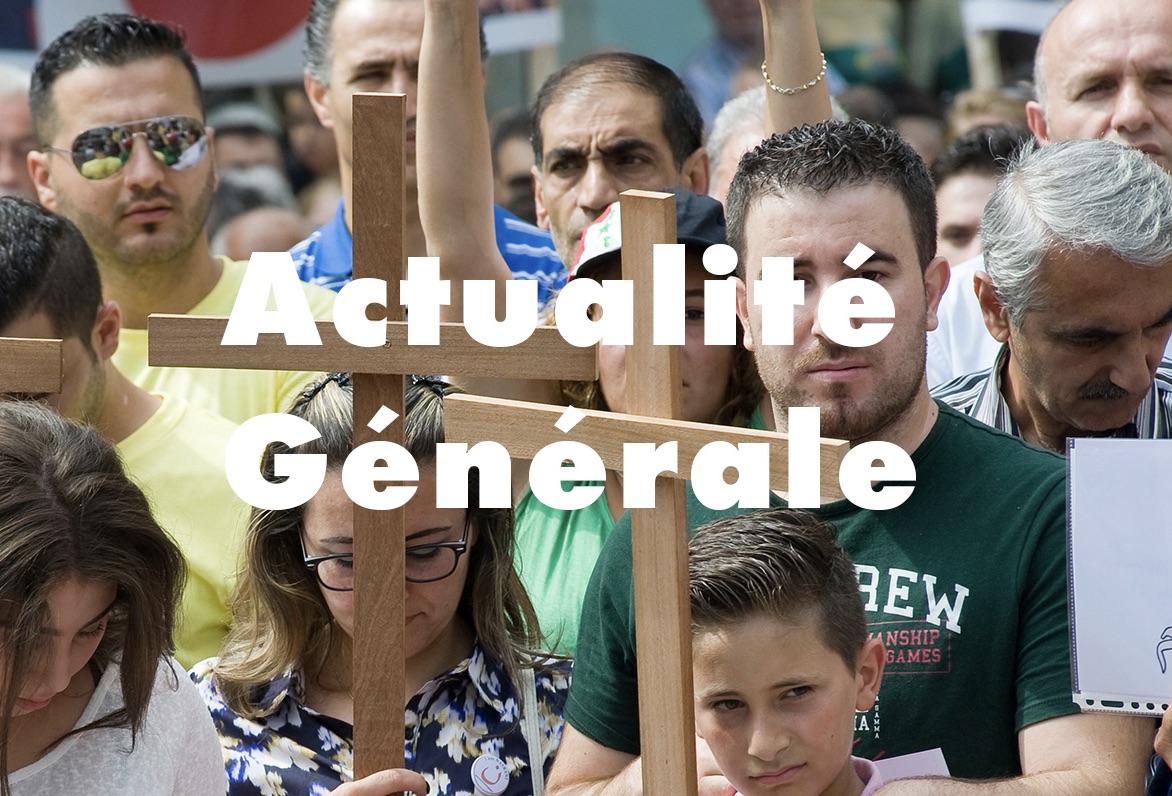L’IA va transformer la gestion de fortune, selon Microsoft
par Oliver Hirt
ZURICH (Reuters) – L’intelligence artificielle (IA) va transformer le secteur de la gestion de fortune, déclare vendredi à Reuters Martin Moeller, responsable de l’IA pour les services financiers chez Microsoft, ajoutant que cette technologie permettra à de petits acteurs de rivaliser plus facilement avec de grandes banques.
En synthétisant de larges volumes de données financières, l’IA permettra à de petites équipes d’effectuer le travail de divisions entières, estime le spécialiste.
« L’IA générative va redéfinir la compétition. L’IA, par exemple, abaissera de manière considérable les barrières à l’entrée pour les start-ups, un peu comme Internet et la numérisation l’ont fait il y a quelques dizaines d’années », explique Martin Moeller.
Depuis début 2024, le prestataire suédois de services de paiement Klarna utilise l’IA développée par le partenaire de Microsoft OpenAI, le logiciel effectuant le travail de 700 employés.
L’IA pourrait également faciliter le travail des « family offices », des gérants de fortunes pour les familles les plus riches.
« Les banques qui pour le moment n’ont pas été très actives dans le segment de la gestion de fortune pourraient y entrer à l’aide de l’IA et sans avoir à beaucoup investir dans les conseillers clients », détaille le responsable.
L’IA profite par ailleurs de la transformation des habitudes des clients, les jeunes entrepreneurs étant de plus en plus enclins à placer eux-mêmes leur argent, souligne Martin Moeller, ce qui pousse les banques à proposer à leurs clients d’utiliser l’IA pour regrouper toutes les informations financières les concernant.
« Les clients devraient pouvoir accéder à de l’information complexe à n’importe quel moment. La construction de portefeuille peut aussi être gérée par de l’IA », ajoute le spécialiste.
L’IA ne donne pour le moment pas de conseils d’investissement, mais des modèles d’IA disposant d’une capacité de prise de décision autonome devraient commencer à apparaître d’ici deux ans.
(Rédigé par John Revill, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)
Vous aimez nos publications ? Engagez-vous !
Les systèmes politiques et médiatiques ont besoin que s'exercent des contre-pouvoirs. Une majorité de journaux, télévisions et radios appartiennent à quelques milliardaires ou à des multinationales très puissantes souhaitant faire du profit, privant les citoyens d’un droit fondamental : avoir accès à une information libre de tout conflit d’intérêt.Le Journal Chrétien, service de presse en ligne bénéficiant d’un agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse du Ministère de la Culture, assure un contre-pouvoir à l’ensemble des acteurs sociaux, en vérifiant les discours officiels, en décryptant l'actualité, en révélant des informations de première importance ou en portant le témoignage des dominés.
La qualité de notre travail est reconnu par les médias séculiers. Dernièrement, le président du Journal Chrétien a accordé une longue interview à Sud Ouest, le deuxième quotidien régional français avec une diffusion totale de 219 000 exemplaires.
ENGAGEZ VOUS !
Quand les évangéliques sont attaqués, calomniés ou traités avec mépris par les médias traditionnels, un silence de notre part ne serait pas chrétien. Une telle attitude montrerait un renoncement suspect à se faire respecter et à exiger des médias mondains un tel respect.Lorsque les pasteurs et les églises évangéliques sont attaqués, le critère de la solidarité chrétienne doit jouer. Comment nous dire membres du Corps du Christ si nous restons indifférents à la persécution de certains d’entre nous, souvent réduits au silence et incapables de faire valoir leurs droits ou, tout simplement, de se faire respecter comme chrétiens ou communautés évangéliques ?
En s'appuyant sur notre plateforme de médias, l’action sur l’opinion publique est évidemment essentielle. Faire savoir est la condition de toute action, car rien n’est pire que le silence. D’où l’importance de l’action en direction des médias, des institutions et des populations.
Evidemment, ici comme ailleurs, la réticence de la part des chrétiens à agir comme des groupes de pression constitue une difficulté majeure. Mais, là encore, ne faudrait-il pas s’interroger sur notre dispersion et nos réticences à agir comme lobby, quand il s’agit de défenses des libertés et droits humains fondamentaux ?
Vous pouvez soutenir notre action :
- en faisant un don ponctuel ou régulier.
- en rejoignant notre équipe comme analyste, expert, professionnel de l'audiovisuel, défenseur des droits de l'homme, journaliste, théologien, etc.
- en priant pour nous.
- en nous contactant par email à l'adresse [email protected] ou par téléphone au par téléphone au +33 769138397
 JE FAIS UN DON
JE FAIS UN DON