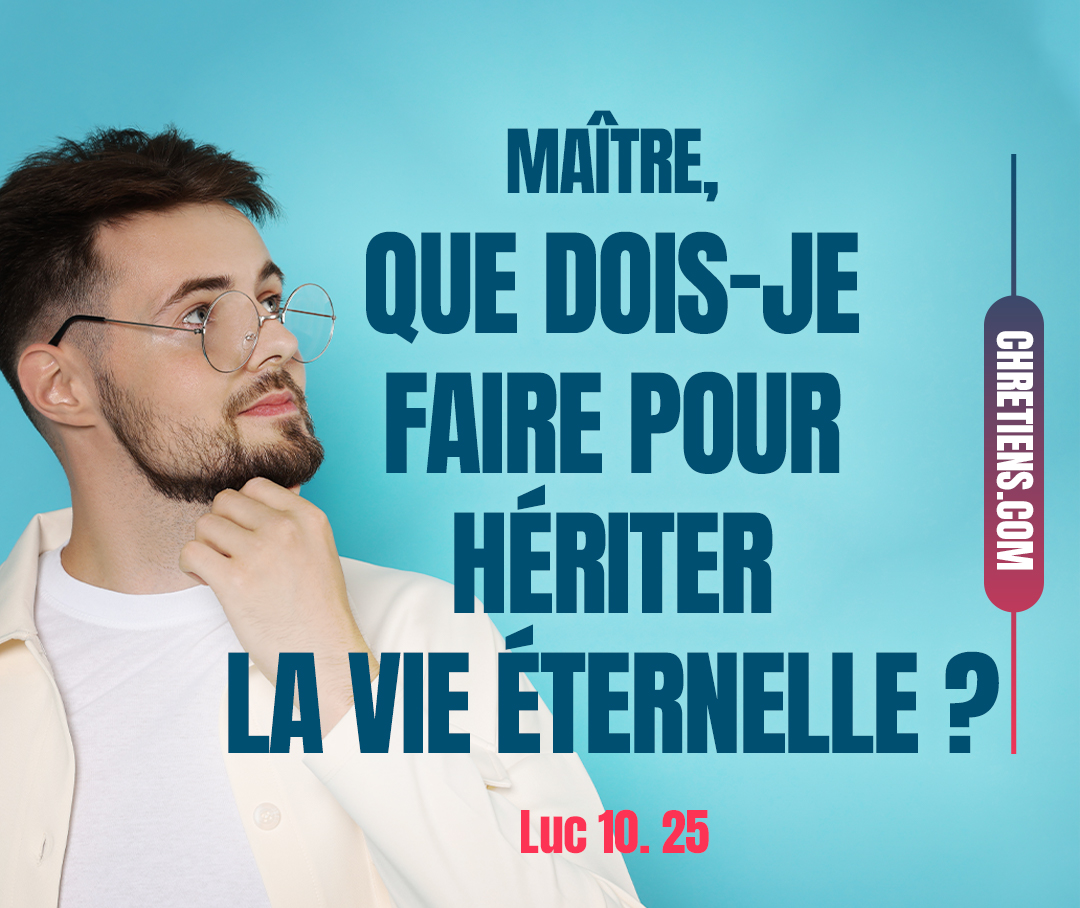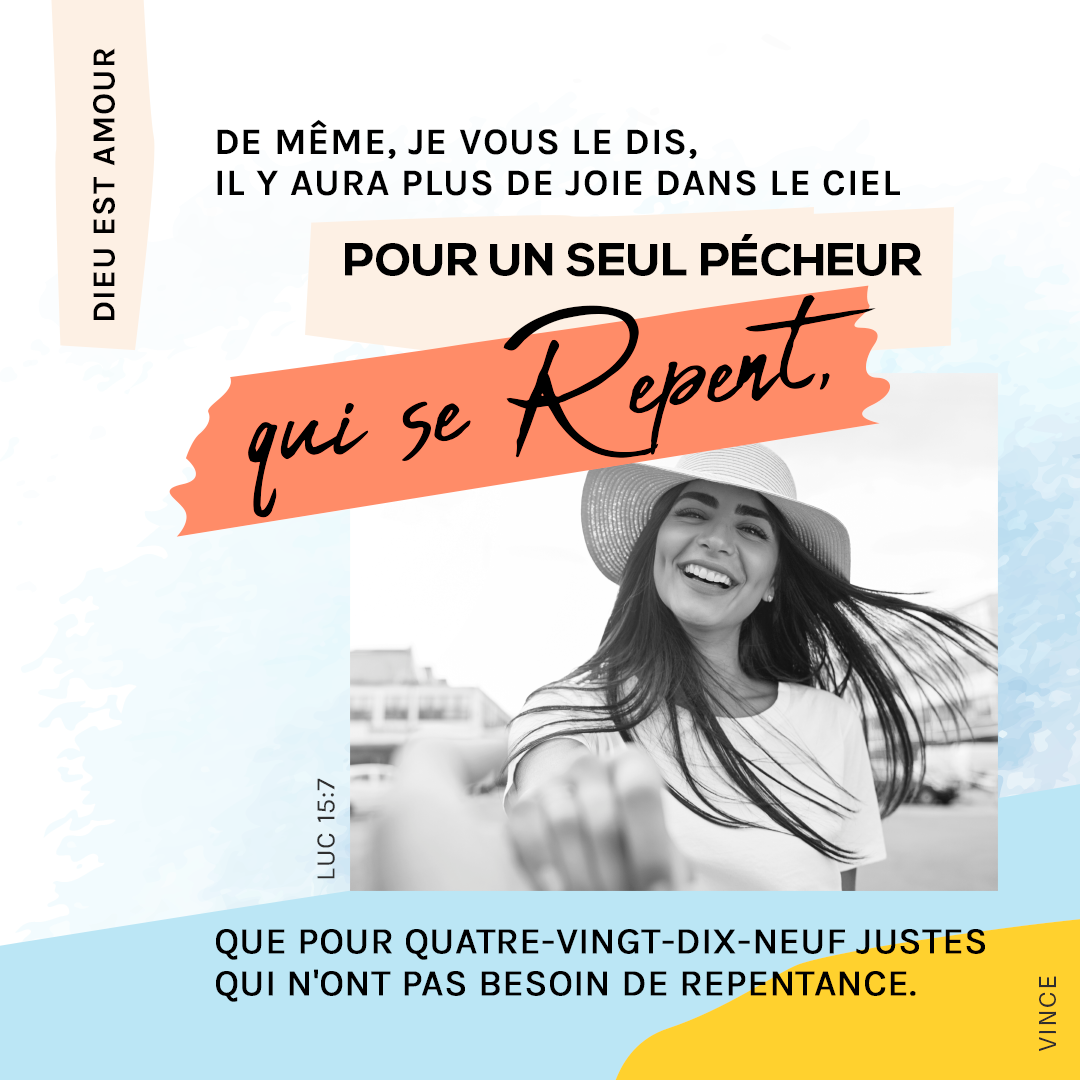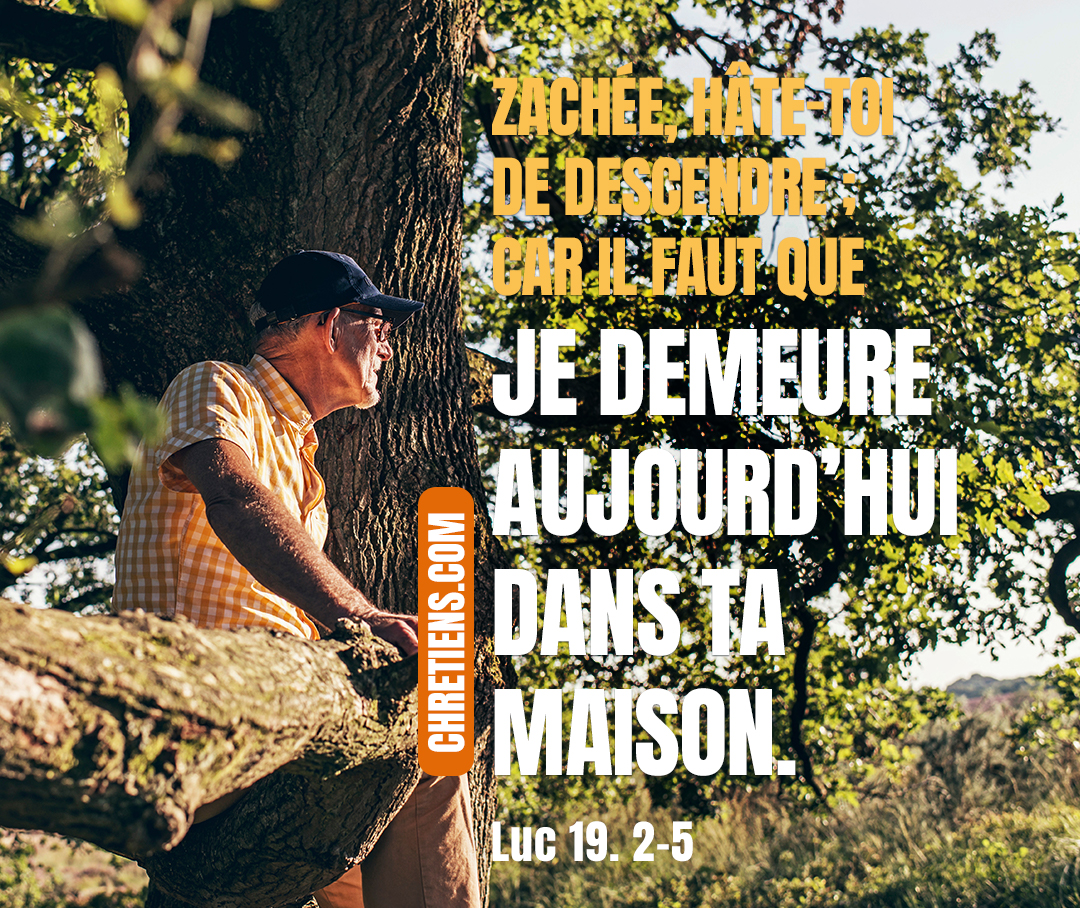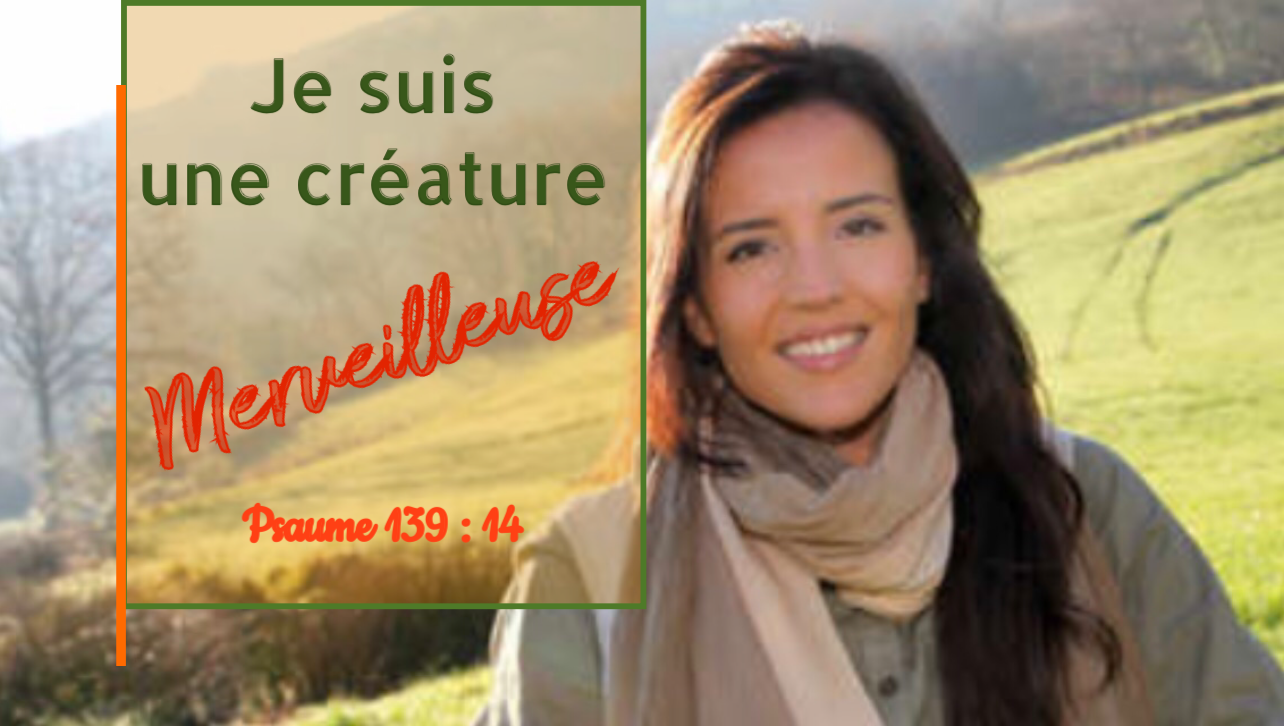Panama: L’ancien ministre de la Sécurité remporte l’élection présidentielle

par Valentine Hilaire et Elida Moreno
CIUDAD DE PANAMA (Reuters) – Jose Raul Mulino a remporté l’élection présidentielle de dimanche au Panama, profitant du soutien de l’ancien président Ricardo Martinelli qui a activement participé à la campagne de son ex-ministre de la Sécurité, depuis l’ambassade du Nicaragua, où il a trouvé refuge après une condamnation pour corruption.
Jose Raul Mulino, politicien conservateur, était considéré comme l’un des favoris du scrutin après avoir remplacé comme candidat Ricard Martinelli, déclaré inéligible du fait de sa condamnation en justice.
Il sera intronisé le 1er juillet prochain, pour un mandat de cinq ans.
S’exprimant après que des représentants de la commission électorale l’ont contacté pour lui confirmer sa victoire, Jose Raul Mulino a promis de « former un gouvernement d’unité aussi vite que possible ».
De nombreux électeurs considèrent Jose Raul Mulino comme un allié de Ricardo Martinelli. Ses opposants le décrivent toutefois comme une marionnette de l’ancien président, qui a joué un rôle central dans la campagne de Mulino, bien que reclu dans l’ambassade du Nicaragua où il a demandé l’asile.
Jose Raul Mulino s’est rendu à l’ambassade nicaraguayenne pour s’y entretenir avec Ricardo Martinelli après avoir déposé son bulletin de vote dans l’urne.
Après le dépouillement de 90% des bulletins, Jose Raul Mulino était crédité d’environ 34% des suffrages, contre environ 25% pour son premier rival, Ricardo Lombana, qui a reconnu sa défaite.
Lors de la campagne électorale, Jose Raul Mulino a promis de mettre en oeuvre d’ambitieux investissements dans les infrastructures et de relever le salaire minimal, tout en laissant penser qu’il ne laisserait pas Ricardo Martinelli être emprisonné.
Des défis importants l’attendent, alors que le pays est miné par les divisions sociales et exaspéré par la corruption au sein de la classe politique.
(Valentine Hilaire et Elida Moreno; version française Jean Terzian)
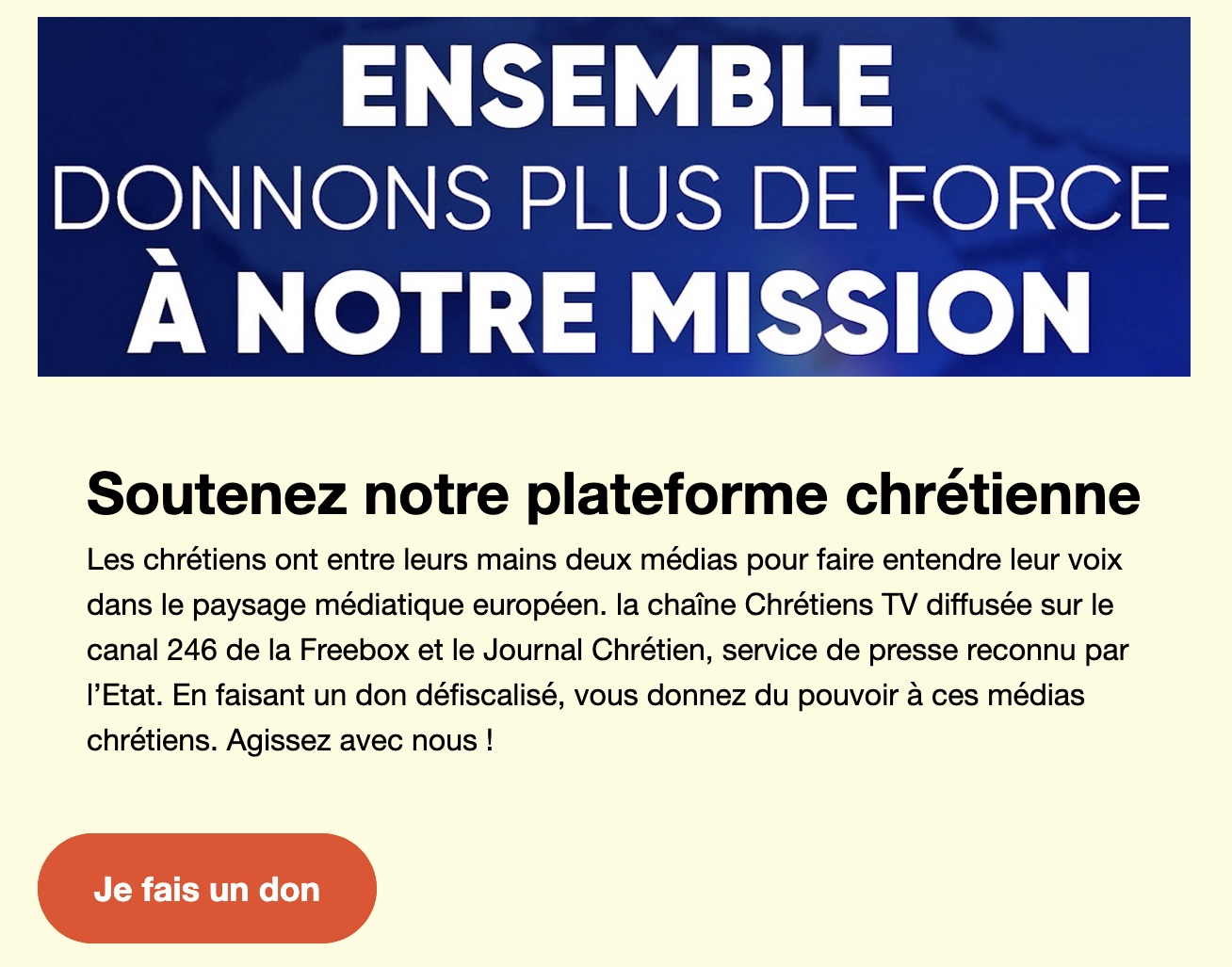
Faites un don maintenant pour nous aider à poursuivre notre mission !
Dans un paysage médiatique marqué par le mensonge, les fake news, les calomnies et les attaques contre les Evangéliques, le Journal Chrétien se positionne comme le média de la vérité qui propose une information indépendante et fiable, non biaisée par des intérêts d'actionnariat ou publicitaires.Les chrétiens protestants et évangéliques ont longtemps sous-estimé le pouvoir des médias. Les récentes polémiques concernant des reportages à charge contre les plus grandes églises évangéliques françaises posent la question des intentions des patrons des médias, de ces milliardaires qui ont surinvesti ce champ de bataille idéologique.
Ne perdons pas la bataille idéologique
Les achats de médias par des milliardaires ne sont pas toujours motivés par la rentabilité financière, mais plutôt par des intérêts idéologiques. Ils achètent les médias pour influencer l'opinion publique, mener des batailles culturelles et maintenir leur pouvoir économique et social.Les évangéliques pris pour cible
L’influence grandissante des évangéliques gêne certains patrons des médias qui, disons-le, sont engagés dans des loges ou des sectes pernicieuses. Très puissante aux États-Unis, où de nombreuses personnalités ont renoncé à l'occultisme et à la débauche pour se convertir à la foi évangélique, la percée de cette frange chrétienne de plus en plus présente en France fait trembler le monde des ténèbres.Faire contrepoids
A l'heure actuelle, les chaînes d’info font l’agenda, nourrissent les réseaux sociaux, orientent les débats publics. Le Journal Chrétien et sa chaîne Chrétiens TV veulent aller sur leur terrain en investissant la sphère politique et médiatique pour y proposer une autre hiérarchie de l’information. Il est question de mener la bataille culturelle pour faire contrepoids aux groupes de médias hostiles aux Evangéliques.A quoi serviront vos dons ?
Nous avons l’ambition de développer une plateforme de médias suffisamment compétitive. Vos dons nous permettront de créer des émissions chrétiennes de qualité, de réaliser plus d’investigation, de reportages et d’enquêtes de terrain, d'organiser des débats sur des sujets de société, et de recruter du personnel compétent.Il nous faudra également développer davantage notre présence sur le terrain, produire plus de reportages, investir dans du matériel.
Le Journal Chrétien est un média libre, indépendant, sans publicité, accessible à tous grâce à la fidélité et à la générosité de ses lecteurs.
Votre don (défiscalisable à 66%), petit ou grand, est plus qu’un geste. C’est un acte militant et chrétien !
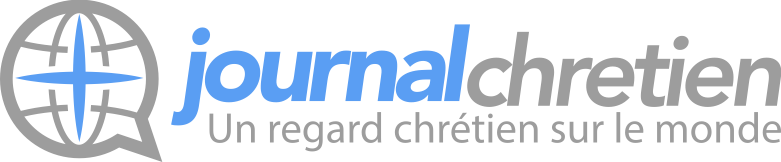

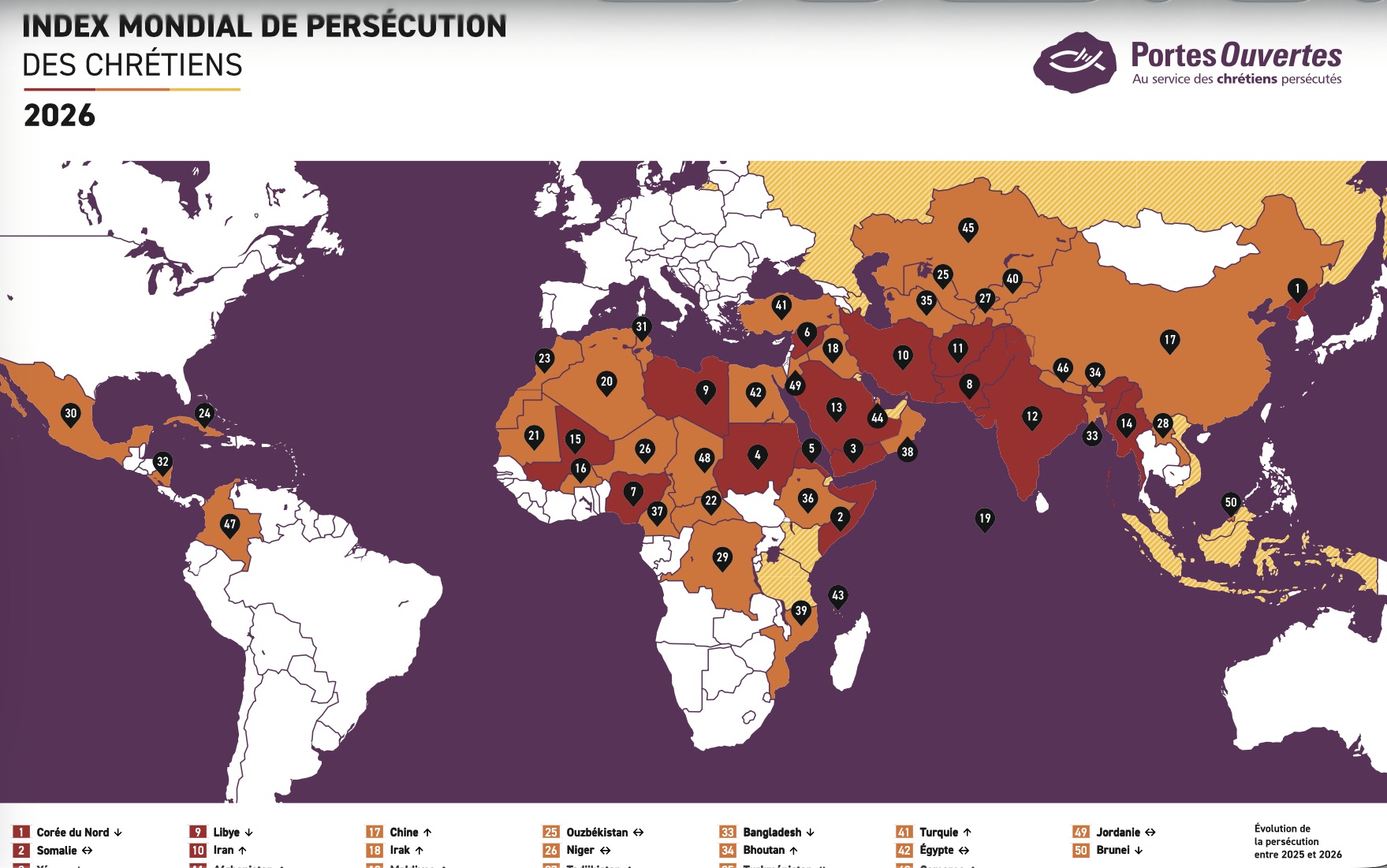




 JE FAIS UN DON MAINTENANT
JE FAIS UN DON MAINTENANT